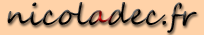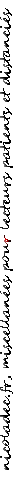|
option |  |
|

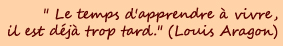
Survoler les mots en bleu avec la souris
pour explications supplémentaires
Essence et existence
|
Kant, notamment dans La critique de la raison pure, montre que la connaissance se fait par l'usage de deux facultés. La sensibilité, l'intuition sensible, n'est que réceptivité. Sa fonction est de recevoir (d'intuitionner) les données des sens, les sensations. C'est trop peu pour faire de la connaissance, car on en reste alors à la pure diversité du sensible, mais c'est néanmoins indispensable, car on ne peut établir de connaissance que de ce qui est donné, et la sensibilité est la seule voie par laquelle quelque chose nous soit donné (il n'y a d'intuition que sensible). L'entendement, quant à lui, organise cette diversité du sensible, pour en construire une connaissance. L'entendement n'est donc pas réceptivité, mais au contraire pure action, au sens philosophique traditionnel du terme de spontanéité. Il faut donc bien distinguer entre deux problèmes différents : celui de l'existence de quelque chose, celui de son sens. Le sens est affaire de pensée, tandis que l'existence ne peut être qu'affaire de sensibilité. Kant est formel sur ce point : il n'y a pas d'intuition intelligible, aucune existence n'est directement donnée à notre pensée. Aucune existence ne peut donc être déduite, l'existence n'est pas une propriété parmi les autres. C'est pourquoi Kant refuse toute validité à la fameuse "preuve ontologique", prétendue preuve de l'existence de dieu reprise par Descartes de Saint-Anselme, qui tente de déduire l'existence de dieu de sa perfection. " Quand donc je conçois une chose, quels que soient et si nombreux que soient les prédicats au moyen desquels je la conçois, (...), par cela seul que j'ajoute que cette chose existe, je n'ajoute absolument rien à la chose.(...). Si donc je conçois un être comme la suprême réalité (sans défaut), il reste toujours à savoir si cet être existe ou non." (Critique de la raison pure). |
|
Dans ce qui forme le sens d'un être, on peut distinguer deux sortes de déterminations. Certaines sont accessoires, non fondamentales, et pourraient être autres sans que la nature de la chose en soit changée. Comme on appelle contingent ce qui peut se produire ou non, on dira de ces déterminations qu'elles sont contingentes. D'autres déterminations, au contraire, n'ont pas ce caractère accidentel, et sont indispensables pour que la chose soit ce qu'elle est. On dira donc qu'elles sont essentielles, qu'elles en constituent l'essence. L'essence est donc, si l'on veut, l'ensemble des déterminations qui font qu'une chose est ce qu'elle est.
Mais il ne faut pas confondre la question de ce qu'une chose peut être avec le fait même qu'elle soit. Le premier point constitue l'essence, le second l'existence. Toute justification est affaire de réflexion. Aussi l'existence, qui, à la différence de la pensée, n'est pas affaire de pensée, ne peut recevoir de justification. Aucun système de pensée ne peut la justifier : "Il ne peut y avoir un système de l'existence.(...) Qui dit système dit monde clos, mais l'existence est justement le contraire. Abstraitement, système et existence ne peuvent se penser ensemble parce que, pour penser l'existence, la pensée systématique doit la penser comme supprimée, c'est-à-dire autrement que comme donnée de fait" (Sören Kierkegaard, Post scriptum aux miettes philosophiques).
L'existence n'est donc qu'un fait contingent, sans raison, sans justification. C'est cela qu'on appelle la facticité (attention, le mot ne renvoie pas dans son sens philosophique à factice, mais à fait.) : "Ma facticité, c'est-à-dire le fait que les choses sont là simplement comme elles sont, sans nécessité ni possibilité d'être autrement, et que je suis là parmi elles." (Sartre).
Athéisme et liberté
Un coupe-papier n'existe pas par génération spontanée. Il existe parce que des hommes en ont conçu l'utilité, en ont établi le projet précis par des plans, puis l'ont fabriqué. Autrement dit, il a fallu qu'il y ait déjà l'idée du coupe-papier, pour que s'ensuive son existence. On dira donc dans ce cas que l'essence précède l'existence. C'est évidemment le cas de tous les objets fabriqués par l'homme. Mais quand on prend conscience à quel point les êtres vivants obéissent à des règles de comportement, à des instincts, qui restent assez peu variables à l'intérieure d'une même espèce, on en conclut que là aussi, tout est "écrit" d'avance, et donc que l'essence précède encore l'existence. L'artisan de cette essence sera alors, suivant les doctrines, dieu ou la nature.
L'extraordinaire variété au contraire des comportements humains tend à rendre douteux qu'il y ait encore dans ce cas un plan défini d'avance. Il y a par exemple un comportement sexuel typique pour chaque espèce, alors que l'humanité montre en ce domaine une diversité et une créativité assez étonnantes. Dans la tradition kantienne. Sartre enseigne la liberté absolue de l'homme. Comme chez Kant, dans un contexte évidemment différent, cette liberté ne peut être mise sur le même plan que les éventuelles déterminations que l'on pense par ailleurs pouvoir mettre en évidence (voir ci-dessous la notion de situation). Mais si la liberté est totale, il faut alors refuser l'idée qu'il puisse y avoir pour l'homme une essence initiale. C'est une alternative : ou nous sommes dotés d'une essence de départ (une nature humaine) et donc nous ne sommes pas libres, ou nous sommes libres et donc ne sommes liés à aucune essence. "Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence ? Cela signifie que l'homme d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après." (Sartre, L'existentialisme est un humanisme). L'existentialisme sartrien est donc athée.
On ne peut donc concevoir, selon Sartre, que l'homme soit la création d'un dieu. Car si un dieu avait créé les hommes, on se retrouverait dans le schéma de l'homme créant les coupe-papier, c'est à dire que l'essence en précéderait l'existence, et donc l'existence serait d'emblée liée à une essence. Donc il n'y aurait pas de liberté. Il faut donc choisir entre les notions de dieu et de liberté. Notons que quand certains philosophes (par exemple du XVIIIième siècle) remplacent dieu par la nature comme créateur de la nature humaine, ils ne font que substituer un mot à un autre, sans rien changer de fondamental à l'idée. "Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir" (Sartre, L'existentialisme est un humanisme).
Il y a donc absurdité de la condition humaine à un double point de vue. Le premier, déjà évoqué ci-dessus, est que l'existence est injustifiable, dans le sens où il y a impossibilité de justifier rationnellement l'existence de quoi que ce soit, où l'existence ne relève que de la facticité. Le second est que l'existence d'un homme précédant son essence, l'homme n'a d'abord aucun sens. Ce n'est qu'ensuite qu'il deviendra ce qu'il se sera fait. Mais il n'y pas à se lamenter de cette absurdité, puisqu'elle est la condition sine qua non de la liberté, elle est donc au contraire une chance. Du fait que je ne peux me définir par mon origine, je ne peux me donner sens qu'en m'engageant dans un avenir, mon sens est donc fondamentalement projet.
Situation et liberté
Je suis né quelque part, dans des conditions que je n'ai pas choisies. Je vis ensuite au milieu d'autres êtres qui peuvent représenter pour moi aussi bien des obstacles que des aides, et tout cela forme une situation historique, variable pour chaque homme, dont il n'est pas l'auteur. Tout cela, qui forme la condition humaine ( à ne pas confondre avec une nature humaine dont l'existentialisme nie l'existence), pourrait sembler être en contradiction avec l'affirmation d'une liberté absolue. Mais cette situation ne constitue pas un déterminisme, elle est en quelque sorte le matériau à partir duquel il y a à se construire. On peut toujours se lamenter du mauvais sort qui nous a plongé dans une situation qu'on estime défavorisée. La situation qu'on n'a pas eue permet toujours d'entretenir tous les fantasmes de ces beaux ailleurs, d'autant plus beau qu'ils sont ailleurs et qu'on n'a pas à les assumer. La vérité en la matière est que d'une part, bien malin qui prétendrait évaluer de manière exhaustive toutes les possibilités, souvent paradoxales, que peut offrir une situation, et d'autre part qu'au bout du compte le seul véritable enjeu est comment je me construis à partir de là. "Ce qui ne varie pas, c'est la nécessité pour (l'homme) d'être dans le monde, d'y être au travail, d'y être au milieu des autres et d'y être mortel" (Sartre).
La liberté n'est donc pas une pure abstraction, qui s'inscrirait comme liberté d'indifférence dans la belle pureté d'un néant métaphysique. L'âne de Buridan, qui a autant faim que soif, se laisse mourir à mi distance entre une botte de foin et un seau d'eau, faute de raison de choisir d'abord l'un plutôt que l'autre. Suspendue dans l'impossible abstraction d'une absence de déterminations, la liberté n'aurait aucune raison de se décider à ceci plus qu'à cela. Il est donc nécessaire que la liberté soit inscrite dans une situation, qui n'est pas pour autant déterminisme, mais qui lui permet de se construire comme projet. Le rejet bien commode de la responsabilité sur la situation relève de la mauvaise foi (ci-dessous).
Jeu et mauvaise foi
Je ne suis rien de déterminé a priori, je ne suis que ce que je me fais être. Mais si liberté il y a, cela signifie que je ne le suis qu'autant que je me fais être tel. Aussi puis-je toujours changer de projet. Il n' y a pas d'obligation définitive de faire ce que je fais. Ce que je fais est donc toujours de l'ordre du rôle. Nous ne faisons que jouer des rôles, et nous en sommes au fond souvent assez conscients. "En fait, chacun est conscient de jouer et de dépasser toujours son rôle, qu'il ne peut de toute façon pas prendre au sérieux sans mauvaise foi, puisqu'il n'est pas ce rôle" . Ainsi, Sartre prenait l'exemple du garçon de café "qui vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif, s'incline avec un peu trop d'empressement, revient en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate". On joue ainsi à être élève, à être professeur, ainsi qu'à toute autre chose, ce qui ne signifie pas que cela se joue impunément, pour rire, mais que nous ne sommes jamais réellement ces rôles que nous jouons. Dans ces conditions, la notion de sincérité demande à être problématisée. On peut en effet se demander s'il n'y a pas là une attitude qui voudrait faire croire qu'on est vraiment le choix présent, ce qui peut relever de la mauvaise foi.
Le fait qu'il s'agisse de rôles à jouer n'empêche qu'on puisse s'y comporter de manières diverses : on peut bien jouer, mal, lamentablement même, c'est-à-dire comme on fait parfois : un peu dans le rôle, sans conviction, et beaucoup ailleurs. Il y a aussi, par rapport au jeu, différents degrés de réalisation de la liberté. On peut par exemple se contenter de prendre un rôle tout fait, socialement bien défini, le cancre du fond de la classe, le chanteur à la mode "engagé", la mère de famille irréprochable, le séducteur de service, la jeune fille modèle, le garçon de café bien sûr. On peut aussi se contenter d'un canevas général comme support de sa créativité personnelle. On peut encore innover et construire à ses risques et périls un comportement nouveau, que les contemporains pourront avoir du mal à identifier, ce qui est le cas de nombres de grands créateurs. Mais dans tous les cas, savoir que l'on n'est pas cela.
Je suis cet être "dont l'essence est de n'être rien", ce qui provoque en moi ce que F. Alquié appellera "La nostalgie de l'être ". Pouvoir être comme une pierre, qui n'a rien à faire pour être ce qu'elle est, rien à faire pour continuer à l'être. Ou comme le chat assoupi au coin du feu, sans souci, comme hors de l'inquiétude du temps. J'aimerais parfois jouer à ne pas jouer, être sérieusement et réellement ce que je suis, bref à ne pas être libre. Mais, quoiqu'il en soit de sa nostalgie de l'être, "l'homme est condamné à être libre". Le refus, au demeurant impossible, de la liberté est au fondement de la mauvaise foi. La mauvaise foi, par exemple, de l'homme de pouvoir, du dictateur qui se regarde avec complaisance dans son miroir, habillé d'un grand uniforme, et qui tente plus ou moins vainement de faire croire aussi bien aux autres qu'à lui-même qu'il est vraiment ce à quoi il joue.
Engagement et responsabilité
"Pour la réalité humaine, il n'y a pas de différence entre exister et se choisir". La liberté, inscrite dans une situation, s'exprime par des choix, il faut donc s'engager, il n'y a pas de "neutralité" possible. "Je me choisis moi-même, non dans mon être, mais dans ma manière d'être". Choisir de ne pas choisir est encore un choix, un choix de mauvaise foi puisqu'il consiste à laisser faire les forces en présence en prétendant n'y être pour rien. On trouve déjà chez Pascal ce constat d'un engagement inéluctable : "Il faut parier; ce n'est pas volontaire, vous êtes embarqués.".
C'est encore une justification de mauvaise foi que de vouloir se dissocier de ses actes, par exemple en dissociant un prétendu "fond" de son être d'actes qu'on n'aurait commis que de manière inessentielle. Il est évidemment tentant parfois de ne pas vouloir se reconnaître dans ses actes, mais n'ayant pas d'être en soi, "un homme n'est que la somme de ses actes". Je suis donc responsable de ce que je suis, puisque je suis ce que j'ai fait. Mais j'en suis également responsable face aux autres hommes. Car à chaque fois que j'effectue un choix, c'est par là-même une manière d'être possible que j'offre à leurs yeux. "Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons (...).Ainsi notre responsabilité est beucoup plus grande que nous ne pourrions le supposer, car elle engage l'humanité entière".
Déréliction et angoisse
La déréliction est le sentiment du Dasein (être-là, nom donné par Heidegger à l'existence singulière concrète) d'être jeté dans un monde qui ne lui veut rien, et dans lequel il est abandonné à lui-même. C'est évidemment le prix de la liberté. Nous avons tendance à inventer des stratagèmes pour occulter cet abandon. Nous réveillons pour cela notre vieux fond d'animisme primitif, créant dans le monde des intentions à notre égard (par exemple, il est toujours rassurant intellectuellement et moralement de penser qu'une maladie ou autre fléau est une punition des dieux, au lieu d'admettre qu'il s'agit d'un phénomène qui, comme les autres, ne nous veut rien, ni bien ni mal). La notion de déréliction nous prive du coupable extérieur sur lequel nous aimerions tant nous dégager de notre responsabilité ( c'est la faute au destin, à la société, à l'ennemi diabolique qu'on aimera s'inventer...). C'est peut-être par cette notion de déréliction (reprise d'ailleurs du vocabulaire religieux), que l'existentialisme est le plus radicalement un athéisme.
Êtres dont l'essence est de n'être rien, jetés dans un monde qui ne nous veut rien, voués par la mort à un anéantissement aussi certain qu'indéterminé, nous sommes donc cernés par le néant. Quand on a peur, c'est de quelque chose : la peur est liée à un objet, même si cet objet est plus ou moins fantasmatique. Or ici, ce qui nous fait peur, ce n'est pas quelque chose, c'est ce rien, ce "néant (...) (qui) se dévoile comme composant l'être de cet existant" que nous sommes. On appelle angoisse cette peur qui n'est peur de rien, ou plus exactement qui est peur du rien. Pour Heidegger, l'angoisse est cette insécurité de l'existant devant le néant. L'angoisse est en quelque sorte le sentiment même de l'existence, elle est l'expérience privilégiée révélant ce néant qui est essence de notre être. Le refus de faire face à l'angoisse est au fond refus de la liberté, il mène nécessairement à un mode de vie "inauthentique", qui n'est pas sans rappeler des analyses de Pascal, notamment sur le "divertissement". Si Heidegger insiste sur la dimension ontologique de l'angoisse, Sartre la définira plus comme conscience de la responsabilité universelle où chacun de nos actes nous engage. "L'angoisse se distingue de la peur d'être au monde par ceci que la peur est peur des êtres au monde et que l'angoisse est angoisse devant moi".
Deux limites irréductibles de mon expérience : la mort et autrui
Mon existence se trouve confrontée à deux limites irréductibles, contre lesquelles ma liberté ne peut que buter et se révéler impuissante : l'existence d'autrui et la perspective de la mort. Dans les deux cas, il y a de plus quelque chose qui se dérobe de manière irrémédiable à ma connaissance. Autrui est trou noir dans mon monde, les autres sont ces faux objets impensables dans lesquels s’engloutissent d’autres mondes , et plus spécialement à la notion sartrienne du "regard d'autrui", dont l'analyse amène Sartre au fameux " L'enfer, c'est les autres". La mort intervient dans mon existence de deux manières très différentes. La mort des autres est une expérience que je peux avoir directement (voir quelqu'un mourir, voir un mort), alors que ma propre mort est par définition hors de mon expérience, puisque celle-ci suppose que je sois vivant.
Le même et l’autre : cet autre moi qui n’est pas moi
Autrui est autre chose qu'un objet posé là, occupant de manière neutre un peu d'espace, il est présence. Le mystère d’une présence, inquiétante et rassurante à la fois. Ailleurs dans le monde, parmi les objets qui le constituent, il y d’autres objets étranges, qui sont comme des sortes de trous dans la réalité. Il y a dans ces objets une présence qui est, tout comme moi visée du monde, mais qui n’est pas la mienne, et à laquelle je ne peux pas participer directement. Cet autre lieu inaccessible de visée qu’est l’autre est comme moi regard et pouvoir sur le monde, mais d’une manière que je ne peux pas clairement appréhender. C’est donc d’une certaine manière un autre monde, et pourtant c’est nécessairement le même que le mien. Autrui regarde ce monde, le juge, le ressent d’une manière qui me reste incompréhensible, avec parfois des décalages que je parviens à soupçonner, encore que parfois je puisse soupçonner quelque chose de proche de ma propre saisie. Il est aussi pouvoir d’action sur ce monde qui est mien, et ce éventuellement sans mon autorisation. Ressemblant et différent donc, dérangeant et troublant, sans que je puisse d’ailleurs clairement établir les limites entre la différence et l’identité.
Autrui est une présence qui ne m'est pas pleinement donnée dans ce qu'il est pleinement, je ne saisis sa volonté que négativement, dans la mesure où elle me résiste, sa vision me reste mystérieuse. Il y a toujours absence d'autrui, même dans sa présence. On parlera de son « aprésentation » : son corps mystérieux se présente comme « lieu » de ce qui n’a pas besoin de lieu. On peut à cet égard s'interroger sur l’ambiguïté de la sexualité, ou par exemple de la caresse, qui est un jeu dont l'un des buts est de maintenir l’autre comme objet enfermé dans l’intérieur de ses frontières, pour transformer en objet donné et rassurant ce qui n’est ni objet, ni donné. Une attitude paradoxale donc, la caresse vise un sujet en tentant de le délimiter comme objet. Autrui est un impensable autre sujet, cet autre même.
Le regard d'autrui
Je peux difficilement être objet pour moi-même (de même qu’il me faut un miroir pour me renvoyer mon image), il me faut l’attention d’autrui pour pouvoir me représenter moi-même comme une chose identifiable. Contrairement à la prétention que je peux avoir d'être le mieux placé pour savoir ce qu'il en est de moi, ma position même m'empêche de me juger objectivement, et même si les autres sont loin d'être impartiaux, ils n'en possèdent pas moins la position extérieure propice à mon observation. Il ne faut cependant pas trop que j'espère qu'ils me communiquent leur jugement (ni d'ailleurs que je sois prêt à l'entendre), car les rapports tant sociaux qu'intersubjectifs reposent sur du non dit essentiel. Mais peu importe, car leur appréciation se manifeste principalement (ou en tout cas de la manière la plus visible) par la manière dont ils autres me regardent ou ne me regardent pas, disons d'une manière plus générale de la manière dont ils se comporteront à mon égard. On parlera donc du rôle constitutif du « regard d’autrui ». Ce regard d’autrui m'est nécessaire : « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même » (Sartre). Mais il est aussi très contrariant, car souvent en désaccord avec mes illusions sur moi-même, et ce, sans recours possible, ce qui le rend objet de crainte, d’angoisse. Cette dépendance absolue peut être ressentie de manière très pesante, très négative : « L’enfer, c’est les autres » dira Sartre, qui illustrera notamment ce slogan dans sa pièce de théâtre Huis-clos.
Il convient toutefois de se souvenir que, selon l'existentialisme, je reste le seul détenteur de ma liberté. Ce qui signifie que je reste pour moi-même le responsable de mon propre sort. Que les autres soient une limite irréductible qui me contrarie et me fait souffrir, n'est pas une raison suffisante pour le rendre coupable de mes malheurs, comme la tendance naturelle m'y inciterait. Notamment en ce qui concerne l'usage de ma liberté, l'ennemi n'est pas nécessairement l'autre.
Un monde intersubjectif
Le fait premier, c’est la pluralité des consciences, et cette pluralité est réalisée sous forme d’une double et réciproque relation d’exclusion » (Sartre, L’Être et le Néant). Husserl, dans ses Méditations cartésiennes, montre comment le "je pense" renvoie d'abord à un " nous sommes". Il reprend le concept de monade, provenant de Leibniz : les autres " (...) sont des monades qui existent pour elles-mêmes de la même manière que j'existe pour moi. Mais alors elles existent aussi en communauté, par conséquent (...) en liaison avec moi, ego concret, monade.". Les consciences reconnaissent respectivement la coexistence d'autres consciences, qui visent chacune un monde qui est le même monde, et c'est cela qui constitue l'intersubjectivité. Le monde n’est donc vraiment monde, et non simple représentation solipsiste, que parce qu’il y a cette emprise irréductible d’autrui dessus. La " (...) pénétration intentionnelle d'autrui dans ma sphère primordiale" est " une communion effective, celle qui est précisément la condition transcendantale de l'existence d'un monde, d'un monde des hommes et des choses." (Méditations cartésiennes).
Dans sa Lettre sur l'humanisme, Heidegger expose cette curieuse dictature qu'est celle de l'opinion publique. La peur de la liberté peut amener à vouloir faire comme les autres, non tel ou tel autre en particulier, mais comme les autres en général. Ce passage d'autrui aux autres en général caractérise la "dictature du on". Le "on" est foncièrement inauthentique. Pseudo-sujet de la quotidienneté, il est l'indistinction d’une moyenne qui dégénère en norme. Il provoque nivellement et élimination de toute originalité véritable. Cet l'apothéose de l'irresponsabilité, puisque chacun étant l'autre, personne n'est plus lui-même. (voir le chapitre sur la république, la dictature de la majorité.
Le scandale de la mort
La mort d'autrui fait partie de mon expérience, elle n'en est pas moins à la fois scandaleuse et partiellement incompréhensible. Scandaleuse, car cet anéantissement toujours immérité réduit à rien tout un monde de signification qu'était la vie de cet autre, rendant en quelque sorte vain de l'avoir vécu : " Il est inconcevable que ce qui existe une fois dans toute la force de la réalité doive jamais être réduit à rien, et n'existe plus ensuite pendant un temps infini" (Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation ). Partiellement incompréhensible, car si je comprends bien ce qu'il advient du corps (dont les composants se désagrégent et se recomposent dans la nature, selon le principe classique : rien ne se perd, rien ne se crée), ce qu'était vraiment l'autre, en tant que personnalité, intériorité, en tant que pensée, sentiments, vécu, disparaît purement et simplement. Pour parler en termes classiques, la mort est disparition "corps et âme", celle du corps pouvant être comprise, celle de l'âme restant un mystère incompréhensible. La mort de l'autre garde donc un aspect irrationnel. Scandaleuse et irrationnelle, marque la plus manifeste de notre finitude, la mort reste (bien plus que le sexe) le tabou de nos sociétés. Ou on en fait une abstraction insignifiante (on meurt à tours de bras sur les écrans de télévision), ou on en fait un sujet malsain ( pas trop bien venu comme sujet de conversation...).
Ma mort propre est tout à fait impensable sans cercle vicieux, car quelque soit l'objet de ma pensée, cet objet pensé me suppose vivant comme sujet pensant. Les mises en scène fantasmatiques de sa propre mort relèvent toujours du paradoxe, pour ne pas dire de la mauvaise foi. Ainsi le jeune enfant (mais on peut transposer avec l'adulte préparant son testament...), qui rêve de sa propre mort pour voir ses vilains parents bien punis d'avoir été méchants avec lui, n'y trouve la satisfaction escomptée que parce qu'il se voit regarder leur désarroi devant sa mort, il lui faut donc se représenter mort et vivant à la fois. C'est ce paradoxe qui va permettre à Épicure de dire que "la mort n'a rien d'effrayant". Tant que je suis vivant, c'est que je ne suis pas mort, et quand je serai mort, je ne le saurai pas. "La mort n'a, par conséquent, aucun rapport ni avec les vivants, ni avec les morts, étant donné qu'elle n'est rien pour les premiers et que les derniers ne sont plus". (Lettre à Ménécée).
La perspective de la mort
Ce n'est pas seulement que nous sommes mortels, c'est que nous le sommes n'importe quand, c'est-à-dire tout de suite. Car un homme est assez vieux pour mourir du jour où il est né. Nous sommes jetés au monde pour y mourir, et il le sait : le Dasein est "être pour la mort", selon l'expression de Heidegger. C'est quelque chose que nous savons bien, mais nous n'y croyons pas vraiment. Personne ne croit vraiment qu'il est mortel dans l'instant, la mort est toujours pour plus tard, et seul le présent existe. Ainsi chacun se donne, plus ou moins secrètement, un délai minimal de survie, qui certes tend à se réduire avec l'âge, mais reste comme une durée irréductible de dénégation
La perspective de la mort est aussi certaine qu'indéterminée. Je peux toujours faire un plan de vie, comme certains font des plans de carrière, mais je suis mortel à tous moments, sans aucune garantie. On pourrait donc dire que cette menace perpétuelle rend tout projet absurde. Mais d'un autre côté, ce temps qui m'est compté sans que j'en puisse connaître le décompte, est aussi ma motivation principale pour agir maintenant. Car pourquoi me fatiguerais-je aujourd'hui, si j'avais la garantie qu'il me reste autant de temps qu'il en faudra ? Pourquoi passer le bac cette année, plutôt que l’année prochaine, ou dans dix ans ? Parce qu’il y a la notion du « trop tard ». Celle-ci n’a de sens que parce qu’il ne reste qu’un certain temps d’ici la mort. Il n’y aurait aucune raison de faire le jour même ce qu’on pourrait remettre au lendemain, si les lendemains n’étaient pas comptés. Autrement dit, c’est la perspective de la mort qui est la motivation ultime de l’action.
La mort de l'être proche demande cicatrisation. C'est ce que l'on appelle le travail du deuil. La vie peut paraître insensée à continuer après la mort d'un être cher, et il arrive que certains mettent fin à leur vie pour cette raison. Mais le plus souvent, comme le dit l'expression populaire, la vie continue, et le désespoir, s'il peut garder sa vivacité initiale dans l'inconscient, finit par s'émousser dans le conscient. Avec le temps, même si l'on peut ressentir comme cruel de l'avouer, on finit généralement par par retrouver le cœur léger et la joie de rire. Pour comprendre en quoi consiste cette cicatrisation, il faut se poser lucidement la question : que perd-on principalement quand on perd l'autre ? Lui-même, tel qu'en lui-même, c'est un peu douteux, dans la mesure où il ne m'a jamais été tout à fait donné en tant que tel. Mais cet autre, s'il m'était si proche, c'est qu'il était partie de ma vie, c'est qu'il était l'un des éléments (éventuellement l'un des principaux) sur lequel je tentais de me constituer une identité . Le perdant, c'est une partie de ma construction propre qui se trouve fragilisée, c'est mon identité qui se trouve menacée. Le travail de deuil est peut-être avant tout un travail de restructuration de soi-même : pleurant l'autre, c'est d'abord sur moi-même que je pleure.
La mort comme nécessité interne de la vie
Au niveau de l’espèce, il faut bien que les anciens meurent pour le rajeunissement de la vie, même si cette idée ne nous console pas de mourir. Mais il en est de même pour le corps de l’individu. Si nous parvenons à continuer à vivre, c'est par le renouvellement des cellules, qui fait que des cellules mortes laissent la place à de nouvelles. En y réfléchissant, il en est de même pour l’esprit, il faut liquider ce qui en soi fait obstacle à son propre devenir. Ainsi avons-nous dû (plus ou moins) liquidé notre enfance pour devenir adolescents puis adultes. Acquérir une connaissance, c’est liquider une ancienne croyance et, comme le dit Bachelard, la vérité se constitue par rectification des erreurs. Vivre, c’est donc perpétuellement mourir à soi-même.
La vie n'est pas de l'ordre de l'être qui pourrait continuer à être simplement. Rester indéfiniment ce que l'on est, ce serait échapper au temps, ce serait être éternel, ce qui est, dit Platon dans Le banquet, la manière d'être du divin. La vie ne peut vivre qu'en se renouvelant. "C’est ainsi que tout être mortel se conserve, non qu’il soit jamais exactement le même, comme l’être divin, mais du fait que ce qui se retire et vieillit laisse la place à un être neuf, qui ressemble à ce qu’il était lui-même. Voilà par quel moyen, Socrate, dit-elle, le mortel participe à l’immortalité, dans son corps et dans tout le reste." Le désir a donc fondamentalement à voir avec la mort. La vie veut vivre, elle voudrait être éternelle, elle ne peut que tenter de se perpétuer, et pour cela elle doit se renouveler sans cesse. Le désir d'éternité se manifeste alors en désir de procréation. La mort peut donc être considérée comme ce processus interne par lequel la vie continue à vivre en se renouvelant.
Suggestions de lectures
* Sartre, L'existentialisme est un humanisme.
* Heidegger, Qu'est-ce que la métaphysique ?
* Platon, Le Banquet (intervention de Diotime rapportée par Socrate).
* Lucrèce : De la nature
* Épicure : La lettre à Ménécée.
* Husserl, Méditations cartésiennes.
Rubrique "à éviter"
* Pensant jouer les disciples de Sartre (style L'être et le néant) ou de Heidegger, se laisser aller au jargon "pseudo-normal-sup". Garder en vue que l'expression la plus claire est souvent la meilleure.
* Sur la mort, les propos larmoyants ne peuvent, comme ailleurs, tenir lieu de raisonnement.
Questions de révision et d'approfondissement
Pour que ces questions soient efficaces, il ne suffit pas de les survoler en se disant "ça, je saurais y répondre", ou à l'inverse "je n'y arriverai jamais". Il faut tenter d'y répondre coûte que coûte, même pas très bien, le mieux étant devant témoin (mais si...). Car c'est très différent de faire et de croire pouvoir faire. Ca peut se jouer à charge de revanche, ou encore alternativement.
* Pourquoi Kant refuse-t-il "la preuve ontologique" de Descartes ?
* Quels sont, selon Kant, les rôles respectifs de la sensibilité et de l'entendement ?
* Pourquoi peut-on dire de l'existence qu'elle est injustifiable ?
* Pourquoi Kierkegaard dit-il qu'il ne peut y avoir un système de l'existence ?
* Qu'est-ce que la facticité ?
* Que signifie que pour l'homme, l'existence précède l'essence ?
* Expliquez la devise de Montaigne : "Il faut jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté."
* Peut-on concilier les notions de dieu et de liberté ?
* Arguments pour et contre l'existence d'une nature humaine.
* Quel rapport y a-t-il entre liberté et absurdité ?
* Commentez cette phrase de Henrik Ibsen (dramaturge norvégien du XIXème siècle) :
"Nous ne ressortissons d'aucun tribunal. C'est donc à nous de juger nous-mêmes."
(Rosmersholm, Quatrième acte).
* Y a-t-il contradiction entre affirmer la liberté de l'homme et reconnaître qu'il naît dans une situation qu'il n'a pas choisie ?
* Quel est le sens de l'exemple du garçon de café dans L'être et le Néant de Sartre ?
* Qu'est-ce que la mauvaise foi ?
* Peut-on ne pas choisir ?
* Est-il justifié de dire qu'un homme n'est que la somme de ses actes ?
* De quoi sommes-nous responsables ?
* En quoi la notion de sincérité peut-elle faire problème ?
* Qu'est-ce que la déréliction ?
* Quelle différence peut-on faire entre la peur et l'angoisse ?
* En quoi peut-on tenir l'angoisse pour un sentiment métaphysique ?
* Comment l'âme d'autrui m'est-elle donnée ?
* Pourquoi peut-on parler d'incommunicabilité entre les hommes ?
* En quoi la notion de comportement est-elle, chez Merleau-Ponty, un refus de la distinction entre l'esprit et le corps ?
* Peut-il y avoir une saisie directe d'autrui ?
* Puis-je être objet pour moi-même ?
* En quoi autrui est il un objet inachevé ?
* Que signifie la célèbre formule d'un poète : "Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change" ?
* Pourquoi peut-on dire que la présence d'autrui reste quand même une absence ?
* En quoi l'existence d'un autre sujet fait-elle problème ?
* En quoi la résistance d'autrui m'est-elle nécessaire ?
* Quelle est, selon l'existentialisme sartrien, le rôle du "regard d'autrui" ?
* Pourquoi prétendre que "l'enfer, c'est les autres" ?
* Peut-on aimer quelqu'un en se méprisant soi-même ?
* Qu'entend-on par intersubjectivité ?
* En quoi la pluralité des consciences est-elle le fait premier ?
* Qu'est-ce que l'inauthenticité du on ?
* Que pleure-t-on quand on pleure la mort de quelqu'un ?
* Quel peut être mon rapport à ma propre mort ?
* En quoi la mort est-elle nécessaire à la vie ?
* Qu’est-ce qui dans la mort peut sembler irrationnel ?
* Commentez cette phrase de Gustave Flaubert : "Il y a toujours, après la mort de quelqu'un, comme une
stupéfaction qui se dégage, tant il est difficile de comprendre
cette survenue du néant et de se résigner à croire." (Madame Bovary, ch. 9)
* En quoi la perspective de la mort peut-elle être considérée comme moteur de la vie ?
* En quoi la mort reste-t-elle relativement de l'ordre du tabou ?
Pour en savoir plus
* Existence et choix : trente secondes pour un texte d'inspiration sartrienne de Raoul Vaneigem
* Travaux Pratiques Intempestifs sur Autrui et sur la Mort
* L'homme et le coupe-papier : texte de Sartre.
Pour changer de registre
 | Par l'auteur de cette page, quelques textes un peu moins éducatifs, et qui néanmoins valent le détour : les recueils de nouvelles. |
màj 220629 |
Retour |