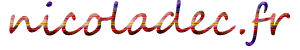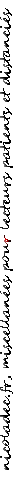|
option |
|
|
Des choseset de leurs rapportsPrésentation de huit questions quodlibetiques V Contre les raconteurs d'histoire : si dicis...,.frustra. Les mots ne renvoient pas nécessairement à des choses, ils ne « supposent » pas nécessairement pour quelque chose d'existant absolument. Deux siècles plus tôt, l'abbé de Saint-Gildas remarquait déjà : « Lorsqu'on traite, en effet de la signification naturelle des mots, il s'agit tantôt des mots eux-mêmes, et tantôt des choses, et la confusion est fréquente entre les deux domaines » 1. Inlassablement, Guillaume d'Ockham tente de lever cette confusion. Moins proprement « nominaliste » qu'Abélard, aux choses il opposera les concepts plutôt que les mots. Etat d'esprit que l'on retrouvera chez maints de ses compatriotes 2, il ne semble guère priser que l'on se paie de mots. Il n'y a pas de « où », « quand », ce ne sont que des adverbes- il n'y a pas d' « action », ce n'est que manière de parler des choses agissantes en tant qu'elles agissent, il n'y a pas de « passion », ce n'est que manière de parler des choses qui pâtissent en tant qu'elles pâtissent. De même en va-t-il ici pour la position, la distance, l'habitus, la figure, la création, la conservation, la proximité des causes, l'unité et l'ordre de l'univers. Si le « réalisme » modéré et ingénieux semble encore plus que d'autres l'ennemi d'Ockham, ce n'est pas seulement qu'il s'agit d'une lutte qui lui est contemporaine, c'est sans doute également que le Docteur subtil 3 est un fin conteur, celui qui raconte les plus belles histoires, sensible qu'il est aux déficiences du « réalisme » grossier, « Ne pas se raconter d'histoire », recommande Louis Althusser 4. Duns Scot élaborera par exemple la notion d'une distinction formelle 5, c'est-à-dire qui ne soit ni réelle, ni de raison, mais de forme. Mais où est ce qui n'est ni réel, ni conceptuel ? « Il y a distinction réelle entre les choses réelles, distinction de raison entre les êtres de raison », résume Alféri 6, mais où trouver autre chose, et surtout à quoi bon inventer autre chose ? Si vous dites que le feu..., c'est en vain, même si l'on y rajoute une quelconque subtilité concernant une hypothétique subsistance sous une forme épisodique. La méfiance méthodologique d'Ockham, avec toute sa portée ontologique se résume dans ce balancement : si dicis..., frustra 7. |
|
L'équivocité de 1'un
Quel « un » est un mirage ? L'« un » du monde ou l'« un » de la chose? Une chose est-elle réellement « une » chose ? Ou n'est-elle qu'une unité agrégative, comme l'entend Duns Scot «(...) l'unité de la chose n'est pas requise, mais seulement une unité d'ordre et d'agrégation. » 8 La question renverrait alors à un point qui n'est pas directement l'objet de ces extraits, l'acte d'intuition, dont Ockham traitera par ailleurs. Pour Duns Scot, l'intuition du singulier n'est pas première : « (...) on peut donc conclure qu'aucun singulier n'est le premier objet de cette puissance [sensitive], mais que son premier objet est quelque chose (qui est) en plusieurs singuliers, et qui est d'une certaine manière universel » 9. A l'opposé, se fondant sur l'existence ou la non-existence que nous pourrions qualifier de « matérielle » de la chose singulière, Ockham la tient pour ce qui est véritablement « un ». Mais cette position n'est pas simple affaire de principe : c'est par une réduction strictement logique, telle qu'opérée dans ces questions quodlibetiques, qu'inéluctablement, on est contraint de tenir la chose absolue pour ce qui est au lieu de ne pas être, ce qui constitue proprement le « un » . L'être est l'alternative réelle de ne pas être, le ne pas être est l'épreuve de l'être, ce qui ne saurait être dit des « choses » universelles.
Aussi l'un n'est il pas ici l'unique. Car si l'« un » est dit du monde, l'« un » est alors le tout, I'« un » est alors l'unique, et l'unique ne renvoie qu'à lui-même, il ne se conçoit pas sur fond de son inexistence possible, il ne renvoie pas à zéro. Sûr de ne pouvoir être ramené à zéro, ne renvoyant qu'à lui-même, le « un » glisse à l'unique. Ce qui veut dire aussi, son fond d'inexistence possible étant estompé, que ce qui existe n'existe plus en plein relief L'unique dans sa nécessité repliée sur lui-même, du genre causa sui, a finalement bien moins d'existence que I'« un » facultatif de la chose singulière. Si l'« un » au contraire est celui de cette chose-ci, il est un parmi d'autres uns, doublement contingent, conséquemment d'autant plus existant. L'énumération d'une part, le dénombrement, relativise la nécessité de chacun (de chaque « un »), dans le caractère interchangeable d'un décompte du nombre « cardinal » 10. Chacun d'autre part est l'alternative de sa non-existence. L'existence du monde renvoie à une existence nécessaire et unique, ce qui signifie nécessaire d'abord, donc existante. L'existence des choses séparées renvoie à une existence contingente et multiple, ce qui signifie existant d'abord, constituant ensuite, et par le fait même, un monde, et donc un ordre.
Contre la résorption de la multiplicité : un monde ouvert
« Des choses jetées là au hasard, le plus bel arrangement, ce monde-ci ». Nous avons déjà cité ce fragment d'Héraclite, donné par Théophraste dans sa Métaphysique 11. Les traducteurs et commentateurs précisent alors : « Bien qu'il soit bâti avec des matériaux disjoints et sans lien, assemblés par fantaisie (... ), l'arrangement qu'il présente vaut par le jeu de la polarité qui combine le disparate et l'ordre ». Il ne s'agit pas d'attribuer à Ockham des positions et des préoccupations qui ne sont pas les siennes, mais de remarquer qu'il n'est pas le premier penseur à concevoir un monde d'existences disjointes, et que d'autres ont trouvé aussi que cela ne ruinait pas pour autant l'idée d'un ordre de ces existences, et que le monde n'en devenait pas pour autant une horrible chose dissolue.
Dans l'espace, il y a des choses, chacune existant séparément. Ces choses sont susceptibles d'être mues par un mouvement local. De cela résulte un ordre, et l'absence de toute unité a priori englobant cette diversité , bien loin de la compromettre, la préserve au contraire. Au fond, dès que que l'on estime que tout provient d'un « Un », le déploiement du monde ne peut plus guère être perçu que comme un épiphénomène superfétatoire, un événement finalement regrettable. La nostalgie de l'un est alors logiquement et ontologiquement la plus forte. Le but du sage ne peut plus être que le fantasme de la grande résorption, comme on pourra l'identifier dans des philosophies aussi différentes que celles de Plotin 12ou de Schopenhauer 13. Pardonnerons-nous au monde d'être pluriel, et de ne posséder aucun caractère définitif ? C'est l'enjeu fondamental du retour ockhamien à la chose singulière. Par le mouvement local, l'agencement est toujours sous réserve de réagencement : les fenêtres ne sont pas nécessairement vouées à être définitivement ouvertes ou fermées, pas même à l'être alternativement selon des règles fixes.
Quant à l'idée d'un meilleur des mondes possibles, elle est tout de même étrange. Car s'il faut, par raison suffisante, qu'ait été créé le meilleur des mondes possibles, cela semble tout de même impliquer qu'il est tout compte fait le seul possible, et donc pas le meilleur parmi d'autres : il est simplement celui qui existe. Sans vouloir tomber dans la caricature malveillante et volontairement naïve d'un Voltaire, un simple coup d'œil innocent nous le dévoilerait plutôt comme le plus improbable des mondes. Sa force ou son éventuelle beauté ne proviennent pas de ce qu'il serait le meilleur, il n'y a pas d'autre candidat en lice, mais d'être celui qui existe, ce qui n'exclut d'ailleurs pas d'en saisir la pluralité. L'essentiel est dans l'acte créateur, et Dieu, répéte Ockham, peut faire que ceci existe sans cela.
Pérennité d'Ockham
L'actualité, ou plus judicieusement la pérennité d'Ockham, est soulignée de nos jours, spécialement en ce qui concerne ses aspects logiques et analytiques. On pense à lui par exemple quand Gilbert Ryle, dans The concept of mind, nous parle de l'homme qui, visitant l'université, et en apercevant bien les bâtiments, se demande, à part ces bâtiments qui existent réellement, où peut bien être ce qu'on appelle l'université 14. Ainsi lit-on, en présentation de couverture du livre de Claude Panaccio, Les mots, les concepts et les choses 15 : « La vieille question du nominalisme se retrouve au cœur de la philosophie analytique contemporaine : comment le discours et la pensée peuvent-ils s'articuler à un monde extérieur exclusivement peuplé de choses singulières? ».
Mais ici, il nous a paru que l'ontologie ockhamienne n'est pas seulement un point de départ, qu'on jugerait éventuellement médiocrement élaboré, et sur lequel viendrait se développer l'essentiel, qui serait la théorie sémantique. L'ontologie de Guillaume d'Ockham semble au contraire, et notamment dans ses implications politiques inévitables, une bonne lecture pour notre époque.. .
NOTES
1. Pierre Abélard (1079-1142), qui poursuit :« C'est une tâche essentielle, pour les logiciens comme pour les grammairiens de prendre garde à ces confusions, car les équivoques verbales ont induit en erreur beaucoup d'autres qui ont mal distingué le caractère propre de l'application des noms aux objets ou qui n'ont pas remarqué la confusion abusive des mots et des choses » (Logique, première partie de la Logica ingredientibus, trad. M. de Gandillac).
2. Par exemple, trois siècles plus tard, David Hume (1711-1776) : « quand nous avons souvent employé un terme, même sans lui donner un sens distinct, nous sommes portés à imaginer qu'une idée déterminée y est annexée » (Enquête sur l'entendement humain, section Il, trad. A. Leroy).
3. Jean Duns Scot, dont on ne peut d'ailleurs que reconnaître la fertilité du travail conceptuel, fournissant un effort d'élaboration remarquables et qui servira de repoussoir trop facile pour les railleries de Rabelais.
4. Cf. L. Althusser. L'avenir dure longtemps, ch. XVIII. Et un peu plus loin (p.2 10): « et je ne connais guère de forme plus profonde du matérialisme que le nominalisme ».
5. Distinction d'ailleurs reprise de manière ambiguë par Ockham. Cf. note 3, page 60.
6. Cf. P. Alféri, ibidem, p. 49.
7. Exemple : question 5, fin de la troisième preuve : « Si dicis quod (..); igitur frustra ponitur talis parva res ».
8. Collatio 24, Le concept d'étant est-il absolument univoque à Dieu et à la créature ? », in recueil Sur la connaissance de Dieu et 1'univocité de l'étant, trad. 0. Boulnois.
9. Il poursuit : « En effet, bien que tout acte de sentir porte seulement sur du singulier, il ne porte pas sur le singulier comme sur son objet premier » (Duns Scot, Quaestiones subtilissimae in Metaphysicam, 1, q, 6, trad. A. de Libera).
10. C'est-à-dire : un, deux, trois, trois, par opposition au nombre ordinal : premier, second troisième, etc.. Le décompte binaire serait ontologiquement plus imagé : passer de 2 à 3 et à 4 donne l'idée d'une transition ou l'épaisseur d'être de chaque chose s'amenuise dans sa coexistence au sein des autres, dans son passage au sein des autres - on glisse alors dans l'ordre de la génération. La traduction binaire (10, 11, 100) restitue son épaisseur d'existence à chaque chose comptée dans l'alternative du zéro/un. Le courant passe ou ne passe pas.
11. Cf. note 1, p. 27.
12. « C'est pourquoi on remonte toujours à l'Un. En chaque cas, il y a un Un particulier auquel il faut remonter; tout être se ramène à l'Un qui lui est antérieur (et non pas immédiatement à l'Un absolu), jusqu'à ce que d'Un on arrive à l'Un absolu, qui ne se ramène plus à un autre » (Plotin, Ennéades, 111, 8, De la contemplation, trad. E. Bréhier).
13.« Ainsi, le fait, pour la volonté, de se supprimer elle-même consiste, pour elle, à rejoindre son en-soi le plus profond. C'est dans le renoncement et presque dans l'inexistence qu'elle est définitivement une » (M. Piclin, Schopenhauer, p. 103).
14. « A foreigner visiting Oxford or Cambridge for the first time is shown a number of colleges, libraries, playing fields, museums, scientific departments and administrative offices. He then asks 'But where is the University ? I have seen where the members of the Colleges live, where the Registrar works, where the scientists experiment and the rest. But I have not yet seen the University in which reside and work the members of your University' » (Gilbert Ryle, The concept of mind (1949), pages 17-18).
15. Sous-titré: « La sémantique de Guillaume d'Occam et le nominalisme d'aujourd'hui » (1991).
chapitre précédent
traduction
sommaire ockham
Pour changer de registre
 | Par l'auteur de cette page, quelques textes un peu moins éducatifs, et qui néanmoins valent le détour : les recueils de nouvelles. |
màj 220703 |
Retour |