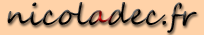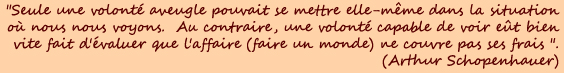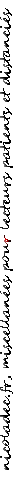|
option |
|
|
|
Survoler les mots en bleu avec la souris L'éthique, un problème incontournable |
Si l'antiquité liait de manière intime la question morale (l'éthique) au problème de la connaissance (pour Platon, par exemple, le mal est toujours une affaire d'insuffisance de savoir), l'époque moderne tend à dissocier les deux domaines, la connaissance d'un côté, la morale de l'autre. La première relève pour Kant de la raison théorique, et sera étudiée dans La critique de la raison pure, la seconde de la raison pratique, qui fera l'objet de La critique de la raison pratique. Dans cette optique, on peut considérer, compte tenu notamment de l'extrême développement des connaissances contemporaines, qu'il n'est pas nécessairement vital d'être au fait de tel ou tel domaine du savoir. On peut sans doute vivre sa vie de manière très intense sans s'être jamais soucié de la relativité généralisée ou de l'épistémologie des mathématiques, même si ces domaines sont riches d'enseignements. On peut donc admettre, dans certaines limites (!), un certain aspect facultatif de la connaissance. Il n'en va pas de même pour la question morale, qui est pour chacun de nous une question obligatoire. |
|
Se pose donc obligatoirement pour tout le monde cette question morale. L'amoralisme (conception de la vie étrangère à toute considération de valeur morale) est une attitude assez fictive. Les pires criminels, la mafia, ont leurs règles de conduite, sans doute condamnables, mais néanmoins souvent très strictes. L'interrogation éthique est fondamentale pour chacun, qu'il accepte ou non de le reconnaître, car il y va du sens de sa vie.
Il ne peut pas y avoir de "science morale"
Comment fonder les règles nécessaires à l'usage de notre liberté ? Pour établir des règles de jardinage, on part d'une longue expérience de la manière dont les plantes fonctionnent, et on en déduit ce qu'il est judicieux de faire et de ne pas faire. On pourrait alors penser que, de manière similaire, il faille partir de la connaissance que nous pouvons avoir du comportement humain, pour en dégager les règles de conduites les plus judicieuses. C'est ce que préconise la démarche empirique, que l'on retrouvera à l'oeuvre principalement dans la tradition "anglo-saxonne", par exemple chez David Hume ou Ayn Rand. Selon Kant, cette démarche résulte d'une confusion. On ne peut pas à la fois vouloir établir des règles rendues nécessaires par la réalisation de la liberté, et prétendre les fonder sur des lois du comportement contradictoires avec l'existence de la liberté.
Vouloir fonder la morale sur la connaissance relève d'une confusion de plans. Il faut en revenir à cette idée, établie par Kant dans La critique de la raison pure, que toute connaissance est et n'est que phénoménale (c'est-à-dire que, ne pouvant se constituer qu'à travers nos moyens de connaissance, elle ne peut aucunement atteindre la chose-en-soi. La liberté n'est pas un phénomène, elle ne peut être objet d'expérience, il n'y en a pas de connaissance possible. Elle ne relève pas de la raison théorique, mais d'un exercice de la raison pratique.
Il n'est pas plus possible, selon Kant, de tenter d'établir des règles qui se donneraient pour objectif d'atteindre le bonheur. Le bonheur, notion d'ailleurs fragile et subjective, n'est pas une situation qui résulterait de règles. Le bonheur vient, ou ne vient pas, mais après. De plus, le problème de la liberté n'est pas en soi de rechercher le bonheur, et l'on peut même concevoir que certaines conceptions du bonheur reposent plutôt sur une méfiance, voire sur un refus de la liberté. Si donc le problème moral est celui de la liberté, il ne peut être fondé sur la notion de bonheur. On peut donc dire à la fois que la recherche du bonheur n'est pas en soi une démarche morale, et que l'intention morale ne produit pas nécessairement le bonheur.
La liberté est autonomie de la volonté
Être libre est souvent défini par "faire ce que je veux". Cette définition pourrait à la rigueur être recevable, mais à condition d'en bien préciser le sens et de lever l'ambiguïté fondamentale qu'elle comporte. Le premier point important est l'utilisation du verbe "vouloir" : il faut qu'il y ait volonté pour que l'on puisse parler de volonté. La volonté est faculté de choisir et décider. Un être qui ne serait pas doué d'une telle faculté ne pourrait dons être libre. Mais il faut remarquer que la volonté peut connaître bien des degrés différents. On appelle par exemple velléité cette forme inférieure, que nous connaissons tous très bien, et qui consiste à vouloir faiblement ou fugacement, sans vraiment s'inquiéter de ce qu'il faudrait faire pour réaliser. Mais surtout, il faut s'interroger selon quelles modalités s'effectuent ces décisions.
Le problème principal réside dans le statut exact de ce "je" par rapport à son prétendu vouloir. Que "je" soit le sujet grammatical de "veux" ne suffit pas à établir qu'il en soit le sujet effectif. On peut poser la question de deux manières : qu'est-ce qui décide vraiment quand je dis que je veux, ou, quand je veux, ai-je réellement voulu vouloir ? Pour prendre un exemple, le fumeur veut fumer, mais tout en "voulant" fumer, il peut très bien vouloir très fortement ne plus le vouloir. Car qui ou qu'est-ce qui décide ici ? Il y a peut-être eu un commencement où le fumeur a décidé, mais ensuite ce n'est plus qu'un "drogué", coincé entre plusieurs déterminismes : une accoutumance à la nicotine, une fixation orale forte, l'emprisonnement dans un besoin d'identification sociale, etc. Quand il veut, il ne veut pas forcément vouloir, et au fond il ne décide rien. On est
donc légitimement amené à distinguer deux cas de figure. Si "je" n'est que le mandataire de déterminismes qui s'imposent à sa volonté, on parlera d'hétéronomie de la volonté, ce qui signifie que la règle de l'action vient d'autre chose que de la volonté. Si au contraire on peut avoir la certitude, par un moyen qui reste à déterminer, que la volonté est à elle-même sa propre règle, et que c'est bien "je" qui a voulu vouloir, on parlera d'autonomie de la volonté, autonomie signifiant qui est à soi-même sa propre règle. La définition "faire ce que je veux"manque donc d'une précision essentielle : à condition que ma volonté soit autonome. On définira donc la liberté comme autonomie de la volonté.
Si la définition est claire, elle n'en pose pas moins dans la pratique une grande difficulté. Car non seulement rien ne nous assure que nous soyons en état de reconnaître qu'il y ait ou non autonomie de la volonté, mais de nombreuses expériences nous révèlent qu'il existe de grandes illusions en ce domaine. Spinoza dénonçait déjà cette illusion de la liberté : "L’expérience elle-même n'enseigne donc pas moins clairement que la Raison que les hommes se croient libres pour la seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés." ( Éthique ). "Je veux" est par exemple souvent là à la place de "je désire", or le désir est plutôt un résultat de mon histoire et de ma situation, qu'un décret de ma volonté. Cette confusion très forte entre vouloir et désirer, l'ignorance courante dans laquelle je suis de ce qui me détermine à agir, font qu'il faut se méfier au plus haut point du "sentiment" de liberté. Ce sentiment n'est souvent qu'une ignorance, au mieux involontaire, mais souvent de mauvaise foi, des déterminismes en jeu. On arrive donc paradoxalement à ce que la revendication de liberté (je fais ce que je veux) est souvent au contraire une forme voilée de la volonté d'esclavage. Ce qui amène à poser, comme l'ont fait La Boétie, Spinoza, Lyotard et quelques autres le problème de la servitude volontaire.
L'impératif catégorique
Comment peut-on s'assurer de l'autonomie de la volonté, s'il ne suffit pas de se sentir libre pour l'être vraiment ? Il faut alors une règle qui permette
d'établir incontestablement cette autonomie. On peut trouver cette règle en réfléchissant à ce que sont l'autonomie et l'hétéronomie. Si ce que je fais
relève de l'hétéronomie, cela signifie que ce sont les forces en présence alentour qui déterminent ma volonté, donc le principe de mon action dépend de
la situation particulière. Pour qu'il y ait autonomie, il faut donc à l'opposé que le principe de mon action ne dépende pas de telle ou telle situation, donc puisse être valable pour toute situation. Autrement dit, il faut qu'en même temps que je veux, je puisse vouloir que cela soit universalisé. C'est ce qu'exprime la première forme de l'impératif catégorique : " Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle " ( Kant).
On appelle impératif toute décision de la volonté prenant la forme d'une obligation, que l'on pourra donc exprimer par le terme de devoir. Mais il y a deux sortes d'impératifs. Certains sont liés à une fin particulière, et n'ont de valeur que par rapport à cette fin (si tu veux rester en bonne santé, tu dois éviter de fumer). Cette première sorte s'appelle impératif hypothétique, puisque l'impératif (tu dois éviter de fumer) ne se justifie que dans le cadre d'une certaine hypothèse (si tu veux rester en bonne santé). Il ne s'agit pas alors de morale, mais de ce Kant appelle de la prudence. D'autres impératifs sont inconditionnels, ce qui signifie qu'ils ne dépendent pas de telle ou telle hypothèse, mais sont une exigence absolue de la liberté. On parle alors d'impératif catégorique. Si "Tu ne tueras pas" se justifie par "si tu ne veux pas aller en prison", il s'agit d'un précepte de prudence, donc d'un impératif hypothétique. Si par contre il se justifie par le respect inconditionnel de la vie d'autrui, il ne dépend alors d'aucun "si", c'est un impératif catégorique. Quand la conduite est simplement justifiée par la prudence, il ne s'agit pas de liberté, on n'est pas alors dans l'ordre de la moralité.
La personne et le respect
Peut-on donner la mort ? La question n'est pas simple et reste polémique. On a pu admettre, selon les sociétés et les époques, qu'il était légitime de le faire à la guerre, ou au terme d'une condamnation, ou par légitime défense, ou par euthanasie. Selon Kant, le seul problème moral est ici celui du passage
possible à l'universel. On ne peut pas vouloir, sous peine d'absurdité, que le principe de donner la mort "devienne une loi universelle". Mais le respect de la vie d'autrui va plus loin que l'interdiction de le tuer. Il s'agit de reconnaître l'autre comme une liberté, car ne pas le faire
relève nécessairement d'un régime d'exception, et ne peut être universalisé. On appellera donc respect le reconnaissance de l'autre comme volonté pouvant prétendre à son autonomie, donc sa reconnaissance comme pouvant être à lui-même sa propre fin.
Les rapports sociaux, tant que les rapports intersubjectifs, amènent à utiliser les autres dans le cadre de son action. Les élèves se servent (ou sont censés se servir) des professeurs pour s'instruire, les professeurs se servent des élèves pour gagner leur vie, les amoureux se servent l'un de l'autre pour satisfaire leurs désirs divers. Rien de cela n'est en soi immoral. Le serait par contre, selon Kant, de ne considérer autrui que comme un moyen à sa disposition, sans reconnaître qu'il est d'abord à lui-même sa propre fin. Ce respect inconditionnel, je me le dois aussi bien à moi-même, toujours en vertu du principe d'universalité. D'où une autre forme de l'impératif catégorique : " Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ".
Une chose a une utilité, elle est pour nous un moyen, et en fonction de cela et des besoins, elle a un prix. Elle peut être remplacée par une autre équivalente sans problème. A l'opposé, un être doué d'autonomie de la volonté est une fin en soi (et non un simple moyen), il a une valeur absolue (mais pas de prix), il est en lui-même irremplaçable, tout cela constitue sa dignité, et la reconnaissance de cette dignité est le respect. C'est cette situation que l'on désigne sous le nom de "personne". Cette notion, que l'on trouve à la fois chez Kant et dans la Déclaration des droits de 1789, est intégrée dans le code civil et tend de nos jours à devenir universelle.
Le règne des fins
La tendance naturelle n'est pas celle du respect, pas plus du respect de soi-même que de celui des autres. Chacun a l'expérience de ses faiblesses, pour ne pas dire de ses démissions et de ses lâchetés , par lesquelles il renonce à être maître de lui-même. Car il est toujours plus facile de se laisser aller
par où poussent les plus grandes forces, que de décider de son propre chemin. Chacun sait aussi à quel point la résistance des autres, leur mauvaise volonté à accomplir strictement ce qu'il attend d'eux, l'incite peu à les reconnaître comme fin en soi. Dans les deux cas, le respect est affaire d'effort, de lutte. La liberté n'est pas cette évidence facile qu'on tente souvent de faire accroire (voir dans le même sens, le chapitre sur l'existentialisme).
Il y a donc refus de l'ordre naturel, et ce refus nous engage dans une longue lutte, qui dépasse largement le cadre de l'individu. Au conflit naturel entre les hommes, nous devons substituer un autre ordre de coexistence, basé sur une reconnaissance réciproque universelle de la personne comme fin en soi. Cet
ordre que nous tentons de mettre en place, est appelé par Kant le Règne des fins. Il le définit comme la "liaison systématique de divers êtres raisonnables par des lois communes selon lesquelles chacun d'eux ne doit jamais se traiter soi-même et traiter tous les autres simplement comme des moyens, mais toujours en même temps comme des fins en soi".
La raison pratique
S'il n'y a selon Kant " qu'une seule et même Raison ", celle-ci possède deux usages différents, théorique (ou spéculative) quand elle veut poursuivre "la connaissance de l'objet poussée jusqu'aux principes a priori les plus poussés", pratique quand son usage "consiste
dans la détermination de la volonté relativement à un but final et complet". Ces deux usages ne sont pas symétriques, "puisqu'en définitive tout intérêt est pratique et que l'intérêt même de la raison spéculative n'est que conditionné et qu'il est seulement complet dans l'usage pratique".
Nous avons deux questions majeures : " Que puis-je savoir ? " et "Que dois-je faire ? ". La première est subordonnée à la seconde, et seule la liberté donne un sens à l'ensemble de l'édifice.
Que sommes nous vraiment ? L'anthropologie, la psychologie, la sociologie et autres sciences se donnant comme objet l'étude de l'homme, tentent d'y répondre chacune à leur manière. Mais elles risquent parfois de s'illusionner en croyant atteindre la réalité ultime de ce que nous sommes. Car ce qu'elles étudient n'est d'une part que le résultat après coup de comportements, et non pas la saisie au vif de la volonté en acte, d'autre part n'est qu'une appréhension phénoménale, et non pas, comme on l'a vu dans le chapitre sur la connaissance, la chose même, ce qui constitue notre essence. Or nous avons, non pas vraiment le savoir (car il n'y a rien là qui puisse être faire l'objet d'une intuition sensible), mais "l'expérience" pratique de ce que nous sommes : des volontés revendiquant leur autonomie. Nous pouvons donc estimer que la volonté est, pour chacun de nous, cette chose en soi inaccessible par la connaissance, ce qui ouvre la voie à la philosophie de Schopenhauer (ci-dessous). Ainsi l'éthique mène plus loin que la connaissance. Quand cette dernière ne peut que nous faire atteindre une connaissance phénoménale, l'éthique nous indique l'essence de ce que nous sommes, et par là l'essence de ce que peut être au moins une partie du monde. L'éthique a ainsi une portée métaphysique, une dimension ontologique, plus grande que la connaissance.
La volonté aveugle (Schopenhauer)
Ce que retient Schopenhauer de l'œuvre de Kant, et spécialement de La critique de la raison pratique, qu'il dit l'avoir beaucoup frappé, c'est d'abord cette idée que la réalité en soi est de l'ordre de la volonté. Mais je ne "connais" la volonté que parce que je l'exerce en voulant, car elle
ne peut être, de par sa nature, objet d'une intuition sensible. La connaissance, à travers ce que Schopenhauer appelle le quadruple voile, ne nous donne qu'une "représentation" du monde : " (...) les formes générales essentielles à tout objet : temps, espace et causalité, peuvent se tirer et déduire entièrement du sujet lui-même, abstraction faite de l'objet, ce qu'on peut traduire dans le langage de Kant, en disant qu'elles se trouvent a priori dans notre conscience." ( Le monde comme volonté et représentation ). Mais pour lui, la volonté n'est pas seulement l'intériorité de l'homme, mais l'on peut estimer qu'elle l'est de tout être, vivant ou non : la volonté est la réalité même du monde en général. Évidemment, cela implique qu'il y ait des degrés différents de la volonté, et notamment des formes beaucoup plus frustres que la nôtre.
Que veut la volonté ? On peut parfois répondre à cette question dans le détail ( je veux le bac), mais pas en général : " La volonté sait toujours, quand la conscience l'éclaire, ce qu'elle veut à tel moment et à tel endroit ; ce qu'elle veut en général, elle ne le sait jamais."
La volonté veut vouloir, et au fond peu lui importe que ce soit ceci plutôt que cela. La psychanalyse reprend cette idée (Freud était lecteur de Schopenhauer), quand elle montre que le désir n'est lié que de manière fort incertaine à son objet (l'opposition entre volonté et désir n'étant pas ici reconnue comme très pertinente). La raison ne joue jamais qu'un rôle de rationalisation, c'est à dire de justification a posteriori. La volonté veut aveuglément, sans se soucier s'autre chose : "Seule une volonté aveugle pouvait se mettre elle-même dans la situation où nous nous voyons. Au contraire, une volonté capable de voir eût bien vite fait d'évaluer que l'affaire (faire un monde) ne couvre pas ses frais ". La raison est donc secondaire dans cette affaire, la volonté est en soi irrationnelle.
Le monde n'est qu'une seule vaste volonté, mais la volonté en s'exerçant est acte de dissociation, et se morcelle en volontés qui se croient particulières et s'opposent les unes aux autres. Le propre de la volonté est de se dissocier, le monde est donc souffrance. Ce mouvement de dissociation et de déchirement se reproduit à toutes les échelles, et chacun a l'expérience de sa propre volonté se déchirant en vouloirs opposés. Dans ce conflit des volontés, chacun tend à se croire la victime opprimée, sans prendre en considération qu'il est aussi bien le bourreau de l'autre : " Celui-là se trompe en croyant qu'il n'a pas sa part de la torture, et celui-ci, en croyant qu'il n'a pas sa part de la cruauté. " Même dans ses tentatives illusoires de réunification, la volonté accentue encore sa dispersion : les gens qui veulent fusionner par amour font des enfants, et augmentent encore la dissociation.
Chaque "individuation" de la volonté universelle tend à se prendre pour elle entière, ou du moins pour son représentant attitré. La tendance
paranoïaque à se prendre pour la fin du monde est une caractéristique naturelle de la volonté. " Tout individu (...), bien que perdu, anéanti au milieu d'un monde sans bornes, ne se prend pas moins pour centre du monde, faisant plus de cas de son existence et de son bien-être que de ceux de tout le reste (...) ". Nous entretenons une certaine illusion sur l'individualité de la volonté, ce qui accentue la cruauté du monde. En réponse à cette aggravation, Schopenhauer, directement influencé par la pensée orientale, et notamment par l'hindouisme, préconise un retour de la volonté contre elle-même, dans un effort de renoncement et de résorption de la multiplicité. La volonté, dans son effort pour se supprimer elle-même, ne fait alors que s'accomplir de manière ultime, prétendant par là retrouver sa pureté originaire de chose en soi. La vie n'est qu'un piège dérisoire et cruel, tel est le message du "pessimisme" schopenhauerien : " Nous sommes d'innocents coupables, condamnés, non pas à la mort, mais à la vie. "
La volonté de puissance (Nietzsche)
En opposition à toute la tradition d'origine platonicienne, Nietzsche ne pense pas que la recherche de la vérité soit systématiquement bénéfique : " Qu'un jugement soit faux, ce n'est pas à notre avis, une objection contre ce jugement (...). Le tout est de savoir dans quelle mesure ce jugement est propre à promouvoir la vie, à l'entretenir, à conserver l'espèce, voire à l'améliorer. Et nous sommes enclins par principe à affirmer que les jugements les plus faux (...) sont pour nous les plus indispensables " (Par-delà le bien et le mal). Il ne faut cependant pas conclure de là que tous les jugements faux seraient ipso facto utiles à la vie, certains peuvent au contraire lui être totalement nuisibles. Simplement, le critère déterminant pour accepter un jugement n'est pas qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, mais qu'il soit ou non profitable à la vie. Il y a là une démarche qui n'est pas sans rappeler d'une certaine manière celle des décisions de la raison pratique chez Kant, en l'absence de possibilité de connaissance relativement aux questions pour lesquelles il ne peut exister de données sensibles. Remarquons enfin que le vrai étant logiquement universel, le faux relève du particulier, il y a donc ici refus d'un quelconque critère universel pour déterminer ce qui est bien (et non pas nécessairement vrai) de ce qui ne l'est pas.
Les jugements moraux font partie, pour Nietzsche, de ces jugements faux que l'homme a coutume de produire. "La morale n'est qu'une interprétation de certains phénomènes, ou, pour parler plus exactement, une interprétation fausse. " (Crépuscule des idoles). Les morales, car le terme est alors à mettre au pluriel, ne sont plus alors que des justifications théoriques, des rationalisations, donc a posteriori, de comportements vitaux qui leur pré-éxistent. Elles ne sont au fond que des recettes de cuisine : "Toutes ces morales qui offrent à l'individu de faire son "bonheur", comme on dit, que sont-elles sinon autre chose que des compromis avec le danger qui menace la personne à l'intérieur d'elle-même, des recettes contre ses passions (...), des astuces, des artifices petits et grands qui sentent le renfermé, la pharmacie domestique et les remèdes de bonne femme." (Par-delà le bien et le mal). La vraie question est alors : que tente de justifier telle ou telle morale ?
La morale dominante de la philosophie est, selon Nietzsche, le "platonisme-christianisme", Kant n'étant pour lui "qu'un rusé crypto-chrétien". Cette morale repose, dit-il, sur quatre principes mensongers (Crépuscule des idoles). Premièrement, "Les raisons qui ont fait désigner "ce" monde-ci comme apparent en fondent bien plutôt la réalité". Deuxièmement, le pseudo-monde vrai, tel que décrit généralement, est plutôt de l'ordre du néant et "n'est qu'une illusion d'optique morale". Troisièmement, toutes les fantasmagories d'une autre monde, d'une autre vie, etc., ne sont que calomnie et dépréciation du seul qui existe réellement. Quatrièmement, l'opposition entre un monde vrai et un monde apparent n'est qu'un "symptôme de vie déclinante", de décadence." Tout cela relève du "ressentiment", maladie morale de refus du réel, de résignation à la faiblesse. Nietzsche se montrera particulièrement sévère pour les morales chrétiennes et bouddhistes : "elles sont les religions des souffrants; elles donnent raison à tous ceux qui souffrent de la vie comme d'une maladie et qui voudraient obliger à tenir pour faux tout autre sentiment de la vie et à le rendre impossible". (Par-delà le bien et le mal).
Nietzsche fut lecteur fervent, puis critique, de Schopenhauer. On trouve chez ce dernier le germe de la thèse nietzschéenne de la distinction entre force et faiblesse : " C'est toujours chez les mêmes personnes qu'on rencontre et les joies sans mesure et les douleurs impétueuses ; ces deux extrêmes se font pendant. " (Le monde comme volonté et comme représentation). Le choix n'est pas entre joie et peine, entre bonheur et malheur, car il n'y a pas de grande joie sans grandes peines. Le choix est entre grand jeu et petit jeu. Celui qui veut choisir l'intensité peut s'attendre à de grandes satisfactions, au prix de grandes difficultés. Le problème est donc celui de la quantité de souffrance que l'on est prêt à accepter. Le "faible" se définit comme celui qui, principalement mû par la crainte, refuse tout ce qui dérangerait trop, et préfère donc être protégé par un comportement de groupe. Le faible se caractérise donc principalement par sa puissance de négation et son instinct grégaire. Le "fort" prend son risque, il veut l'exercice maximal de sa volonté, il est donc volonté de puissance (attention à ne pas confondre puissance, qui est volonté d'affirmation de soi-même, et pouvoir, qui est volonté de soumettre les autres). Il est dans la logique des "faibles" de ne pas supporter les "forts". Aussi "(...) le plus forts et les plus heureux sont faibles dès qu'ils ont contre eux des instincts grégaires organisés, la pleutrerie des faibles, le trop grand nombre". On en arrive alors à ce précepte étrange : "(...) on a toujours à défendre les forts contre les faibles, les heureux contre les malchanceux".
L'ataraxie, ou la volonté contre elle-même
Pour Épicure, "(...) le plaisir est le commencement de la vie heureuse". La morale épicurienne est donc au départ un hédonisme. Mais, un peu de la même manière que chez Nietzsche (bien que les conclusions soient opposées), l'expérience montre qu'il y a rarement de purs plaisirs, et que beaucoup d'entre eux amènent des ennuis. Ces ennuis (éventuellement différés) peuvent même éventuellement être plus importants que le plaisir qu'ils accompagnent. Il faut donc en tenir compte si notre recherche est celle du plaisir : "(...) nous ne cherchons pas tout plaisir ; il y a des cas où nous passons par-dessus beaucoup de plaisirs s'il en résulte pour nous de l'ennui." Réciproquement, certaines douleurs peuvent être au bout du compté bénéfiques. Il faut donc entreprendre un travail d'évaluation de ce qu'une action peut comporter de plaisir et de déplaisir. Mais ce n'est pas facile, car d'une part nous ne possédons pas nécessairement toutes les données, d'autre part plaisir et déplaisir ne sont pas nécessairement contemporains, enfin il n'est pas facile de mettre en comparaison des termes hétérogènes. Il nous faut néanmoins tenter ce "calcul des plaisirs" : "(...) il convient de décider de tout cela en comparant et en examinant attentivement ce qui est utile et ce qui est nuisible." (Lettre à Ménécée).
Devant la difficulté d'en juger, le sage préférera se limiter aux plaisirs estimés naturels et nécessaires (comme boire et manger avec modération), et refusera les plaisirs susceptibles de lui procurer des troubles. Aussi l'utilisation usuelle du terme "épicurien" est-elle un faux-sens,
l'épicurisme vise un idéal de tranquillité de l'âme, que l'on appelle "ataraxie" : "Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l'absence de souffrances corporelles et de troubles de l'âme." Quatre règles principales sont ainsi dégagées, appelées par la tradition épicurienne le "quadruple remède". Premièrement, ni colère ni bienveillance, assurant ainsi l'absence de souci pour soi et pour autrui. Deuxièmement, comprendre qu'il n'y a pas à se soucier de notre propre mort, qui n'est rien pour nous. Troisièmement, rechercher l'élimination de toute douleur et s'en tenir au plaisir quand il est là . Quatrièmement, ramener la douleur à sa juste valeur : elle n'est jamais ininterrompue, et les crises violentes sont généralement courtes.
On retrouvera cet idéal d'ataraxie dans le stoïcisme. Celui repose sur une distinction fondamentale : il y a ce qui dépend de nous, et il y a ce qui n'en dépend pas. Toute la sagesse consiste alors à comprendre qu'il est vain de se lamenter sur ce qui ne dépend pas de nous, puisque nous n'y pourrons de toutes
façons rien changer. La seule solution est d'accepter ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir, comme l'ordre du monde (ce que l'on appelle encore de nos jours être stoïque). Occupons-nous donc de ce qui est en notre pouvoir. Or, s'il est une chose qui est en notre pouvoir, c'est notre représentation. Ainsi, nous ne
pouvons rien au fait de la mort, mais nous sommes seuls maîtres de la manière dont nous l'appréhendons. Le bonheur et la sagesse sont alors dans la maîtrise de nos représentations.
Une dimension politiqueSi la question éthique est celle de la liberté, cette dernière ne peut être comprise que sur le seul point de vue de l'individu. Car, quelle que soit la conception que l'on en puisse avoir, la liberté de l'un se heurte nécessairement à celle des autres. La formule usuelle, reprise dans des déclarations de droits de l'homme, selon laquelle la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres, ne fait malheureusement qu'énoncer le problème, sans donner les critères d'appréciation de cette limite. Il reste donc un problème majeur, celui de la coexistence des libertés individuelles, et, d'une manière plus générale, celui de la coexistence des volontés en un seul monde. Ce problème est alors celui de la politique. |
Delacroix, La liberté guidant le peuple |
Suggestions de lectures
* Emmanuel KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs.
* Jean-Paul SARTRE, L'existentialisme est un humanisme.
* Friedrich NIETZSCHE, Par delà le bien et le mal.
* EPICURE, Lettre à Ménécée .
Rubrique "à éviter"
* Éviter, spécialement sur les problèmes éthiques, les propos moralisateurs.
* Le pseudo-raisonnement simpliste (pour ne pas dire simplet) : il y a tout le temps des règles, donc on n'est jamais libre.
Questions de révision et d'approfondissement
Pour que ces questions soient efficaces, il ne suffit pas de les survoler en se disant "ça, je saurais y répondre", ou à l'inverse "je n'y arriverai jamais". Il faut tenter d'y répondre coûte que coûte, même pas très bien, le mieux étant devant témoin (mais si...). Car c'est très différent de faire et de croire pouvoir faire. Ca peut se jouer à charge de revanche, ou encore alternativement.
* En quoi la question morale est-elle incontournable ?
* Quel(s) rapport(s) y a-t-il entre la morale et la liberté ?
* Peut-on définir la liberté par l'absence de règles ?
* En quoi peut-on considérer la notion d'amoralisme comme fictive ?
* La liberté peut-elle être objet de connaissance ?
* Pourquoi l'expérience "science morale" est-elle problématique ?
* La recherche du bonheur peut-elle servir de guide à la liberté ?
* Que signifient les termes d'autonomie et d'hétéronomie ?
* Autonomie et indépendance sont-elles synonymes ?
* Le sentiment de liberté est-il suffisant pour attester de la liberté ?
* Comment reconnaître qu'il y a autonomie de la liberté ?
* Suffit-il de vouloir pour être le sujet réel de son vouloir ?
* Qu'est-ce, selon Kant, que l'impératif catégorique ?
* Quelle différence y a-t-il entre impératif catégorique et impératif hypothétique ?
* En quoi le critère universel peut-il être critère de liberté ?
* A quoi (ou à qui) s'adresse le respect ?
* Qu'entend-on juridiquement par la notion de personne ?
* Dans quelle mesure les notions juridiques du droit de la personne sont-elles dans la lignée de la problématique kantienne ?
* La liberté est-elle naturelle ?
* Pourquoi peut-on parler de combat pour la liberté ?
* Le combat pour la liberté est-il seulement un combat contre les autres ?
* Qu'entend Kant par "règne des fins" ?
* Quelle différence y a-t-il entre raison théorique et raison pratique ?
* En quoi la morale nous approcherait plus près de l'être que la connaissance ?
* Pourquoi peut-on, selon Schopenhauer, parler de caractère aveugle de la volonté ?
* Pourquoi peut-on être amené à différencier ce que veut la volonté en particulier de ce qu'elle veut en général ?
* Est-il justifié de dire que la raison est secondaire par rapport à la volonté ?
* En quoi la volonté est-elle perpétuelle dissociation ?
* Quelle illusion comporte l'individuation de la volonté ?
* Peut-on dire de chacun qu'il est victime autant que bourreau ?
* Qu'est-ce qui amène Schopenhauer à prétendre que le monde est "une affaire qui ne couvre pas ses frais" ?
* Qu'est-ce qui peut amener à considérer le renoncement comme l'accomplissement suprême de la volonté ?
* Un jugement peut-il être faux et utile ?
* La vie n'a-t-elle besoin que de vérité ?
* Est-il justifié de parler de morales (au pluriel) ?
* Peut-on considérer les morales comme des justifications a posteriori ?
* Quels sont, selon Nietzsche, les principes fondamentaux de la tradition platonicienne et chrétienne ?
* En quoi, selon Nietzsche, les morales bouddhistes et chrétiennes sont-elles nuisibles à la vie ?
* Comment se définissent, selon Nietzsche, la force et la faiblesse ?
* Pourquoi faut-il défendre les forts contre les faibles ?
* Pourquoi est-il difficile de dissocier plaisir et déplaisir ?
* Qu'entend l'épicurisme par "calcul des plaisirs" ?
* Qu'est-ce que l'ataraxie ?
* Qu'est-ce qui caractérise l'attitude morale stoïcienne ?
* Le problème de la liberté peut-il être entièrement traité sur le seul plan moral ?
Pour changer de registre
 | Par l'auteur de cette page, quelques textes un peu moins éducatifs, et qui néanmoins valent le détour : les recueils de nouvelles. |
màj 220703 |
Retour |