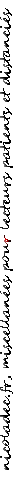Se mordre la queue.
Au départ, ou prétendu tel, il y a une idée bien sympathique, le fameux « savoir que l’on ne sait pas » socratique. L’humanité a tellement pâti, il y eut tant de souffrances et de massacres, du fait de tous les imbéciles prétentieux sûrs de connaître, ces imbéciles heureux qui ont une vérité quelque part, avec en perspective leur manie du bonheur tel qu’ils le conçoivent de gré ou de force, qu’on ne peut qu’exprimer sa reconnaissance à l’homme sage qui sut ne même pas écrire qu’il ne savait pas. Mais voilà, au grand dam des hommes conséquents, la trajectoire est toujours la même, on se croit encore dans la vivacité du questionnement socratique, et on se retrouve sans s’en être rendu compte dans les délires totalitaires de la constitution politique parfaite…
Une étudiante demandait, avec la vertigineuse naïveté de celui ou de celle qui a cru en des terres promises : « Mais Monsieur, comment se fait-il que la philosophie commence régulièrement par une apologie du sens du questionnement,
de la recherche, de l’ouverture, et échoue si peu après dans le sectarisme d’une doctrine quelconque qui ose croire rendre compte du reste du monde ? » Embarrassé, on serait tenté de répondre en première instance qu’au moment où l’on se lance à l’aventure, succède toujours celui où l’on gère son fond de commerce.
Mais voilà, dans le susdit métier, il faut toujours fournir une réponse plus élaborée. Plus vraie, personne ne sait, et on s’en fout, mais plus élaborée, ça, c’est important. Il faut alors y aller d’un beau topo bien propre, comme on sait faire dans la corporation. La forme élitiste du « il était une fois » populaire. Soit donc.
Môa, mes idées et le monde.
La philosophie, dit « le » philosophe, est née de l’étonnement. Et celui-ci de préciser l’ordre du questionnement, du plus proche, dit-il, vers le plus lointain. Certes, c’est se donner une dimension nouvelle que de s’étonner. Et rien n’est à l’opposé plus
redoutable que cette opacité glaciale de l’immersion sans recul de ceux qui, comme le dit l’expression contemporaine consacrée, ne veulent pas « se prendre la tête ». C’est comme c’est, ne pensent-ils même pas, et ce brin d’herbe est un brin d’herbe, point final. Reconnaissance profonde donc à tous ceux, qui au moins une fois, se sont dit qu’ils ne comprenaient pas bien ce que pouvait être un brin d’herbe, et qui s’en sont étonnés.
Mais qui se sont étonnés de quoi ? Car le sens commun, qui n’est pas, comme chacun sait, celui des philosophes, distingue entre la réalité de la chose même et ce que le langage en vise ou en dit. Le philosophe qui n’a généralement pas, bien qu’il l’ignore tout en s’en enorgueillissant paradoxalement, le sens commun, va éventuellement nous réfuter cette distinction. La chose, ira-t-il jusqu’à dire, est le concept même, à la rigueur dans un autre moment de son identité. Restons-en donc, et nous serons malgré tout en cela en bonne compagnie, à cette distinction pré-philosophique, fut-elle naïve, entre le chose même et la représentation que s’en construit le si vénéré sujet pensant. Car, quitte à paraître rustique, il y a le réel, et il y a ce que des hommes en pensent ou en disent. Eh bien, il y a deux étonnements forts différents, qu’il pourrait être utile de distinguer. Celui qui s’étonne de la réalité même de ce que nous appelons brin d’herbe, et celui qui s’étonne du genre de pensée qu’il a à cette occasion. Le premier relève du jardinage, le second de la philosophie.
On peut alors se demander si tous deux se valent. Car assez souvent, si le jardinier se fout du philosophe, celui-ci tend, avec toute son onctuosité en telle circonstance, à le prendre plus ou moins discrètement pour un imbécile. Au milieu des mots, il sera bien sûr assez facile de montrer la supériorité du philosophe. Et au milieu du jardin, celle du jardinier. Mais qui s’étonne vraiment de quoi ? Tous deux ont au départ la même inquiétude, la même peur primale. Ce que je suis dans ce monde étrange, ce qu’est ce monde dont je suis étrangement issu. Partant de là, l’un pose de belles questions, savamment
disposées en hélice, ce qui lui permet de réfuter ce que tout le monde voit, à savoir qu’il tourne en rond, sous la prétendue raison qu’à chaque rotation, il se retrouve un peu plus haut. Ce qu’il ne voit pas, c’est que son hélice forme globalement un cercle, et revient à son point de départ, comme un ressort à boudin dont on fait toucher les deux extrémités. Il n’est jamais que le faux naïf qui n’arrête pas de poser des questions, voguant de représentation en généralité, comme le pauvre touriste en étonnement qu’il est. L’autre se coltine l’existence même du brin d’herbe, de celui-ci en particulier, non d’une catégorie de pensée qu’il lui substituerait, il affronte la chair même de son
inquiétude. Il y a la peur des lâches et il y a la peur des courageux, la première, celle des philosophes, n’étant qu’une ombre de la deuxième.
L’inquiétude philosophique première n’a peut-être pas exactement le sens qu’on lui attribue complaisamment. Ou plutôt si, elle l’a, mais justement pour cela non. Cette inquiétude est ouverture au monde dans le même mouvement qu’elle en est le refus. Vous connaissez ce mouvement du jeune enfant qui dit quand on le houspille « non, non, encore ». Le philosophe est ce jeune enfant, mais comme il a appris la dialectique, il tend à l’inverser en un « encore, encore, non ».
Au fond, la philosophie relève du fantasme le plus primaire qui soit, l’instinct
primal de toute vie : que ce soit le monde qui dépende de moi et non moi qui dépende du monde. Plus fort encore, et certains l’ont affirmé explicitement, que ce soit le monde qui soit une partie de moi, et non moi une partie du monde. C’est sans doute la raison de son pseudo regain dans notre société. A l’heure où plus personne, moins que jamais, ne veut du réel, la philosophie est la manière la plus efficace, et peut-être au fond la moins coûteuse, d’en rendre possible l’occultation. Comment donc, des plus primaires, objectera-t-on, alors que cette pratique est au contraire des plus réputées pour sa finesse, sa subtilité, son jésuitisme même ? Mais oui, ce sont les plus fondamentaux instincts qui trouvent leur aboutissement dans ce qui s’en écarte le plus. Et ce sont souvent les civilisations les plus raffinées qui commettent les plus subtiles horreurs au nom des grands principes.
La philosophie commence par l’étonnement et finit dans les plus invraisemblables délires, ne s’étonnant même pas, ce sans quoi ce ne seraient pas des délires, d’eux-mêmes. Mais du début à la fin, il s’agit du même refus, que la réalité soit à la fois ce qui ne dépend
pas de moi et ce dont je ne saurai jamais rendre compte. Le problème du fondement, disait un docte patricien, par ailleurs fort intéressant, est l’objet même de la philosophie. Qu’est-ce que philosopher, poursuivait-il, si ce n’est poser la question du fondement ? A quoi l’on pourrait répondre que s’étonner, c’est tenter de s’habituer à ce que « sans fondement » veut dire. Les fondements ne sont que des montages psychologiques, répondant sans doute à une sorte de besoin de l’esprit humain, encore que besoin soit sans doute beaucoup trop dire.
Honte à celui qui refuse l’inexpliqué. Bien sûr, il faut chercher. Mais ne jamais croire avoir trouvé. Les philosophes le disent, ici et là, mais c’est le plus souvent pour mieux bétonner leur certitude. Le vice majeur de l’homme est de pratiquer à profusion l’hypostase. Mais le vrai professionnel de cette redoutable perversion est le philosophe. On appelle hypostase « une entité fictive faussement considérée comme une réalité existant en dehors de la pensée et dont on fait une substance ». Hypostasier, dit vulgairement, c’est prendre ses idées pour des réalités. C’est la base même de l’activité du philosophe. L’un d’entre eux a pourtant eu cette magnifique formule : « Penser, c’est inventer sans croire ». Mais voilà, ça finit presque toujours par croire, comme n’importe qui. Parce que c’était ça le vrai projet de départ…
Fantoches.
Ah que les philosophes, ou que ceux qui s’autoproclament tels, mais c’est la même chose, sont jolis ! Il faut en avoir vu de vrais de près, en os et en esprit. Pris isolément, ils peuvent cependant faire illusion. Il faut les apprécier en groupes, ce qui n’est pas toujours facile, puisqu’ils sont animaux plutôt solitaires, chacun étant à lui seul le monde. Pour se faire une petite idée de ce peut être le comble de la dérision, il faut se faire invisible (on fait ça dans cette variété humaine avec un anneau au doigt) pour assister à une réunion de professeurs de philosophie. On pourrait bien sûr rappeler que philosophe et professeur de philosophie, ce n’est pas la même notion. Mais l’un de ces derniers qui un jour le suggérait se fit immédiatement traiter d’imposteur par ses confrères indignés. Prenez en donc une assemblée. Vous ne trouverez là que des gens fort instruits de toutes choses, en tout cas conscients de l’être, et décidant avec une grande hauteur teintée de sérénité faussement détachée des vérités dernières, ou premières, selon comment vous l’entendez. Prenez les en train de se mésentendre sur les critères d’évaluation d’une copie, c’est à cette occasion qu’ils sont les plus grands.
L’un vous dira que cette copie ne vaut pas grand chose parce qu’on n’y trouve que de l’épistémologie sèche sur les conditions d’utilisation de la mémoire par l’historien, que d’une part on ne traite pas cela en cours (il veut dire que lui ne le fait pas), que d’autre part sur un sujet d’une telle gravité, on attendrait que soit donnée priorité au problème
moral, politique, et sublime du devoir de mémoire, autrement plus important pour l’avenir de l’homme. L’autre vous rétorquera (rétorquer n’est pas le bon mot, car il suppose que l’on veuille aller contre ce que l’autre a dit, ce qui n’est pas le cas : on parle ici en solitaire, en simple juxtaposition de l’autre qui fait de même) que l’idéologie fumeuse et moralisatrice du devoir de mémoire l’importune, et que sur un sujet d’une telle gravité etc. N’allez surtout pas, faute de passer pour un irrémédiable lourdaud, voire plus grave, émettre l’hypothèse que la seule chose en l’occurrence d’une réelle gravité soit qu’un candidat puisse, au hasard du correcteur, être crédité d’une dizaine de points en plus ou en moins (éventuellement coefficient 7).
Un traître parmi eux s’étonnait un jour d’un écart de dix points pour la notation d'une même copie, et plus encore de la disparité des commentaires. On appellait ça une copie test. Et pour être un test, c'en était un fameux, mais ce n'est pas la copie qui se trouvait testée. A l’une extrémité, l’un jugeait « contre-sens global sur le texte, propos inconsistant » ; à l’autre ça donnait « analyse fine, commentaire judicieux ». Entre les deux, un peu n’importe quoi. A celui
donc qui s’indignait d’une telle hétérogénéité d’appréciation, il fut répondu que c’était normal, puisque les élèves étaient de nos jours bien hétérogènes. Schéma intéressant, n’est-il pas ? L’hétérogénéité des correcteurs était devenue celle des élèves.
Et, stupéfait, vous les verrez s’en aller chacun avec le sentiment réconfortant de s’être bien entendu. Les candidats futés le savent bien, si l’on parvient à faire parler suffisamment l’examinateur, il sortira de l’épreuve avec le sentiment qu’il s’y est tenu de fort intelligents propos, et notera bien celui qui aura su se taire à propos. Eh bien là, saisi par l’intelligence de ses propres propos, aucun n’écoutant sérieusement l’autre, mais faisant, à charge réciproque, le minimum du service faire-valoir, il se dit avec satisfaction qu’il s’est bougrement bien entendu. La conscience claire, l'âme sereine, ils auront su une fois de plus distinguer l'essentiel de l'inessentiel. Et ils ne verront ensuite aucun rapport avec la désaffection croissante des sections littéraires…
Conclusion
Il n'y a jamais en vrai de conclusion, c'est une invention rhétorique. Alors allons-y d'un lieu commun et néanmoins rhétorique : la philosophie est comme
l'amour, ce peut être la plus belle ou la plus hideuse des choses. Ou les deux à la fois... |