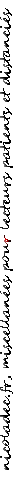|
option |  |
|

- Mon oncle, mon bel et grand oncle vérité, on m'a volontiers narré, en mon jeune âge, des étrangetés de registres divers. Certaines me semblaient juste destinées à m'inquiéter suffisamment pour me rendre docile. Telles étaient les fantaisies de loups alertes à la dent acérée et amateurs de jouvencelles à la cuisse tendre et rose. D'autres me semblaient de prétention plus générale, telles les fabuleuses épopées des rois, des militants et des prophètes divers sauvant le monde, sans que j'aie d'ailleurs jamais compris en quoi pouvait consister le dit monde, et encore moins son sauvetage. Et je ne fais mention que pour mémoire des médiocres anecdotes répétitives que mon père se croyait vaguement tenu de débiter à ma pauvre mère, les deux soirs la semaine où il avait dû s'attarder pour boucler un dossier urgent avec sa jeune secrétaire. Je me suis donc fort jeune étonnée de ce que pouvait être une histoire, et de ce qu'elle pouvait bien prétendre dire face à ce qui se passait en vrai, à ce qui s'était vraiment passé. Certaines ne se donnent pas trop la peine de cacher leur libre jeu, mais qu'en est-il de celles, nombreuses, qui exigent qu'on les prenne au sérieux ? Comment peut-on être certain de leur véracité ? Est-on bien sûr que les choses se soient ainsi passées ? Si tu désires me répondre à cette question ardue comme devant les auditoires savants de tes doctes conférences, je t’autorise alors à devenir austère. |
- Merci, ma perspicace nièce, j’adopterai donc la manière sévèreet balancée, mais, comme à mon accoutumée, libre de quelque peu bousculer ses registres, puisque tu m’y convies. Alors, voilà. Qui sait ce qui s'est passé ? C’est la question posée en voix off dans le bel Été meurtrier du cinéaste Becker. On peut toujours admirer la belle certitude de ceux qui ont su ou qui ont vu. Il y a, dit une publicité, ceux qui y étaient et ceux qui n’y étaient pas. Passons sur le fait qu’on y montre alors, entre autres, des gens devant leur poste de télévision, comme exemple de ceux qui y étaient. C’est une façon toute virtuelle d’y être. Mais quand bien même y aurait-on vraiment été, de quelle manière y aurait-on été ? Car on fait toujours semblant de croire que la présence est une omniprésence. On assimile ainsi le fait d’être présent et celui d’avoir vu : je le sais, j’y étais. Le moindre illusionniste vous prouvera pourtant que tout en étant présent, et même attentif, nous sommes capables de ne rien avoir vu de ce qu’il était décisif de voir. Mais sans illusionniste, il est différentes raisons qui font que nous ne pouvons percevoir qu’une minime partie de ce qui se passe. D’abord, nous n’avons que peu de sens, limités à quelques phénomènes physiques restreints, et chacun de ces sens n’est réceptif que dans un créneau limité. Trop faible ou trop fort, vibrant trop rapidement ou insuffisamment, nous n’entendons pas le son. Ensuite, notre conscience n’est susceptible d’être tout-à-fait attentive qu’à une seule chose à la fois, même si c’est sur fond de coprésence diffuse d’un environnement. Autrement dit, il est suffisant d’être attentif à quelque chose, pour qu’autre chose nous échappe. Nous n’avons donc absolument pas les moyens matériels de voir la totalité de ce qui se passe, pour peu de plus qu’on puisse attribuer un sens clair à cette notion de totalité. Dans la pratique, on est d’ailleurs très loin du compte, et les plus fins observateurs n’enregistrent au mieux que quelques traits caractéristiques d’une situation qui déborde infiniment leur facultés d’observation. Alors, ceux qui y étaient en ont moins vu que ne peuvent raconter ceux qui ont collecté et recoupé des témoignages divers. Sous certaines conditions, il vaut mieux avoir lu qu’avoir vu. L’émeutier, le gréviste, ou ce qu’on voudra, lisent le journal le lendemain pour savoir ce qui s’est passé. |
A cela se superposent des contraintes psychologiques. Si certains éléments de la situation sont perçus comme violents par le témoin, il est bien évident qu’il va les appréhender de manière émotive, donc dépourvue de sang-froid. Il n’est sans doute pas très judicieux de s’en tenir sans prudence au récit d’un rescapé d’un bombardement ou d’une personne agressée sexuellement. Mais ce n’est encore qu’un premier degré de la difficulté. Chacun ne peut appréhender ce qui advient qu’à travers les schémas de compréhension qu’il possède. Ces schémas sont tout autant intellectuels, que politiques et moraux. On le saisit bien parfois avec les autres, mais on a le plus grand mal à comprendre comment on ne parvient soi-même à percevoir qu’à travers ses propres cadres moraux. Ensuite, celui qui a fait partie d’une histoire, a justement été une partie de l’histoire. Ce qui veut dire qu’il n’en a pas été la totalité. Il est donc disqualifié pour rendre compte de ce qui s’est globalement passé. En conséquence, on ne peut être, ce qui est bien connu, juge et partie. Pour reprendre une illustration cinématographique, le Rashomon de Kurosawa montre de manière cinglante ce que donne la sorte d’incompatibilité des versions partielles, nécessairement partiales. Enfin, quatrième degré, le visible n’est compréhensible, on peut même dire le visible n’est visible, que lesté de tout son poids d’invisibilité. Derrière l’image littérale, les arrière-fonds sont parfois insoupçonnables. Le pauvre Pimpon de l’Eté meurtrier n’est ni spécialement aveugle, ni spécialement stupide, mais il ne peut pas réinventer ce qui manque à ce qu’il voit. |
|
La situation du témoin ne se bonifie pas avec le temps. Tout souvenir s’estompe, ce qui paraît logique et naturel. Mais ce constat reste trop simple. Car le souvenir n’est pas un morceau intact du passé qui aurait survécu, il est une évocation présente de ce dont on pense se souvenir. Une fois compris que le souvenir est une activité du présent, il devient clair qu’il est donc une reprise, une élaboration nouvelle, qui se fait conséquemment au gré des préoccupations et des schémas du présent. Il y a ainsi ré élaboration permanente, qui interdit à tout homme de se souvenir d’un fait tel qu’il l’a vécu, et chaque version efface de plus jusqu’au souvenir de l’existence des versions antérieures. C’est ainsi que se constituent et se déforment des romans personnels, des romans familiaux, des romans nationaux, des romans sociaux. Avec dans le détail des procédures, des tas de subtilités, comme la constitution de ce qu’on appelle en psychanalyse des souvenirs écrans, c’est-à-dire essentiellement destinés à en cacher d’autres. Ou encore, ces souvenirs composites, dont les détails peuvent être séparément authentiques, mais le montage fantaisiste. Aussi est-il bien audacieux d’écrire ses mémoires en fin de carrière. |
Un procédé remarquable a notamment été noté par notre très honoré concitoyen, Jean Norton Cru. Dans son intéressant livre Du témoignage, celui-ci, après avoir dépouillé et analysé de nombreux témoignages de guerre, contemporains ou décalés des faits, constate un processus de déformation systématique, qu’on pourrait qualifier d’idéologique. La mémoire, constate-t-il, ne se contente pas de perdre la « trace » des faits, elle compense au fur et à mesure en recréant ce qui lui manque. Mais cette création ne se fait pas ex nihilo, elle prend pour cadres les schémas ayant officiellement cours selon le sujet concerné. Elle est inspirée par des notions longuement entretenues dans l’esprit, en l’espèce par l’image traditionnelle et légendaire de la guerre. Cela explique comment ce témoin pourra raconter, en toute bonne foi, qu’il a vu et accompli des choses conformes à la guerre selon les livres, mais en contradiction avec son expérience de combattant. Plus le temps passe, plus le témoin raconte ce qu’il est censé raconter pour être socialement crédible. Et donc cinquante ans après les faits, il ne peut rien rapporter d’autre que la vérité officielle du moment, qui se trouve ainsi validée à bon compte. Avec les années, on n’oserait notamment même plus imaginer que les choses aient pu avoir lieu avec un brin d’ambiguïté en plus qu’il n’est devenu autorisé de le dire. Un beau traumatisme sexuel, un cas patent de crime de guerre, comme on dit bizarrement, ça doit coller sans bavures avec les normes instituées, telles qu’on pourra les contrôler dans les livres, dans les journaux et dans les discours politiques. Il nous faut des histoires solides, et toutes finiront par l’être. On nous parlera ainsi de l’héroïsme à la guerre, de la fièvre des combats, de la peur aussi, bref de tous ces sentiments forts qu’on attend de cette situation violente par excellence. Mais toute cette imagerie, qu’elle soit guerrière ou pacifiste, est assez loin de ce que donne le matériau direct. Les témoignages immédiats, patiemment collectés par Cru, sont plus nombreux qu’on ne supposerait : lettres des soldats à leurs familles, à leurs fiancées, journal qu’ils tiennent parfois quotidiennement dans les longues périodes interminables d’attente. On y apprend par exemple que la guerre ne se présente jamais sous la forme d’une lutte véritable. L’un attaque, l’autre est sur le coup surpris et impuissant : chaque fois on aura un bourreau et une victime impuissante. On y découvre également qu’un sentiment qui s’en dégage fréquemment, dans la longue attente angoissée entre deux attaques des uns ou des autres est, contre tout schéma traditionnel, l’ennui. La guerre réelle n’est pas l’histoire conforme qui a cours sous ce nom. L’histoire résorbe toujours les faits dans les lois intangibles du genre. |
|
Le rapport entre l’histoire et les faits dont elle est censée être constituée est de toutes façons faussé dès le départ. Prétendre raconter ce qui s’est passé, c’est d’emblée faire une assimilation, une confusion naïve entre ce qui a eu lieu et ce qu’on a été capable de remarquer. Or la disproportion entre les deux est immense, en toute rigueur est infinie. Aussi limitée soit l’aventure à laquelle on s’intéresse, le nombre réel d’informations qui en rendraient compte de manière absolue est infini. Il ne s’agit même pas d’un infini simple dénombrable, mais quelque chose comme l’infini indénombrables des nombres justement dénommés réels : vous ne pouvez même pas commencer à en établir la liste ordonnée. Nul être fini n’est en état d’appréhender la totalité de quoique ce soit, il ne pourra jamais qu’en noter une très étroite sélection, modulée tant par ses capacités biologiques que par sa culture, ses intérêts, ses désirs et ses parti-pris. Une fois rappelé qu’une sélection limitée eu égard à l’infini lui est en proportion nulle, on doit se résigner à ce que notre collecte ne vaille proprement rien par rapport à ce trop plein. Si l’on croyait pouvoir se rassurer en arguant que notre sélection va à l’essentiel significatif, il faudrait tout de même s’étonner de ce qui nous autorise à juger comme inessentielle une infinité qui précisément nous échappe. L’histoire ne prend donc jamais en charge qu’un petit échantillonnage du réel, et quand elle a dit tout ce qu’elle avait à dire, bien des surprises restent possibles.
Outre qu’il est nécessaire à l’histoire de sélectionner sur place ce que sera son matériau, par exclusion du reste, quantitativement infiniment plus important, il lui faut délimiter son territoire. Car il n’est rien dans le monde qui soit tout à fait isolé, tout s’y entrecroise inextricablement. Remémorez votre journée. Croyez-vous qu’il soit possible, sans tricher outre mesure, d’en faire une histoire ? Trop de choses diverses là-dedans, trop de lieux hétéroclites. Car la réalité se donne toujours mêlée, à prétendre en rendre compte sérieusement, on serait toujours dans la digression ou le hors-sujet. Vous avez souri à ce jeune homme ou cette jeune femme, dans la rue, comme chaque vendredi, d’un sourire cependant plus complice chaque semaine. Vous avez une nouvelle fois succombé à votre compulsion dépensière dans le grand magasin, malgré des mois de vaine lutte réitérée. Votre collègue de travail semblait bien confiant dans l’attente de la prochaine vague de promotion, pour laquelle vous êtes concurrents. Votre vieille tante vient de subir sa quatrième opération, à l’issue bien incertaine. Sans compter qu’il pleut sur la ville, et que la campagne électorale semble bien confuse et décevante. Tout cela ne marche pas du même pas, occupe des emplacements différents, et pourtant c’est votre vie. Mais vous aurez du mal à intéresser l’auditeur si, telle une vieille grand mère étonnée de vivre encore tant d’aventures quotidiennes, vous égrenez ce bric-à-brac. D’où la célèbre exigence classique, unité de lieu, unité d’action. On ne saura pas si l’héroïne avait des problèmes intestinaux, ni si elle avait payé ses impôts : ça concerne le réel, ça n’intéresse pas l’histoire. Le paradoxe est que pour faire vrai, elle doit se mettre des oeillères. Toute histoire est un découpage illicite dans l’entrecroisement du réel, toute histoire coupe indûment au sein des réalités qui la traversent.
Unité de lieu, unité d’action sont deux exigences similaires, qui peuvent néanmoins entrer en conflit. Le lieu, au sens strict, est une délimitation géographique ou spatiale, éventuellement plus ou moins floue, les lieux n’ayant pas nécessairement de délimitations exactes, au grand dam des nationalistes, des propriétaires, et autres amateurs de frontières absolues. L’action aussi est délimitation, mais plus métaphoriquement parlant. Les actions ne peuvent être délimitées comme actions qu’en traçant des frontières, excluant ce qui est censé ne pas en faire partie. Mais ce la entraîne bien des complications dans l’élaboration, rendant très abstraite la constitution de toute histoire. D’abord, la délimitation de l’action ne correspond pas généralement à de nettes limites spatiales, rendant souvent factice la double exigence d’unité. Vous connaissez peut-être cette anecdote imaginaire du battement d’aile de papillon provoquant une tornade à l’autre bout de la terre. C’est une image frappante, pour dire qu’une action se distribue en des endroits divers, éventuellement disjoints. L’unité de lieu est le fantasme d’un remembrement possible en la matière, le rêve toujours vain d’instaurer un empire isolé dans le vaste empire universel. Mais en plus, aucune vie ne se résume à une action, pas même à une seule simultanée. De multiples actions s’entre-tissent, comme dans un tissu au mélange incertain, sans commencement ni fin. L’histoire sélectionne et épure des registres dans ce fin maillage. Ce qui est lieu pour l’une serait pure diversité disparate vue d’une autre. Toute histoire se crée un territoire et le fonde imaginairement comme unitaire, toute histoire a son nationalisme.
Il faut bien que le film ait un commencement et une fin. Cependant, le début est nécessairement arbitrairement choisi, et la fin nécessairement mensongère par le fait même qu’elle se pose comme fin. On est souvent moins sensible à l’arbitraire du commencement, puisqu’on est pris par surprise dans une histoire pour laquelle on ne se sent pas concerné, pour la raison qu’on n’en a pas encore connaissance. Mais cette affaire de commencement est loin d’être innocente, comme le montrent les enfants en dispute, ou les couples en crise, pour décider qui a commencé. Deux peuples qui revendiquent le même territoire ne se référent pas au même calendrier des origines. Décalez le commencement d’une histoire, et vous en modifierez toute la signification, comme le sait tout monteur de séquences vidéo, selon que vous serez du côté de l’un ou l’autre des belligérants. Le problème est qu’il n’y a jamais de début réel. Allez-y pour la création du monde si ça vous rassure, mais il faudra alors nous expliquer d’où sort votre créateur, ou d’où provient le je ne sais quoi physique inexistant d’où serait sorti toute cette affaire. Faut-il commencer les histoires d’amour au premier regard des amants, ou au moment délicat de leur enfance oedipienne, quand ils mettaient en place les structures psychiques inconscientes qui rendront possible ultérieurement l’accrochage de ces regards ? Toute histoire résulte d’un faux départ, toute histoire est falsification par choix d’un faux commencement.
Mais le problème de la fin n’est pas moins simple. Le film s’arrête quand enfin l’amour triomphe, juste au moment de la promesse d’être heureux et d’avoir beaucoup d’enfants. Mais pourquoi alors s’arrêter avant ce que sera la longue vie ultérieure ? Parce que le bonheur n’a pas d’histoire, ou parce qu’il vaut mieux ne pas le suivre trop longtemps, jusqu’à la routine, jusqu’au désabusement ? Shakespeare est d’une sage prudence à faire mourir les amants de Vérone. Juliette, la quarantaine empâtée, dans les vapeurs d’alcool, réprimandant son paresseux de fils pour son inactivité chronique, ça détruirait rétroactivement la beauté des antécédents. Qui sait même, elle aurait peut être fini par quitter Roméo, pour un amant de passage. Il faut toujours s’arrêter suffisamment tôt dans la narration pour que le héros en reste un. Le sens de l’histoire est recomposé dans son ensemble à chaque nouvel épisode. Il est difficile après le divorce de conserver les versions antérieures de la belle histoire d’amour. Et pourtant, il aurait suffi, toutes choses égales d’ailleurs, que l’un ou l’autre se fasse écraser à temps, pour que la même histoire conserve le sens qu’elle a perdu. Toute histoire n’existe que mise dans la perspective d’une fin fictive et arbitraire, toute histoire prétend clôturer ce qui reste indéfiniment ouvert.
 |
Comment s’opèrent donc ces différents choix qui constituent l’histoire ? Quoiqu’on prétende, la réalité n’en impose jamais réellement, et, à y regarder attentivement, il est même assez rare qu’elle en propose simplement. Les limites adoptées ne traduisent rien d’autre que les préoccupations des usagers, producteurs et consommateurs. Nous n’admettons cependant pas facilement que la consistance de l’histoire ne renvoie qu’aux convictions du sujet. Pourtant le mécanisme est simple. Ce qui fait la consistance, c’est la force de l’impression. Quelle impression plus forte pourrais-je avoir que d’être convaincu ? L’histoire paraît solide parce que j’y crois, et ce n’est qu’ensuite que j’y crois parce qu’elle paraît solide. Les autres versions, et encore plus un morceau de réalité sans histoire, me paraissent invraisemblables, décousues, insensées. Et d’une certaine façon, elles le sont bien, pas par rapport à ce à quoi elles se référent, mais par rapport à la réalité psychique de ceux qui n’y croient pas. L’histoire dit au moins la vérité, ou plutôt montre au moins la vérité sur ceux qui l’adoptent. On pourrait adopter la formule, quelque peu détournée, raconte-moi tes histoires, je te dirai qui tu es. |
L’histoire des histoires est cependant encore plus complexe. Car s’il est vrai qu’on y est toujours dans une ré élaboration permanente d’un passé qui n’a jamais eu lieu de cette manière là, cette affaire peut se jouer selon des subtilités temporelles raffinées. Comme notre grammaire nous a déjà initiés au futur antérieur, nous pouvons y adjoindre du passé ultérieur. Les histoires sont souvent écrites d’avance. Prenez l’exemple de l’enfant à naître. Le pauvre ne se doute pas dans quoi il va mettre les pieds. Nous ne parlons pas de l’allure déconcertante du monde dans son ensemble, mais du lieu plus précis de ses futurs premiers pas, disons de manière vague et conformiste, sa famille. Il va progressivement prendre conscience des exigences parfois draconiennes du scénario, avec lequel il n’est pas impossible qu’il entre en conflit. Il lui faudra, selon l’expression, être pharmacien parce que papa ne l’était pas. Ou parce qu’il l’était. Il lui faudra être sportif, il lui faudra être intellectuel, c’est selon, parce que c’est pour cela qu’on l’aura mis au monde. Peut-être devra-t-il passer des années à essayer de faire oublier qu’il n’est pas le garçon, ou qu’il n’est pas la fille qu’on avait espéré. Bref, il comprendra qu’on avait déjà écrit l’histoire sans lui. Qu’il ne lui reste plus qu’à s’y inscrire, ou à être considéré comme un joueur récalcitrant, avec toutes les conséquences que cela méritera. Il est fréquent dans les procès, pour lesquels l’accusé relève d’une des grandes catégories criminologiques idéologiquement à la mode, que celui-ci constate avec angoisse et impuissance qu’il n’est là que pour remplir de sa présence personnelle, au fond indifférente, une histoire toute faite. La foule réclame son châtiment, et s’indignerait d’un éventuel innocentement, car ce qui compte n’est pas le matériau humain interchangeable qui l’habite accidentellement, mais l’histoire même, dans la certitude de son auto-affirmation. Le coupable est coupable, puisque c’est le coupable, et il est indigne d’innocenter un coupable. Quant au pauvre naïf qui voudrait faire comprendre qu’il a son histoire à lui, il a bien peu de chances de faire réviser la version du grand modèle social.
Partant de tous ces constats, on comprend aisément qu’il est dans la nature de l’histoire d’avoir des versions différentes. Suivant que vous ne procéderez qu’à de subtiles modulations, ou a des réajustements plus conséquents, vous vous classerez dans les exégètes érudits, friands de petits glissements incompréhensibles du profane, ou dans les francs hérétiques, à condamner d’urgence. Déplacer le début de quelques années, la fin de quelques secondes, ou le contraire, faites déborder quelques kilomètres à droite, quelque centimètres à gauche, changez légèrement la tonalité du registre, incluez-y quelque composante qui en avait été exclue, comme les problèmes de placement financier dans une belle histoire d’amour romantique, et vous obtenez des variantes multiples, à volonté. Chacun campera bien sûr sur la vérité propre de son histoire, à l’exception des apostats, et estimera très vils et malhonnêtes tous les faux frères des versions abusives. Mais certains honteux sceptiques joueront au contraire aux décaleurs d’histoire, faisant exprès de mettre du jeu dans les montages les mieux calés, histoire de laisser entrevoir la perspective, ne serait-ce que l’espace d’une petite faille, de tout ce que même les diverses variantes laissent échapper. Si le terme n’était pas déjà utilisé pour désigner des pratiques plus condamnables, on pourrait appeler cette occupation diversement appréciée, mais si salutaire, du révisionnisme d’histoire. A défaut, proposons donc d’appeler le pratiquant de ce beau métier d’intérêt public, mais qui reste encore à instituer officiellement, le réviseur d’histoire.
Il ne faudrait pas pour autant s’en tenir à l’idée que toute histoire est mensongère. Car il faudrait distinguer entre la variante mensongère et celle de la mauvaise foi. L’histoire mensongère est bien sûr une espèce extrêmement répandue, mais elle paraîtra moins intéressante au réviseur, professionnel ou amateur, parce que le fait qu’elle est mensongère tend à escamoter celui, plus grave, qu’elle est une histoire. Mentir ou pas, si vous êtes accusé de quoique ce soit, amène une différence par le fait particulier que vous vous déclarez innocent plutôt que coupable. Mais sur le véritable problème général, à savoir que le fait incriminé est coupable, ça revient au même. Oui, j’ai commis l’adultère ; non, je ne l’ai pas commis, les deux réponses, quoiqu’il en soit des faits, préservent le même scénario, qu’il serait coupable d’aimer hors de la légalité coutumière. La réponse qui casserait l’histoire, consisterait, comme esquissé à l’instant, de contester le sens même de la notion. L’histoire est de mauvaise foi, parce qu’elle n’accepte de se voir elle-même que revêtue des beaux habits de la vérité. Le mensonge nie en être un pour ses destinataires, mais suppose une lucidité au moins minimale de la part de son producteur. La mauvaise foi n’accepte pas à ses propres yeux d’être mensongère, a fortiori refuse-t-elle d’être mauvaise foi. Les authentiques raconteurs d’histoire ne sont donc pas ceux qui se présentent tels, pas plus que Machiavel n’était machiavélique, puisqu’il en parlait. Les véritables diseurs nient tout le travail caché sous leur récit. Les histoires n’aiment pas qu’on les prenne pour des histoires, car elles-mêmes ne se considèrent pas telles. |
L’humanité, friande d’histoire, en produit à foison. Évidemment, cette profusion crée des incompatibilités multiples. Et l’on se montrera souvent très intolérant face aux incroyables histoires des autres, souvent jugées aussi stupides que méchantes. L’histoire des hommes est l’histoire des histoires, pleine de bruits et de fureur, chacune ayant en outre plus ou moins la prétention d’être celle qui rend compte de toutes les autres. Mais dans ces déchirements perpétuels et souvent sanguinaires, il est une chose encore plus honnie que toutes les concurrentes, c’est le refus de toute histoire. Entre deux guerres de religion, on peut jouer l’oecuménisme, mais c’est alors pour mieux faire face aux agnostiques. Ainsi, dans certains pays où l’on a l’esprit large, on admet très bien que coexistent des confessions diverses, et la constitution garantit même éventuellement la liberté de culte. Mais on y exige que soit portée sur les papiers d’identité l’appartenance religieuse. Vous êtes libres d’adhérer à l’histoire de votre choix, mais pas de n’en avoir aucune. Une autre version est qu’il faut être de droite ou de gauche, à la rigueur du centre, mais pas de nulle part. D’ailleurs, on vous expliquera que ce non lieu n’existe pas. Il existe des apostats, généralement soigneusement méprisés, ces renégats qui trahissent l’histoire à laquelle ils ont une fois adhérée. Mais il y a encore plus méprisé, ce sont les nomades de l’histoire. Ceux qui, avec une désinvolture éhontée, se promènent d’histoire en histoire, certains avec à chaque fois la sincérité du moment, d’autres, encore plus odieux et inquiétants, ne se donnant même pas la peine à chaque fois de faire semblant d’y croire. Infidèles d’entre les infidèles, qui jouent sans foi la pluralité mouvante des histoires, parfois même pour le plaisir.
Car après tout, toute histoire a sa beauté, pourvu qu’on n’y croit pas. Ce qui constitue le caractère le plus nuisible de l’histoire n’est pas qu’elle soit toujours fantaisiste, en regard du réel qu’elle occulte. C’est qu’elle prétende non seulement être la seule lecture autorisée de ce réel, mais encore être ce réel même. Et sa force est telle qu’elle parvient souvent à s’y substituer, dans la tête des hommes s’entend. Ainsi en est-il par exemple du traumatisme. A faits identiques, à douleur égale, d’aucuns passeront l’événement comme une péripétie, d’autres en auront leur vie à jamais bloquée. La petite fille peut rire aux éclats face à l’exhibitionniste, elle peut ne pas même avoir remarqué qu’il y avait une anomalie dans le tableau, elle peut aussi y trouver l’origine de l’hystérie redoutable dont elle ne se relèvera jamais. La différence entre ces trois options, parmi d’autres possibles, ne provient pas des faits extérieurs tels qu’en eux-mêmes, elle se situe dans le scénario avec lequel on les appréhende. Ceux qui de force vous amènent leur psychiatre à chaque occasion litigieuse, ne voudraient surtout pas manquer une représentation de leur histoire, attestant une fois de plus de sa véracité. Malgré toute l’injustice polémique de la boutade, on peut comprendre la part de bien-fondé du mot de Karl Kraus, accusant la psychanalyse d’inventer les maladies qu’elle prétend guérir. On peut être malade du diagnostic, et il doit en être plus d’un qui s’est résigné à se sentir traumatisé, ou malheureux, parce que l’histoire l’exigeait, et qu’il aurait fini par se croire anormal d’en rester à sa réaction bénigne première. Prenez un agressé quelconque, sur le point de passer à autre chose, entourez-le d’un psychiatre, d’un journaliste, et d’un moraliste quelconque, bien malin s’il en réchappe.
| L’histoire est dangereuse parce qu’elle contraint à n’appréhender qu’à travers elle, ce qui présente divers inconvénients graves. On y rate la multiplicité ouverte qu’offre notre insertion incertaine au monde. Là où dix mille aventures sont possibles, dont on n’imagine même pas les péripéties insoupçonnables qu’elles pourraient nous offrir, il va falloir se contenter d’une version convenue. Alors qu’on pourrait risquer la joie subtile que pourrait nous procurer la curiosité inquiète des chemins incertains, on s’enfermera dans ces visites guidées toutes tracées. A la place d’une véritable découverte, délicieusement ignorante du lendemain, comme du plus loin, un synopsis rédigé comme un plan de carrière. Au lieu d’une véritable vie s’inventant à mesure des rencontres qu’elle n’avait pas prévues, le rabâchage sans surprise d’un petit jeu de scénarios stéréotypés, à l’imagination limitée, frôlant parfois le minable. Et même quand elles offrent quelque exubérance dans leur détail, les histoires ne peuvent que rester en deçà, fort en deçà, pour toutes les raisons dites. Dans ces conditions, aussi profuses soient-elles, elles ne peuvent que travailler dans la distorsion, nous obligeant à de grands écarts acrobatiques et douloureux. Car le réel, nous en sommes, nous ne pouvons y échapper, ne serait-ce que dans notre chair. Quel malhonnête osera dire qu’entre la réalité de la sexualité et les histoires d’amour, il n’a jamais senti plus qu’une distorsion, une déchirure douloureuse ? Qu’entre le roman social ressassé à l’écœurement, version libérale ou version sociale, peu importe, et les situations réellement vécues en deçà de ces élaborations secondaires, il n’a jamais perçu qu’existait un gouffre tel qu’on éprouverait de la difficulté à en dire l’ampleur ? |
Les histoires sont dangereuses, parce qu’elles confisquent les mots, et obligent à leur usage dûment accrédité. Les histoires ne plaisantent pas. Le désir du vrai, qui alimente chez tous le terrorisme, est inscrit dans notre usage le plus incontrôlé du langage, au point que tout discours paraît déployer sa prétention dire le vrai, par une sorte de vulgarité irrémédiable. L’avertissement nous en est donné dans un petit ouvrage au fort beau titre, Rudiments païens, de Jean-François Lyotard. Il y a ceux qui ont le pouvoir de disposer des histoires et de les répandre, soit qu’ils aient la capacité de les raconter, soit qu’ils contrôlent les véhicules de leur transmission. Devant la multiplication, toutefois plus réduite qu’on ne le prétend, des francs-tireurs dans les rangs des premiers, les seconds ont su, au fil des siècles, prendre leurs dispositions pour y mettre de l’ordre. Sous tous les régimes politiques, y compris ceux qui se revendiquent comme défenseurs des libertés, il est un certain nombre d’histoires qu’il est interdit de contester, sous peines de désagréments divers, pouvant aller jusqu’aux plus graves. Cherchez donc sous vos propres cieux, c’est un exercice intéressant, si vous en avez le courage. Les religions tout spécialement, se montrent très sourcilleuses qu’aucun maniement jugé irrévérencieux ne soit fait des thèmes marquants de leur dogme, nom que l’on donne alors aux histoires intouchables. Ceux qui parviennent à détenir les droits d’auteur ou les droits d’exploitation sur une histoire, ont en main l’existence de leurs contemporains. Ils possèdent le moyen par lequel les autres penseront leur propre existence. Les histoires sont le moyen idéal de l’oppression, tenant les autres comme dans une toile d’araignée dont ils ne peuvent se déprendre.
Les maîtres des histoires n’aiment guère que l’on joue sans permission aux petites variantes. Qu’à la rigueur on polisse un petit détail sans importance, si ça fait mieux vendre, après tout pourquoi pas. Il faut bien tolérer les artistes et les idéalistes. Mais la menace d’hérésie n’est jamais loin, avec tous les enfers consécutifs. Cela ne signifie pas pour autant que les histoires soient figées pour l’éternité, mais que les détenteurs légitimes des orthodoxies ont le privilège des révisions. Il est en effet judicieux, pour conserver son pouvoir, de faire preuve jusqu’à une certaine mesure d’adaptabilité. Aussi faut-il parfois recaler les schémas, pour faire face aux risques de dérives, de dépassement, parfois même de subversion. Ou simplement à titre préventif. On s’est moqué des photos soviétiques à géométrie variable. Au fil des disgrâces, le cercueil de Lénine était porté par un nombre rétréci de porteurs, à tel point qu’on pouvait craindre, si le régime avait duré encore quelques temps, qu’il ne finît par se déplacer par lévitation. Mais ce n’est que la version cocasse d’un procédé très usité. On peut faire face à presque tout, en changeant la version. Dans un très beau livre d’Aldous Huxley, injustement délaissé, Le plus sot animal…, l’auteur note que la grande force du christianisme a longtemps été d’avoir su composer ses histoires avec celles de ceux qu’il prétendait résorber. Cette même religion, qui en envoya plus d’un se faire rôtir pour avoir pris des libertés avec un point ou l’autre du scénario, fut capable d’adapter l’intrigue avec le platonisme, l’aristotélisme, aussi bien qu’avec l’animisme africain, au gré des opportunités. Apte à livrer la version obtuse du dogme, genre saint Bernard, comme à concocter celle pour intellectuels raffinés, style saint Thomas. Un beau travail d’artiste, souplesse et intransigeance.
Certains optimistes post-modernes se complaisent à penser que nous entrerions dans le crépuscule des histoires. On peut tout de même se demander, non pas s’ils prennent leurs désirs pour des réalités, la formule serait trop ambiguë en l’occurrence, mais s’ils ne donnent pas à leur tour, quoique de manière plus subtile que dans la balourde version hégélienne, dans l’histoire amusante qui nous conte la fin des histoires. C’est un peu comme l’histoire absurde, racontée par Serge Leclaire, du chauffeur qui transportait un trou dans son camion. Un cahot de trop, et le trou tomba. L’homme s’en rendant compte, recula pour reprendre possession, et le camion tomba dans le trou. Il y eut déjà les prophètes de la mort de dieu, disons qu’il a l’agonie lente. Nous avons maintenant les annonciateurs de la mort du récit. Certes il s’est agi, dans l’un et l’autre cas, d’esprits nobles devant qui s’incliner. Mais de là à partager ce bel enthousiasme…
Pour changer de registre
 | Par l'auteur de cette page, quelques textes pouvant valoir le détour : les recueils de nouvelles. |
màj 220610 |