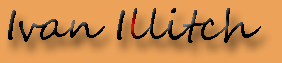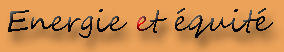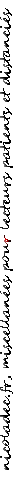Les politiques de l’énergie qui seront appliquées dans les dix prochaines années décideront de la marge de liberté dont jouira une société en l’an 2000. Une politique de basse consommation d’énergie permet une grande variété de modes de vie et de cultures. La technique moderne peut être économe en matière d’énergie, elle laisse la porte ouverte à différentes options politiques. Si, au contraire, une société se prononce pour une forte consommation d’énergie, alors elle sera obligatoirement dominée dans sa
structure par la technocratie et, sous l’étiquette capitaliste ou socialiste, cela deviendra pareillement intolérable.
Aujourd’hui encore, la plupart des sociétés — surtout celles qui sont pauvres — sont libres d’orienter leur politique de l’énergie dans l’une de ces trois directions : elles peuvent lier leur prospérité à une forte consommation d’énergie par tête, ou à un haut rendement de la transformation de l’énergie, ou encore à la moindre utilisation possible d’énergie mécanique. La première exigerait, au profit de l’industrie, une gestion serrée des approvisionnements en carburants rares et destructeurs. La seconde placerait au premier plan la réorganisation de l’industrie, dans un
souci d’économie thermodynamique. Ces deux voies appellent aussi d’énormes dépenses publiques pour renforcer le contrôle social et réaliser une immense réorganisation de l’infrastructure. Toutes deux réitèrent l’intérêt de Hobbes, elles rationalisent l’institution d’un Léviathan appuyé sur les ordinateurs. Toutes deux sont à présent l’objet de vastes discussions. Car le dirigisme rigoureux, comme le métro-express à pilotage automatique, sont des ornements bourgeois qui permettent de substituer à l’exploitation écologique une exploitation sociale et psychologique.
Or la troisième possibilité, la plus neuve, est à peine considérée : on prend encore pour une utopie la conjonction d’une maîtrise optimale de la nature et d’une puissance mécanique limitée. Certes, on commence à accepter une limitation écologique du maximum d’énergie consommée par
personne, en y voyant une condition de survie, mais on ne reconnaît pas dans le minimum d’énergie acceptable un fondement nécessaire à tout ordre social qui soit à la fois justifiable scientifiquement et juste politiquement. Plus que la soif de carburant, c’est l’abondance d’énergie qui a mené à l’exploitation. Pour que les rapports sociaux soient placés sous le signe de l’équité, il faut qu’une société limite d’elle-même la consommation d’énergie de ses plus puissants citoyens. La première condition en est une technique économe en énergie, même si celle-ci ne peut garantir le règne de l’équité. De plus, cette troisième possibilité est la seule qui s’offre à toutes les nations : aujourd’hui, aucun
pays ne manque de matières premières ou de connaissances nécessaires pour réaliser une telle politique en moins d’une génération. La démocratie de
participation suppose une technique de faible consommation énergétique et, réciproquement, seule une volonté politique de décentralisation peut créer les
conditions d’une technique rationnelle.
On néglige en général le fait que l’équité et l’énergie ne peuvent augmenter en harmonie l’une avec l’autre que jusqu’à un certain point. En deçà d’un seuil déterminé d’énergie par tête, les moteurs améliorent les conditions du progrès social. Au-delà de ce seuil, la consommation d’énergie augmente aux dépens de l’équité. Plus l’énergie abonde, plus le contrôle de cette énergie est mal réparti. Il ne s’agit pas ici d’une limitation de la capacité technique à mieux répartir ce contrôle de l’énergie,
mais de limites inscrites dans les dimensions du corps humain, les rythmes sociaux et l’espace vital.
On croit souvent trouver un remède universel à ces maux dans l’hypothèse de carburants non polluants et disponibles en abondance, mais c’est là retourner au sophisme politique qui imagine pouvoir accorder, dans certaines conditions politiques, le règne d’une équité et d’une consommation d’énergie également illimitées. On confond bien-être et abondance énergétique, telle que l’énergie nucléaire la promet pour 1990. Si nous acceptons cette vue illusoire, alors nous tendrons à négliger toute limitation énergétique socialement motivée et à nous laisser aveugler par des considérations écologiques : nous accorderons à l’écologiste que l’emploi de forces d’origine non physiologique pollue l’environnement, et nous ne verrons pas qu’au-delà d’un certain seuil, les forces mécaniques corrompent le milieu social. Le seuil de la désintégration sociale due aux grandes quantités d’énergie est indépendant du seuil auquel la transformation de l’énergie se retourne en destruction physique. Ce seuil, exprimé en kWh ou en calories, est sans doute peu élevé. Le concept de quanta d’énergie socialement critiques doit d’abord être élucidé en théorie avant qu’on puisse discuter la question politique de la consommation d’énergie à laquelle une société doit limiter ses membres.
Dans des travaux antérieurs, j’ai montré qu’au-delà d’une certaine valeur du PNB, les frais du contrôle social croissent plus vite que ledit PNB et deviennent l’activité institutionnelle qui détermine toute l’économie. La thérapie que dispensent éducateurs, psychiatres et travailleurs sociaux, doit venir s’ajouter aux programmes établis par les planificateurs, les gestionnaires et les directeurs de vente, et compléter l’action des services de renseignements, de l’armée et de la police. Mon analyse de l’industrie scolaire avait pour objet de le prouver dans un domaine restreint. Ici je voudrais avancer une raison de ce que plus d’énergie consommée demande plus de domination sur autrui. Je prétends qu’au-delà d’un niveau critique de consommation
d’énergie par tête, dans toute société, le système politique et le contexte culturel doivent dépérir. Dès que le quantum critique d’énergie consommée par personne est dépassé, aux garanties légales qui protégeaient les initiatives individuelles concrètes on substitue une éducation qui sert les visées abstraites d’une technocratie. Ce quantum marque la limite où l’ordre légal et l’organisation politique doivent s’effondrer, où la structure technique des moyens de production fait violence à la structure sociale.
Même si on découvrait une source d’énergie propre
et abondante, la consommation massive d’énergie aurait toujours sur le corps, social le même effet que l’intoxication par une drogue physiquement inoffensive, mais psychiquement asservissante. Un peuple peut choisir entre la méthadone et une désintoxication volontaire dans la solitude, entre le maintien de l’intoxication et une victoire douloureuse sur le manque, mais nulle société ne peut s’appuyer là-dessus pour que ses membres sachent en même temps agir de façon autonome et dépendre d’une consommation énergétique toujours en hausse. A mon avis, dès que le rapport entre force mécanique et énergie métabolique dépasse un seuil fixe déterminable, le règne de la technocratie s’instaure. L’ordre de grandeur où ce seuil se place est largement indépendant du niveau technique atteint, pourtant dans les pays assez riches et très riches sa seule existence semble reléguée au point aveugle de l’imagination sociale.
Comme les États-Unis, le Mexique a dépassé ce seuil critique; dans les deux cas, tout input supplémentaire d’énergie ne fait qu'augmenter l’inégalité, l’inefficacité et l’impuissance. Bien que le revenu par habitant atteigne dans le premier pays 5 000 dollars et dans le second 500 dollars, les énormes intérêts investis dans l’infrastructure industrielle les poussent tous deux à accroître encore leur consommation d’énergie. Les idéologues américains ou mexicains donnent à leur insatisfaction le nom de crise de l’énergie, et les deux pays s’aveuglent pareillement sur le fait
que ce n’est pas la pénurie de carburants, ni l’utilisation gaspilleuse,
irrationnelle et nuisible à l’environnement de l’énergie disponible qui menacent
la société, mais bien plutôt les efforts de l’industrie pour gaver la société de
quanta d’énergie qui inévitablement dégradent, dépouillent et frustrent
la plupart des gens. Un peuple peut être suralimenté par la surpuissance de ses
outils tout aussi bien que par la survaleur calorique de sa nourriture, mais il
s’avouera plus difficilement la sursaturation énergétique que la nécessité de
changer de régime alimentaire.
La quantité d’énergie consommée par tête qui
représente un seuil critique pour une société, se place dans un ordre de
grandeur que peu de nations, sauf la Chine de la révolution culturelle, ont pris
en considération. Cet ordre de grandeur dépasse largement le nombre de kwh dont
disposent déjà les quatre cinquièmes de l’humanité, et il reste très inférieur à
l’énergie totale que commande le conducteur d’une petite voiture de tourisme. Ce
chiffre apparaît, aux yeux du sur-consommateur comme a ceux du
sous-consommateur, comme dépourvu de sens. Pour les anciens élèves de n’importe
quel collège, prétendre limiter le niveau d’énergie revient à détruire l’un des
fondements de leur conception du monde. Pour la majorité des Latino-Américains,
atteindre ce même niveau d’énergie signifie accéder au monde du moteur. Les uns
et les autres n’y parviennent que difficilement. Pour les primitifs, l’abolition
de l’esclavage est subordonnée à l’introduction d’une technique moderne
appropriée; pour les pays riches, le seul moyen d’éviter une exploitation encore
plus dure consiste à reconnaître l’existence d’un seuil de consommation
d’énergie, au-delà duquel la technique dictera ses exigences à la société. En
matière biologique comme en matière sociale, on peut digérer un apport calorique
tant qu’il reste dans la marge étroite qui sépare assez de trop.
La soi-disant crise de l’énergie est un concept
politiquement ambigu. Déterminer la juste quantité d’énergie à employer et la
façon adéquate de contrôler cette même énergie, c’est se placer à la croisée des
chemins. A gauche, peut-être un déblocage et une reconstruction politique d’où
naîtrait une économie postindustrielle fondée sur le travail personnel, une
basse consommation d’énergie et la réalisation concrète de l’équité. A droite,
le souci hystérique de nourrir la machine redouble l’escalade de la croissance
solidaire de l’institution et du capital et n’offre pas d’autre avenir qu’une
apocalypse hyper-industrielle. Choisir la première voie, c’est retenir le
postulat suivant : quand la dépense d’énergie par tête dépasse un certain seuil
critique, l’énergie échappe au contrôle politique. Que des planificateurs
désireux de maintenir la production industrielle à son maximum promulguent une
limitation écologique à la consommation d’énergie ne suffira pas à éviter
l’effondrement social. Des pays riches comme les États-Unis, le Japon ou la
France ne verront pas le jour de l’asphyxie sous leurs propres déchets,
simplement parce qu’ils seront déjà morts dans un coma énergétique. A l’inverse,
des pays comme l’Inde, la Birmanie ou, pour un temps encore, la Chine sont assez
musclés pour savoir s’arrêter juste avant le collapsus. Ils pourraient dès à
présent décider de maintenir leur consommation d’énergie au-dessous de ce seuil
que les riches devront aussi respecter pour survivre.
Choisir un type d’économie consommant un minimum
d’énergie demande aux pauvres de renoncer à leurs lointaines espérances et aux
riches de reconnaître que la somme de leurs intérêts économiques n’est qu’une
longue chaîne d’obligations. Tous devraient refuser cette image fatale de
l’homme en esclavagiste qu’installe aujourd’hui la faim, entretenue par les
idéologies, d’une quantité croissante d’énergie. Dans les pays où le
développement industriel a fait naître l’abondance, la crainte de la crise de
l’énergie suffit à augmenter les impôts bientôt nécessaires pour que des
méthodes industrielles nouvelles, plus propres et davantage encore porteuses de
mort remplacent celles qu’a rendues désuètes une sur expansion dépourvue
d’efficacité. Aux leaders des peuples que ce même procès d’industrialisation a
dépossédés, la crise de l’énergie sert d’alibi pour centraliser la production,
la pollution et le pouvoir de contrôle, pour chercher, dans un sursaut
désespéré, à égaler les pays mieux pourvus de moteurs. Maintenant les pays
riches exportent leur crise et prêchent aux petits et aux pauvres le nouvel
évangile du culte puritain de l’énergie. En semant dans le tiers monde la
nouvelle thèse de l’industrialisation économe en énergie, on apporte plus de
maux aux pauvres qu’on ne leur en enlève, on leur refile les produits coûteux
d’usines déjà démodées. Dès qu’un pays pauvre accepte la doctrine que plus
d’énergie bien gérée fournira toujours plus de biens à plus de gens, il est
aspiré dans la course à l’esclavage par l’augmentation de la production
industrielle. Quand les pauvres acceptent de moderniser leur pauvreté en
devenant dépendants de l’énergie, ils renoncent définitivement à la possibilité
d’une technique libératrice et d’une politique de participation : à leur place,
ils acceptent un maximum de consommation énergétique et un maximum de contrôle
social sous la forme de l’éducation moderne.
A la paralysie de la société moderne, on donne le
nom de crise de l’énergie; on ne peut la vaincre en augmentant l’input
d’énergie. Pour la résoudre, il faut d’abord écarter l’illusion que notre
prospérité dépend du nombre d’esclaves fournisseurs d’énergie dont nous
disposons. A cet effet, il faut déterminer le seuil au-delà duquel l’énergie
corrompt, et unir toute la communauté dans un procès politique qui atteigne ce
savoir et fonde sur lui une autolimitation. Parce que ce genre de recherche va
à l’opposé des travaux actuels des experts comme des institutions, je lui donne
le nom de contre-recherche. Elle compte trois étapes. D’abord la nécessité de
limiter la consommation d’énergie par tête doit être reconnue comme un impératif
théorique et social. Ensuite il faut déterminer l’intervalle de variation où se
situent ces grandeurs critiques. Enfin chaque société doit fixer le degré
d’injustice, de destruction et d’endoctrinement que ses membres sont prêts à
accepter pour le plaisir d’idolâtrer les machines puissantes et de se plier
docilement aux injonctions des experts.
La nécessité de conduire une recherche politique
sur la consommation d’énergie socialement optimale peut être illustrée sur
l’exemple de la circulation. D’après Herendeen, les États-Unis dépensent 42 % de
leur énergie totale pour les voitures : pour les fabriquer, les entretenir,
chercher une place où les garer, faire un trajet ou entrer en collision. La plus
large part de cette énergie est utilisée au transport des personnes. Dans cette
seule intention, 250 millions d’Américains dépensent plus de carburant que n’en
consomment, tous ensemble, les 1 300 millions de Chinois et d’Indiens. Presque
toute cette énergie est brûlée en une immense danse d’imploration, pour se
concilier les bienfaits de l’accélération mangeuse-de-temps. Les pays pauvres
dépensent moins d’énergie par personne, mais au Mexique ou au Pérou on consacre
à la circulation une plus grande part de l’énergie totale qu’aux États-Unis, et
cela pour le seul profit d’une plus faible minorité de la population. Le volume
de cette activité la rend commode et significative pour que soit démontrée, sur
l’exemple du transport des personnes, l’existence de quanta d’énergie
socialement critiques.
Dans la circulation, l’énergie dépensée pendant un
certain temps se transforme en vitesse. Aussi le quantum critique prend
ici la forme d’une limite de vitesse. Chaque fois que cette limite a été
dépassée, on a vu s’établir le même processus de dégradation sociale sous
l’effet de hauts quanta d’énergie. Au XIXe siècle, en
Occident, dès qu’un moyen de transport public a pu franchir plus de 25
kilomètres à l’heure, il a fait augmenter les prix, le manque d’espace et de
temps. Le transport motorisé s’est assuré le monopole des déplacements et il a
figé la mobilité personnelle. Dans tous les pays occidentaux, durant les
cinquante années qui ont suivi la construction du premier chemin de fer, la
distance moyenne parcourue annuellement par un passager (quel que soit le mode
de transport utilisé) a presque été multipliée par cent. Quand ils produisent
plus d’une certaine proportion d’énergie, les transformateurs mécaniques de
carburants minéraux interdisent aux hommes d’utiliser leur énergie métabolique
et les transforment en consommateurs esclaves des moyens de transport. Cet effet
de la vitesse sur l’autonomie de l’homme n’est affecté que marginalement par les
caractéristiques techniques des véhicules à moteur ou par l’identité des
personnes et des groupes qui détiennent la propriété légale des lignes
aériennes, des autobus, des trains et des voitures. Une vitesse élevée est le
facteur critique qui fait des transports un instrument d’exploitation sociale.
Un véritable choix entre les systèmes politiques et l’établissement de rapports
sociaux fondés sur une égale participation n’est possible que là où la vitesse
est limitée. Instaurer une démocratie de participation, c’est retenir une
technique économe en matière d’énergie. Entre des hommes libres, des rapports
sociaux productifs vont à l’allure d’une bicyclette, et pas plus vite.
Je voudrais illustrer la question générale d’une
consommation d’énergie ayant sa valeur sociale optimale avec l’exemple précis du
transport. Encore ici me bornerai-je à traiter du transport des personnes, de
leurs bagages et de tout ce qui est indispensable (carburants, matériaux,
outils) à l’entretien des routes et des véhicules. J’omets volontairement ce qui
concerne le transport des marchandises et celui des messages. Bien que le même
schéma d’argumentation soit acceptable dans ces deux derniers cas, il faudrait
donner à la démonstration détaillée un autre tour et je me réserve d’en traiter
ultérieurement.
Chapitre II : L’industrie de la circulation
La circulation totale est le résultat de deux
différents modes d’utilisation de l’énergie. En elle se combinent la mobilité
personnelle ou transit autogène et le transport mécanique des gens. Par
transit je désigne tout mode de locomotion qui se fonde sur énergie
métabolique de l’homme, et par transport, toute forme de déplacement qui
recourt à d’autres sources d’énergie. Désormais ces sources d’ énergie seront
surtout des moteurs, puisque les animaux, dans un monde surpeuplé et dans la
mesure où ils ne sont pas, tels l’âne et le chameau, des mangeurs de chardons,
disputent à l’homme avec acharnement leur nourriture. Enfin je borne mon examen
aux déplacements des personnes à l’extérieur de leurs habitations.
Dès que les hommes dépendent du transport non
seulement pour des voyages de plusieurs jours, mais aussi pour les trajets
quotidiens, les contradictions entre justice sociale et motorisation, entre
mouvement effectif et vitesse élevée, entre liberté individuelle et itinéraires
obligés apparaissent en toute clarté. La dépendance forcée à l’égard de
l’automobile dénie à une société de vivants cette mobilité dont la mécanisation
des transports était le but premier. L’esclavage de la circulation commence.
Vite expédié, sans cesse véhiculé, l’homme ne peut
plus marcher, cheminer, vagabonder, flâner, aller à l’aventure ou en pèlerinage.
Pourtant il doit être sur pied aussi longtemps que son grand-père. Aujourd’hui
un Américain parcourt en moyenne autant de kilomètres à pied que ses aïeux, mais
c’est le plus souvent dans des tunnels, des couloirs sans fin, des parkings ou
des grands magasins.
A pied, les hommes sont plus ou moins à égalité.
Ils vont spontanément à la vitesse de 4 à 6 kilomètres à l’heure, en tout lieu
et dans toute direction, dans la mesure où rien ne leur est défendu légalement
ou physiquement. Améliorer cette mobilité naturelle par une nouvelle technique
de transport, cela devrait lui conserver son propre degré d’efficacité et lui
ajouter de nouvelles qualités : un plus grand rayon d’action, un gain de temps,
un meilleur confort, des possibilités accrues pour les handicapés. Au lieu de
quoi, partout jusqu’ici, le développement de l’industrie de la circulation a eu
des conséquences opposées. Dès que les machines ont consacré à chaque voyageur
plus qu’une certaine puissance en chevaux-vapeur, cette industrie a diminué
l’égalité entre les gens, restreint leur mobilité en leur imposant un réseau
d’itinéraires obligés produits industriellement, engendré un manque de temps
sans précédent. Dès que la vitesse de leur voiture dépasse un certain seuil, les
gens deviennent prisonniers de la rotation quotidienne entre leur logement et
leur travail.
Si on concède au système de transport plus d’un
certain quantum d’énergie, cela signifie que plus de gens se déplacent
plus vite sur de plus longues distances chaque jour et consacrent au transport
de plus en plus de temps. Chacun augmente son rayon quotidien en perdant la
capacité d’aller son propre chemin. On constitue d’extrêmes privilèges au prix
d’un asservissement général. En une vie de luxueux voyages, une élite franchit
des distances illimitées, tandis que la majorité perd son temps en trajets
imposes pour contourner parkings et aérodromes. La minorité s’installe sur ses
tapis volants pour atteindre des lieux éloignés que sa fugitive présence rend
séduisants et désirables, tandis que la majorité est forcée de travailler plus
loin, de s’y rendre plus vite et de passer plus de temps à préparer ce trajet ou
à s’en reposer.
Aux États-Unis, les quatre cinquièmes du temps
passé sur les routes concernent les gens qui circulent entre leur maison, leur
lieu de travail et le supermarché. Et les quatre cinquièmes des distances
parcourues en avion chaque année pour des congrès ou des voyages de vacances le
sont par 1,5 % de la population, c’est-à-dire par ceux que privilégient leur
niveau de revenus et leur formation professionnelle. Plus rapide est le véhicule
emprunté, plus forte est la prime versée par ce mode de taxation dégressive. A
peine 0,2 % de la population américaine peut choisir de prendre l’avion plus
d’une fois par an, et peu d’autres pays peuvent ouvrir aussi largement l’accès
aux avions à réaction.
Le banlieusard captif du trajet quotidien et le
voyageur sans souci sont pareillement dépendants du transport. Tous deux ont
perdu leur liberté. L’espoir d’un occasionnel voyage-éclair à Acapulco ou à un
congrès du Parti fait croire au membre de la classe moyenne qu’il a « réussi »
et fait partie du cercle étroit, puissant et mobile des dirigeants. Le rêve
hasardeux de passer quelques heures attaché sur un siège propulsé à grande
vitesse rend même l’ouvrier complice consentant de la déformation imposée
à l’espace humain et le conduit à se résigner à l’aménagement du pays non pour
les hommes mais pour les voitures.
Physiquement et culturellement l’homme a lentement
évolué en harmonie avec sa niche cosmique. De ce qui est le milieu animal, il a
appris en une longue histoire à faire sa demeure. Son image de soi appelle le
complément d’un espace de vie et d’un temps de vie intégrés au rythme de son
propre mouvement. L’harmonie délibérée qui accorde cet espace, ce temps et ce
rythme est justement ce qui le détermine comme homme. Si, dans cette
correspondance, le rôle premier est donné à la vitesse d’un véhicule, au lieu
de l’être à la mobilité de l’individu, alors l’homme est rabaissé du rang
d’architecte du monde au statut de simple banlieusard.
L’Américain moyen consacre plus de mille six cents
heures par an à sa voiture. Il y est assis, qu’elle soit en marche ou à
l’arrêt; il la gare ou cherche à le faire; il travaille pour payer le premier
versement comptant ou les traites mensuelles, l’essence, les péages,
l’assurance, les impôts et les contraventions. De ses seize heures de veille
chaque jour, il en donne quatre à sa voiture, qu’il l’utilise ou qu’il gagne les
moyens de le faire. Ce chiffre ne comprend même pas le temps absorbé par des
activités secondaires imposées par la circulation : le temps passé à l’hôpital,
au tribunal ou au garage, le temps passé à étudier la publicité automobile ou à
recueillir des conseils pour acheter la prochaine fois une meilleure bagnole.
Presque partout on constate que le coût total des accidents de la route et celui
des universités sont du même ordre et qu’ils croissent avec le produit social.
Mais, plus révélatrice encore, est l’exigence de temps qui s’y ajoute. S’il
exerce une activité professionnelle, l’Américain moyen dépense mille six cents
heures chaque année pour parcourir dix mille kilomètres; cela représente à peine
6 kilomètres à l’heure. Dans un pays dépourvu d’industrie de la circulation, les
gens atteignent la même vitesse, mais ils vont où ils veulent à pied, en y
consacrant non plus 28 %, mais seulement 3 à 8 % du budget-temps social. Sur ce
point, la différence entre les pays riches et les pays pauvres ne tient pas à ce
que la majorité franchit plus de kilomètres en une heure de son existence, mais
à ce que plus d’heures sont dévolues à consommer de fortes doses d’énergie
conditionnées et inégalement réparties par l’industrie de la circulation .
Chapitre III : Le gel de l’imagination
Passé un certain seuil de consommation d’énergie,
l’industrie du transport dicte la configuration de l’espace social. La chaussée
s’élargit, elle s’enfonce comme un coin dans le coeur de la ville et sépare les
anciens voisins. La route fait reculer les champs hors de portée du paysan
mexicain qui voudrait s’y rendre à pied. Au Brésil, l’ambulance fait reculer le
cabinet du médecin au-delà de la courte distance sur laquelle on peut porter un
enfant malade. A New York, le médecin ne fait plus de visite à domicile, car la
voiture a fait de l’hôpital le seul lieu où il convienne d’être malade. Dès que
les poids lourds atteignent un village élevé des Andes, une partie du marché
local disparaît. Puis, lorsque l’école secondaire s’installe sur la place, en
même temps que s’ouvre la route goudronnée, de plus en plus de jeunes gens
partent à la ville, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus une seule famille qui n’espère
rejoindre l’un des siens, établi là-bas, sur la côte, à des centaines de
kilomètres.
Malgré la différence des apparences superficielles
qu’elles suscitent, des vitesses égales ont les mêmes effets déformants sur la
perception de l’espace, du temps et de la puissance personnelle dans les pays
pauvres que dans les pays riches. Partout l’industrie type d’homme adapté du
transport forge un nouveau aux horaires à la nouvelle géographie et aux nouveaux
horaires qui sont son œuvre.
L’industrie du transport façonne son produit :
l’usager. Chassé du monde où les personnes sont douées d’autonomie, il a
perdu aussi l’impression de se trouver au centre du monde. Il a conscience de
manquer de plus en plus te temps, bien qu’il utilise chaque jour la voiture, le
train, l’autobus, le métro et l’ascenseur, le tout pour franchir en moyenne 30
kilomètres, souvent dans un rayon de moins de 10 kilomètres. Le sol se dérobe
sous ses pieds, il est cloué à la roue. Qu’il prenne le métro ou l’avion, il a
toujours le sentiment d’avancer moins vite ou moins bien que les autres et il
est jaloux des raccourcis qu’empruntent les privilégiés pour échapper à
l’exaspération créée par la circulation. Enchaîné à l’horaire de son train de
banlieue, il rêve d’avoir une auto. Épuisé par les embouteillages aux heures de
pointe, il envie le riche qui se déplace à contresens. Il paie sa voiture de sa
poche, mais il sait trop bien que le PDG utilise les voitures de l’entreprise,
fait rembourser son essence comme frais généraux ou se fait louer une voiture
sans bourse délier. L’usager se trouve tout au bas de 1’échelle où sans cesse
augmentent l’inégalité, le manque de temps et sa propre impuissance, mais pour y
mettre fin il s’accroche à l’espoir fou d’obtenir plus de ia même chose :
une circulation améliorée par des transports plus rapides. Il réclame des
améliorations techniques des véhicules, des voies de circulation et des
horaires; ou bien il appelle de ses vœux une révolution qui organise des
transports publics rapides en nationalisant les moyens de transport. Jamais il
ne calcule le prix qu’il lui en coûtera pour être ainsi véhiculé dans un avenir
meilleur. Il oublie que de toute accélération supplémentaire, il payera lui-même
la facture, sous forme d’impôts directs ou de taxes multiples. Il ne mesure pas
le coût indirect du remplacement des voitures privées par des transports publics
aussi rapides. Il est incapable d’imaginer les avantages apportés par l’abandon
de l’automobile et le recours à la force musculaire de chacun.
L’usager ne voit pas l’absurdité d’une mobilité
fondée sur le transport. Sa perception traditionnelle de l’espace, du temps et
du rythme propre a été déformée par l’industrie. Il a perdu la liberté de
s’imaginer dans un autre rôle que celui d’usager du transport. Sa manie des
déplacements lui enlève le contrôle de la force physique, sociale et psychique
dont ses pieds sont dotés. L’usager se voit comme un corps emporté à toute
vitesse à travers l’espace inaccessible. Automobiliste, il suit des itinéraires
obligés sans rendre possession du sol, sans pouvoir y marquer son domaine.
Abandonné à lui-même, il est immobile, isolé, sans lieu.
Devenu un objet qu’on achemine, l’homme parle un
nouveau langage. Il va en voiture « retrouver » quelqu’un, il téléphone pour «
entrer en contact ».
Pour lui, la liberté de mouvement n’est que la
liberté d’être transporté. Il a perdu confiance dans le pouvoir politique qui
lui vient de la capacité de pouvoir marcher et parler. Il croit que l’activité
politique consiste à réclamer une plus large consommation de ces services qui
l’assimilent à une simple marchandise. Il ne demande pas plus de liberté pour
des citoyens autonomies, mais de meilleurs services pour des clients soumis. Il
ne se bat pas pour garantir sa liberté de se déplacer à son gré et de parler aux
autres à sa manière, mais pour asseoir son droit d’être véhiculé et informé. Il
désire de meilleurs produits et ne veut pas rompre l’enchaînement à ces
produits. Il est urgent qu’il comprenne que l’accélération appelée de ses vœux
augmentera son emprisonnement et, qu’une fois réalisées, ses revendications
marqueront le terme de sa liberté, de ses loisirs et de son indépendance.
Chapitre IV : Le prix du temps
La vitesse incontrôlée est coûteuse et de moins en
moins de gens peuvent se l’offrir. Tout surcroît de vitesse d’un véhicule
augmente son coût de propulsion, le prix des voies de circulation nécessaires
et, ce qui est plus grave, la largeur de l’espace que son mouvement dévore. Dès
qu’un certain seuil de consommation d’énergie est dépassé par les voyageurs les
plus rapides, il se crée à l’échelle du monde entier une structure de classe de
capitalistes de la vitesse. La valeur d’échange du temps reprend la première
place, comme le montre le langage : on parle du temps dépensé, économisé,
investi, gaspillé, mis à profit. A chacun la société colle une étiquette de prix
qui indique sa valeur horaire : plus on va vite, plus l’écart des
prix se creuse. Entre l’égalité des chances et la vitesse, il y a corrélation
inverse.
Une vitesse élevée capitalise le temps de
quelques-uns à d’énormes taux, mais paradoxalement cela coûte un énorme prix à
ceux dont le temps est jugé beaucoup moins précieux. A Bombay il n’y a pas
beaucoup de possesseurs de voitures : à ces derniers, il suffit d’une matinée
pour se rendre à Poona. L’économie moderne les oblige à faire ce trajet une fois
par semaine. Deux générations plus tôt, le voyage aurait pris une semaine, on
l’aurait fait une fois par an. Mais ces rares automobiles qui stimulent en
apparence les échanges économiques, en fait dérangent la circulation normale des
bicyclettes et des pousse-pousse qui traversent par milliers le centre de
Bombay. Ici l’automobile paralyse toute une société. La perte de temps imposée à
tous et la mutilation d’une société augmentent plus vite que le gain de temps
dont quelques-uns bénéficient pour leurs excursions. Partout la circulation
augmente indéfiniment à mesure qu’on dispose de puissants moyens de transport.
Plus on a la possibilité d’être transporté, plus on manque de temps. Passé un
seuil critique, l’industrie du transport fait perdre plus de temps qu’elle n’en
fait gagner. L’utilité marginale d’un accroissement de la vitesse de
quelques-uns est acquise au prix de la désutilité marginale croissante de cette
accélération pour la majorité.
Au-delà d’une vitesse critique, personne ne « gagne
» du temps sans en faire « perdre » à quelqu’un d’autre. Celui qui réclame une
place dans un véhicule plus rapide affirme ainsi que son temps vaut plus cher
que celui du passager d’un véhicule plus lent. Au-delà d’une certaine vitesse,
chaque passager se transforme en voleur qui dérobe le temps d’autrui et
dépouille la masse de la société. L’accélération de sa voiture lui assure le
transfert net d’une part de temps vital. L’importance de ce transfert se mesure
en quanta de vitesse. Il défavorise ceux qui restent en arrière et parce
que ces derniers composent la majorité, l’affaire pose des problèmes éthiques
plus généraux que la dialyse rénale ou les transplantations d’organes.
Au-delà d’une vitesse critique, les véhicules à
moteur engendrent des distances aliénantes qu’eux seuls peuvent surmonter.
L’absence devient alors la règle, et la présence, l’exception. Une nouvelle
piste à travers le sertão brésilien inscrit la grande ville à l’horizon
du paysan qui a à peine de quoi survivre, mais elle ne la met pas à sa portée.
La nouvelle voie express qui traverse Chicago étend la ville, mais elle aspire
vers la périphérie tous ceux qui ont les moyens d’éviter un centre dégradé en
ghetto. Une accélération croissante aggrave l’exploitation des plus faibles,
dans l’Illinois comme en Iran.
Du temps de Cyrus à celui de la machine à vapeur,
la vitesse de l’homme est restée la même. Quel que fût le porteur du message,
les nouvelles ne franchissaient pas plus de 150 kilomètres par jour. Ni le
coureur inca, ni la galère vénitienne, ni le cavalier persan, ni la diligence de
Louis XIV n’ont pu rompre cette barrière. Guerriers, explorateurs, marchands ou
pèlerins couvraient 30 kilomètres par jour. Comme le dit Valéry : « Napoléon va
à la même lenteur que César. » L’Empereur savait qu’« on mesure la prospérité
publique aux comptes des diligences », mais il ne pouvait guère presser le
mouvement. De Paris à Toulouse, on mettait deux cents heures à 1’époque romaine,
et encore cent cinquante-huit heures avec la diligence en 1782. Le XIXe
siècle a, le premier, accéléré le mouvement des hommes. En 1830, le même trajet
ne demandait plus que cent dix heures, mais à condition d’y mettre le prix :
cette année-là, 1 150 équipages versèrent et provoquèrent plus d’un millier de
décès. Puis le chemin de fer suscita un brusque changement. En 1855 Napoléon III
pouvait se vanter d’avoir franchi d’un trait la distance Paris-Marseille à la
moyenne de 96 kilomètres à l’heure. Entre 1850 et 1900, la distance moyenne
parcourue en un an par chaque Français a été multipliée par cent. C’est en 1893
que le réseau ferroviaire anglais atteignit son extension maximum. Alors les
trains de voyageurs se trouvèrent à leur coût optimum calculé en temps
nécessaire pour les entretenir et les conduire à destination.
Au degré suivant d’accélération, le transport
commença à dominer la circulation, et la vitesse, à classer les destinations
selon une hiérarchie. Puis le nombre de chevaux-vapeur utilisés détermina la
classe de tout dirigeant en voyage, selon une pompe dont même les rois n’avaient
pas osé rêver. Chacune de ces étapes a rabaissé d’autant le rang de ceux qui
sont limités à un moindre kilométrage annuel. Quant à ceux qui nilont que leur
propre force pour se déplacer, ils sont considérés comme des outsiders
sous-développés. Dis-moi à quelle vitesse tu te déplaces, je te dirai qui tu es.
Celui qui peut profiter de l’argent des contribuables dont se nourrit Concorde,
appartient sans aucun doute au gratin.
En l’espace des deux dernières générations, la
voiture est devenue le symbole d’une carrière réussie, tout comme l’école est
devenue celui d’un avantage social de départ. Une telle concentration de
puissance doit produire sa propre justification. Dans les États capitalistes, on
dépense les deniers publics pour permettre à un homme de parcourir chaque année
plus de kilomètres en moins de temps, pour la seule raison qu’on a déjà investi
encore plus d’argent pour allonger la durée de sa scolarité. Sa valeur présumée
comme moyen intensif de production du capital détermine les conditions de son
transport. Mais la haute valeur sociale des capitalistes du savoir n’est pas le
seul motif pour estimer leur temps de manière privilégiée. D’autres étiquettes
idéologiques sont aussi utiles pour ouvrir l’accès au luxe dont d’autres gens
paient le prix. Si maintenant il faut répandre les idées de Mao en Chine avec
des avions à réaction, cela signifie seulement que, dès à présent, deux classes
sont nécessaires pour conserver les acquis de la Longue Marche, l’une qui vive
au milieu des masses et l’autre, au milieu des cadres. Sans doute, dans la Chine
populaire, la suppression des niveaux intermédiaires a-t-elle permis une
concentration efficace et rationnelle du pouvoir, néanmoins elle marque aussi
une nouvelle différence entre le temps du conducteur de bœufs et celui du
fonctionnaire qui voyage en avion à réaction. L’accélération concentre
inévitablement les chevaux-vapeur sous le siège de quelques personnes et ajoute
au croissant manque de temps du banlieusard le sentiment qu’il reste à la
traîne.
Ordinairement on soutient par un double argument la
nécessité de maintenir dans une société industrielle des privilèges
disproportionnés. On tient ce privilège pour un préliminaire nécessaire pour que
la prospérité de la population tout entière puisse augmenter, ou bien on y voit
l’instrument de rehaussement du standing d’une minorité défavorisée. L’exemple
de l’accélération révèle clairement l’hypocrisie de ce raisonnement. A long
terme, l’accélération du transport n’apporte aucun de ces bénéfices. Elle
n’engendre qu’une demande universelle de transport motorisé et qu’une séparation
des groupes sociaux par niveau de privilèges en creusant des écarts
inimaginables jusque-là. Passé un certain point, plus d’énergie signifie moins
d’équité. Au rythme du plus rapide moyen de transport, on voit gonfler le
traitement de faveur réservé à quelques-uns aux frais des autres.
Chapitre V : La vitesse mangeuse de temps
Il ne faudrait pas négliger le fait que la vitesse
de pointe de quelques-uns se paie d’un autre prix qu’une vitesse élevée
accessible à tous. La classification sociale par degrés de vitesse impose un
transfert net de puissance : les pauvres travaillent et payent pour rester à la
traîne. Si les classes moyennes d’une société fondée sur la vitesse peuvent
s’efforcer d’oublier cette discrimination, elles ne sauraient supporter une
croissance indéfinie des coûts. Certaines dépenses sautent aux yeux
actuellement, par exemple la destruction de l’environnement ou l’exploitation,
avec l’aide des militaires, de matières premières disponibles en quantités
limitées. Peut-être voilent-elles un prix de l’accélération encore plus lourd.
Que chacun puisse se déplacer à grande vitesse, cela signifie qu’il lui restera
une part de temps moindre et que toute la société dépensera une plus grande part
du temps disponible à transporter les gens. Des voitures qui dépassent la
vitesse critique ont tendance à imposer l’inégalité, mais elles installent aussi
une industrie auto-suffisante qui cache l’inefficacité du système de transport
sous une apparence de raffinement technologique. J’estime que limiter la vitesse
ne sert pas seulement à défendre l’équité, mais à préserver l’efficacité des
moyens de transport, c’est-à-dire à augmenter la distance totale parcourue en
diminuant le temps total consacré à cet effet.
On n’a guère étudié les conséquences de la voiture
sur le budget-temps (par 24 heures) des individus comme des sociétés. Les
travaux déjà faits pour le transport fournissent des statistiques sur le temps
nécessaire par kilomètre, sur la valeur de ce temps calculée en dollars ou sur
la durée des trajets. Mais rien n’est dit des frais de transport cachés :
comment le transport dévore le temps vital, comment la voiture multiplie le
nombre des voyages nécessaires, combien de temps on passe à se préparer à un
déplacement. De plus, on n’a pas de critère pour estimer la valeur de frais
encore plus cachés : le surloyer accepté pour résider dans un quartier bien
relié au réseau des transports, les dépenses engagées pour préserver un secteur
du bruit, de la saleté et des dangers physiques dus aux voitures. Ce n’est pas
parce qu’on ne calcule pas les dépenses en budget-temps social qu’il faut croire
ce calcul impossible, encore moins faut-il négliger d’utiliser le peu
d’informations recueillies. Elles montrent que partout, dès qu’une voiture
dépasse la vitesse de 25 kilomètres à l’heure, elle provoque un manque de temps
croissant. Ce seuil franchi par l’industrie, le transport fait de l’homme un
errant d’un nouveau genre : un éternel absent toujours éloigné de son lieu de
destination, incapable de l’atteindre par ses propres moyens, et pourtant obligé
de s’y rendre chaque jour. Aujourd’hui les gens travaillent une bonne partie de
la journée seulement pour gagner l’argent nécessaire pour aller travailler.
Depuis deux générations, dans les pays industrialisés, la durée du trajet entre
le logement et le lieu de travail a augmenté plus vite que n’a diminué, dans la
même période, la durée de la journée de travail. Le temps qu’une société dépense
en transport augmente proportionnellement à la vitesse du moyen de transport
public le plus rapide. À présent, le Japon précède les États-Unis dans ces deux
domaines. Quand la voiture brise la barrière qui protège l’homme de l’aliénation
et l’espace de la destruction, le temps vital est dévoré par les activités nées
du transport.
Que cette voiture qui file à toute allure sur la
route soit le bien de l’État ou d’un particulier, cela ne change rien au manque
de temps et à la surprogrammation accrus par chaque accélération. Pour
transporter un passager sur une distance donnée, un autobus a besoin de trois
fois moins d’essence qu’une voiture de tourisme. Un train de banlieue est dix
fois plus efficace qu’une telle voiture. Autobus et trains pourraient devenir
encore plus efficaces et moins nuisibles à l’environnement. Transformés en
propriété publique et gérés rationnellement, les deux pourraient être exploités
et organisés de façon à considérablement rogner les privilèges que le régime de
propriété privée et une organisation incompétente suscitent. Mais, tant que
n’importe quel système de véhicules s’impose à nous avec une vitesse de pointe
illimitée, nous sommes obligés de dépenser plus de temps pour payer le
transport, porte à porte, de plus de gens, ou de verser plus d’impôts pour qu’un
petit groupe voyage beaucoup plus loin et plus vite que tous les autres. La part
du budget-temps social consacrée au transport est déterminée par l’ordre de
grandeur de la vitesse de pointe permise par ledit système de transport.
Chapitre VI : Le monopole radical de l’industrie
Quand on évoque le plafond de vitesse à ne pas
dépasser, il faut revenir à la distinction déjà faite entre le transit autogène
et le transport motorisé et définir leur quote-part respective dans la totalité
des déplacements des personnes qui constituent la circulation.
Le transport est un mode de circulation fondé sur
l’utilisation intensive du capital, et le transit, sur un recours intensif au
travail du corps. Le transport est un produit de l’industrie dont les usagers
sont les clients. C’est une marchandise affectée de rareté. Toute amélioration
du transport se réalise sous condition de rareté accrue, tandis que la vitesse,
et donc le coût, augmentent. Les conflits suscités par l’insuffisance du
transport prennent la forme d’un jeu où l’un gagne ce que l’autre perd. Au
mieux, un tel conflit admet une solution à la manière du dilemme des deux
prisonniers décrit par A. Rapoport : si tous deux coopèrent avec leur gardien,
leur peine de prison sera écourtée.
Le transit n’est pas un produit industriel, c’est
l’opération autonome de ceux qui se déplacent. Il a par définition une utilité,
mais pas de valeur d’échange, car la mobilité personnelle est sans valeur
marchande. La capacité de participer au transit est innée chez l’homme et plus
ou moins également partagée entre des individus valides ayant le même âge.
L’exercice de cette capacité peut être limité quand on refuse à une catégorie
déterminée de gens le droit d’emprunter un chemin déterminé, ou encore quand une
population manque de chaussures ou de chemins. Les conflits sur les conditions
de transit prennent la forme d’un jeu où tous les partenaires peuvent en même
temps obtenir un gain en mobilité et en espace de mouvement.
La circulation totale résulte donc de deux modes de
production, l’un appuyé sur l’utilisation intensive du capital, l’autre sur le
recours intensif au travail du corps. Les deux peuvent se compléter
harmonieusement aussi longtemps que les outputs autonomes sont protégés de
l’invasion du produit industriel.
Les maux de la circulation sont dus, à présent, au
monopole du transport. L’attrait de la vitesse a séduit des milliers d’usagers
qui croient au progrès et acceptent les promesses d’une industrie fondée sur
l’utilisation intensive du capital. L’usager est persuadé que les
véhicules
surpuissants lui permettent de dépasser l’autonomie limitée dont il a joui tant
qu’il s’est déplacé par ses seuls moyens ; aussi consent-il à la domination du
transport organisé aux dépens du transit autonome. La destruction de
l’environnement est encore la moindre des conséquences néfastes de ce choix.
D’autres, plus graves, touchent la multiplication des frustrations physiques, la
désutilité croissante de la production continuée, la soumission à une inégale
répartition du pouvoir — autant de manifestations d’une distorsion de la
relation entre le temps de vie et l’espace de vie. Dans un monde aliéné par le
transport, l’usager devient un consommateur hagard, harassé de distances qui ne
cessent de s’allonger.
Toute société qui impose sa règle aux modes de
déplacement opprime en fait le transit au profit du transport. Partout où non
seulement l’exercice de privilèges, mais la satisfaction des plus élémentaires
besoins sont liés à l’usage de véhicules surpuissants, une accélération
involontaire des rythmes personnels se produit. Dès que la vie quotidienne
dépend du transport motorisé, l’industrie contrôle la circulation. Cette
mainmise de l’industrie du transport sur la mobilité naturelle fonde un monopole
bien plus dominateur que le monopole commercial de Ford sur le marché de
l’automobile ou que celui, politique, de l’industrie automobile à l’encontre des
moyens de transport collectifs. Un véhicule surpuissant fait plus : il engendre
lui-même la distance qui aliène. A cause de son caractère caché, de son
retranchement, de son pouvoir de structurer la société, je juge ce monopole
radical. Quand une industrie s’arroge le droit de satisfaire, seule, un
besoin élémentaire, jusque-là l’objet d’une réponse individuelle, elle produit
un tel monopole. La consommation obligatoire d’un bien qui consomme beaucoup
d’énergie (le transport motorisé) restreint les conditions de jouissance d’une
valeur d’usage surabondante (la capacité innée de transit). La circulation nous
offre l’exemple d’une loi économique générale : tout produit industriel dont
la consommation par personne dépasse un niveau donné exerce un monopole
radical sur la satisfaction d’un besoin. Passé un certain seuil, l’école
obligatoire ferme l’accès au savoir, le système de soins médicaux détruit les
sources non thérapeutiques de la santé, le transport paralyse la circulation.
D’abord le monopole radical est institué par
l’adaptation de la société aux fins de ceux qui consomment les plus forts
quanta; puis il est renforcé par l’obligation, faite à tous, de consommer le
quantum minimum sous lequel se présente le produit. La consommation
forcée prend des formes différentes, selon, qu’il s’agit d’objets matériels où
se concrétise de l’énergie (vêtements, logement, etc.), d’actes où se communique
de l’information (éducation, médecine, etc.). D’un domaine à l’autre, le
conditionnement industriel des quanta atteindra son niveau critique pour
des valeurs différentes, mais pour chaque grande classe de produits on peut
fixer l’ordre de grandeur ou se place le seuil critique. Plus la limite de
vitesse d’une société est haute, plus le monopole du transport y devient
accablant. Qu’il soit possible de déterminer l’ordre de grandeur des vitesses
auxquelles le transport commence à imposer son monopole radical à la
circulation, cela ne suffit pas à prouver qu’il soit aussi possible de
simplement déterminer en théorie quelle limite supérieure de vitesse une société
devrait retenir.
Nulle théorie, mais la seule politique peut
déterminer jusqu’à quel degré un monopole est tolérable dans une société donnée.
Qu’il soit possible de déterminer un degré d’instruction obligatoire à partir
duquel recule l’apprentissage par l’observation et par l’action, cela ne permet
pas au théoricien de fixer le niveau d’industrialisation de la pédagogie qu’une
culture peut supporter. Seul le recours à des procédures juridiques et, surtout,
politiques peut conduire à des mesures spécifiques, malgré leur caractère
provisoire, grâce auxquelles on pourra réellement imposer une limite à la
vitesse ou à la scolarisation obligatoire dans une société. L’analyse sociale
peut fournir un schéma théorique afin de borner la domination du monopole
radical, mais seules des procédures politiques peuvent déterminer le niveau de
limitation à retenir volontairement. Une industrie n’exerce pas sur toute une
société un monopole radical grâce à la rareté des biens produits ou grâce à son
habileté à évincer les entreprises concurrentes, mais par son aptitude à créer
le besoin qu’elle est seule à pouvoir satisfaire.
Dans toute l’Amérique latine, les chaussures sont
rares et bien des gens n’en portent jamais. Ils marchent pieds nus ou mettent
d’excellentes sandales fabriquées par les artisans les plus divers. Jamais le
manque de chaussures n’a limité leur transit. Mais dans de nombreux pays
sud-américains, les gens sont forcés de se chausser, dès lors que le libre accès
à l’école, au travail et aux services publics est interdit aux va-nu-pieds. Les
professeurs et les fonctionnaires du Parti interprètent l’absence de chaussures
comme la marque d’une indifférence à l’égard du « progrès ». Sans que les
promoteurs du développement national conspirent avec les industriels de la
chaussure, un accord accord implicite bannit dans ces pays tout va-nu-pieds hors
des services importants.
Comme les chausseurs, les écoles ont toujours été
un bien rare. Mais jamais une minorité privilégiée d’élèves n’a pu à elle seule
faire de l’école un empêchement à l’acquisition du savoir. Il a fallu rendre
l’école obligatoire pour une période limitée (et lui adjoindre la liberté,
illimitée, de lever des impôts) pour que l’éducateur ait le pouvoir d’interdire
aux sous-consommateurs de thérapie éducative d’apprendre un métier sur le tas.
Une fois établie la scolarisation obligatoire, on a pu imposer à la société
toute une organisation sans cesse plus complexe à laquelle ne peuvent s’adapter
les non-scolarisés et non-programmés.
Dans le cas de la circulation, l’éventuelle
puissance d’un monopole radical est très concevable. Imaginons de pousser à son
terme l’hypothèse d’une parfaite distribution des produits de l’industrie du
transport. Ce serait l’utopie d’un système de transport motorisé, libre et
gratuit. La circulation serait exclusivement réservée à un système de transport
public, financé par un impôt progressif sur le revenu où il serait tenu compte
de la distance du domicile à la plus proche station du réseau et au lieu de
travail, conçu pour que le premier venu soit le premier servi, et sans aucun
droit de priorité au médecin, au touriste ou au PDG. Dans ce paradis des fous,
tous les voyageurs seraient égaux, et tous également prisonniers seraient du
transport. Privé de l’usage de ses pieds, le citoyen de cette utopie motorisée
serait l’esclave du réseau de transport et l’agent de sa prolifération.
Certains apprentis sorciers, déguisés en
architectes, proposent une issue illusoire au paradoxe de la vitesse. A leur
sens, l’accélération impose des inégalités, une perte de temps et des horaires
rigides pour la seule raison que les gens ne vivent pas selon des rnodèles et
dans des formes bien adaptés aux véhicules. Ces architectes futuristes
voudraient que les gens vivent et travaillent dans des chapelets de tours
autarciques, reliées entre elles par des cabines très rapides. Soleri, Doxiadis
ou Fuller résoudraient le problème créé par le transport à grande vitesse en
englobant tout l’habitat humain dans ce problème. Au lieu de se demander comment
conserver aux hommes la surface de la terre, ils cherchent à créer des réserves
sur une terre abandonnée aux ravages des produits industriels.
Chapitre VII : Le seuil insaisissable
Une vitesse de transport optimale paraît arbitraire
ou autoritaire à l’usager, tandis qu’au muletier elle semble aussi rapide que le
vol de l’aigle. Quatre ou six fois la vitesse d’un homme à pied, c’est un seuil
trop bas pour être pris en considération par l’usager, trop élevé pour
représenter une limite possible pour les deux tiers de l’humanité qui se
déplacent encore par leurs propres moyens.
Ceux qui planifient le logement, le transport ou
l’éducation des autres appartiennent tous à la classe des usagers. Leur
revendication de pouvoir découle de la valeur que leurs employeurs, publics ou
privés, attribuent à l’accélération. Sociologues et ingénieurs savent composer
sur ordinateurs un modèle de la circulation à Calcutta ou à Santiago et
implanter des voies pour aérotrains d’après leur conception abstraite d’un bon
réseau de transport. Leur foi dans l’efficacité de la puissance les aveugle sur
l’efficacité supérieure du renoncement à son utilisation. En augmentant la
charge énergétique, ils ne font qu’amplifier des problèmes qu’ils sont
incapables de résoudre. Il ne leur vient pas à l’esprit de renoncer à la vitesse
et de choisir un ralentissement général et une diminution de la circulation pour
dénouer l’imbroglio du transport. Ils ne songent pas à améliorer leurs
programmes en interdisant de dépasser en ville la vitesse du vélo. Un préjugé
mécaniste les empêche d’optimiser les deux composantes de la circulation dans le
même modèle de simulation. L’expert en développement qui, dans sa Land-Rover,
s’apitoie sur le paysan qui conduit ses cochons au marché, refuse ainsi de
reconnaître les avantages relatifs de la marche. Il a tendance à oublier
qu’ainsi, ce paysan dispense dix hommes de son village d’aller au marché et de
perdre leur temps sur les chemins, alors que l’expert et tous les membres de sa
famille doivent, chacun pour son compte, toujours courir les routes. Pour un tel
homme, porté à concevoir la mobilité humaine en termes de progrès indéfini, il
ne saurait y avoir de taux de circulation optimal, mais seulement une unanimité
passagère à un stade donné de développement technique. L’enragé du développement
et son homologue africain, atteint par contagion, ignorent l’efficacité optimale
d’une technique « pauvre ». Sans doute pour eux la limitation de la consommation
d’énergie sert à protéger l’environnement, une technique « simple » apaisera
provisoirement les pauvres, et une vitesse limitée permettra à plus de voitures
de rouler sur moins de routes. Mais l’autolimitation pour protéger un moyen de
la perte de sa propre fin, cela reste extérieur à leurs considérations.
La plupart des Mexicains, sans parler des Indiens
et des Africains, sont dans une tout autre situation. Le seuil critique de
vitesse se situe bien au-delà de ce qu’ils connaissent ou attendent, à quelques
exceptions près. Ils appartiennent encore à la catégorie des hommes qui se
déplacent par eux-mêmes. Plusieurs d’entre eux gardent le souvenir d’une
aventure motorisée, mais la plupart n’ont jamais franchi le seuil critique de
vitesse. Dans deux États mexicains caractéristiques, le Guerrero et le Chiapas,
en 1970, moins de 1 % de la population avait parcouru au moins une fois plus de
15 kilomètres en une heure. Les véhicules où ces gens s’entassent parfois
rendent le voyage plus facile, mais guère plus rapide qu’à bicyclette. L’autocar
de troisième classe ne sépare pas le fermier de ses cochons et il les transporte
tous ensemble au marché, sans leur faire perdre de poids. Ce premier contact
avec le « confort » motorisé ne rend pas esclave de la vitesse destructrice.
L’ordre de grandeur où situer la limite critique de
vitesse est trop bas pour être pris au sérieux par l’usager et trop élevé pour
concerner le paysan. Ce chiffre est si évident qu’il en devient invisible.
Toutes les études sur la circulation s’occupent seulement de servir l’avenir de
l’industrie du transport. Aussi l’idée d’adopter cet ordre de grandeur pour
limiter la vitesse rencontre-t-elle une résistance obstinée. L’instaurer, ce
serait priver de sa drogue l’homme industrialisé, intoxiqué par de fortes doses
d’énergie, et interdire aux gens sobres de goûter un jour cette ivresse
inconnue.
Vouloir susciter sur ce point une contre-recherche
ne constitue pas seulement un scandale, mais aussi une menace. La frugalité
menace l’expert, censé savoir pourquoi le banlieusard doit prendre son train à
8hl5 et à 8h4l et pourquoi il convient d’employer tel ou tel mélange de
carburants. Que par un processus politique on puisse déterminer un ordre de
grandeur naturel, impossible à éluder et ayant valeur de limite, cette idée
reste étrangère à l’échelle de valeurs et au monde de vérités de l’usager. Chez
lui, le respect des spécialistes qu’il ne connaît même pas se transforme en
aveugle soumission. Si l’on pouvait trouver une solution politique aux problèmes
créés par les experts de la circulation, alors on pourrait appliquer le même
traitement aux problèmes d’éducation, de santé ou d’urbanisme. Si des profanes,
participant activement à une procédure politique, pouvaient déterminer l’ordre
de grandeur d’une vitesse optimale de circulation, alors les fondations sur
lesquelles repose la charpente des sociétés industrielles seraient ébranlées. La
recherche que je propose est subversive. Elle remet en question l’accord général
sur la nécessité de développer le transport et la fausse opposition politique
entre tenants du transport public et partisans du transport privé.
Chapitre VIII : Les degrés de la mobilité
Le roulement à billes a été inventé il y a un
siècle. Grâce à lui le coefficient de frottement est devenu mille fois plus
faible. En ajustant convenablement un roulement à billes entre deux meules
néolithiques, un Indien peut moudre à présent autant de grain en une journée que
ses ancêtres en une semaine. Le roulement à billes a aussi rendu possible
l’invention de la bicyclette, c’est-à-dire l’utilisation de la roue, — la
dernière, sans doute, des grandes inventions néolithiques —, au service de la
mobilité obtenue par la force musculaire humaine. Le roulement à billes est ici
le symbole d’une rupture définitive avec la tradition et des directions opposées
que peut prendre le développement. L’homme peut se déplacer sans l’aide d’aucun
outil. Pour transporter chaque gramme de son corps sur un kilomètre en dix
minutes, il dépense 0,75 calorie. Il forme une machine thermodynamique plus
rentable que n’importe quel véhicule à moteur et plus efficace que la plupart
des animaux. Proportionnellement à son poids, quand il se déplace, il produit
plus de travail que le rat ou le bœuf, et moins que le cheval ou l’esturgeon.
Avec ce rendement, il a peuplé la terre et fait son histoire. A ce même niveau,
les sociétés agraires consacrent moins de 5 % et les nomades moins de 8 % de
leur budget-temps à circuler hors des habitations ou des campements.
A bicyclette, l’homme va de trois à quatre fois
plus vite qu’à pied, tout en dépensant cinq fois moins d’énergie. En terrain
plat, il lui suffit alors de dépenser 0,15 calorie pour transporter un gramme de
son corps sur un kilomètre. La bicyclette est un outil parfait qui permet à
l’homme d’utiliser au mieux son énergie métabolique pour se mouvoir : ainsi
outillé, l’homme dépasse le rendement de toutes les machines et celui de tous
les animaux.
Si l’on ajoute à l’invention du roulement à billes
celles de la roue à rayons et du pneu, cette conjonction a pour 1’histoire du
transport plus d’importance que tous les autres événements, à l’exception de
trois d’entre eux. D’abord, à 1’aube de la civilisation, l’invention de la roue
transféra les fardeaux des épaules des hommes à la brouette. Puis au Moyen Age,
en Europe, les inventions du bridon, du collier d’épaules et du fer à cheval
multiplièrent par cinq le rendement thermodynamique du cheval et transformèrent
l’économie en permettant de fréquents labourages et la rotation des assolements.
De plus, elles mirent à la portée des paysans des champs éloignés : ainsi on vit
la population rurale passer de hameaux de six familles à des villages de cent
feux, groupés autour de l’église, du marché, de la prison et, plus tard, de
l’école. Cela rendit possible la mise en culture de terres situées plus au nord
et déplaça le centre du pouvoir vers des régions plus froides. Enfin, la
construction par les Portugais au XVe siècle des premiers vaisseaux
de haute mer posa, sous 1’égide du capitalisme européen naissant, les fondements
d’une économie de marché mondiale et de l’impérialisme moderne.
L’invention du roulement à billes marqua une
quatrième révolution. Elle permit de choisir entre plus de liberté et d’équité
d’une part et une vitesse et une exploitation accrues d’autre part. Le roulement
à billes est un élément fondamental dans deux formes de déplacement,
respectivement symbolisées par le vélo et par l’automobile. Le vélo élève la
mobilité autogène de l’homme jusqu’à un nouveau degré, au-delà duquel il n’y a
plus en théorie de progrès possible. A l’opposé, la cabine individuelle
accélérée a rendu les sociétés capables de s’engager dans un rituel de la
vitesse qui progressivement les paralyse.
Que s’établisse un monopole d’emploi rituel d’un
outil potentiellement utile n’est pas un phénomène nouveau. Il y a des
millénaires, la roue déchargea le porteur esclave de son fardeau, mais seulement
dans les pays d’Eurasie. Au Mexique, bien que très connue, la roue ne fut jamais
utilisée pour le transport, mais exclusivement pour fabriquer de petites
voitures destinées à des dieux en miniature. Que la charrette ait été un objet
tabou dans l’Amérique d’avant Cortès ne doit pas nous étonner davantage que le
fait que le vélo soit tabou dans la circulation moderne.
Il n’est absolument pas nécessaire que l’invention
du roulement à billes serve, à l’avenir, à augmenter encore la consommation
d’énergie et engendre ainsi le manque de temps, le gaspillage de l’espace et des
privilèges de classe. Si le nouveau degré de mobilité autogène offert par le
vélo était protégé de la dévaluation, de la paralysie et des risques corporels
pour le cycliste, alors il serait possible de garantir à tout le monde une
mobilité optimale et d’en finir avec un système qui privilégie les uns et
exploite les autres au maximum. On pourrait contrôler les formes d’urbanisation,
si la structuration de l’espace était liée à l’aptitude des hommes à s’y
déplacer. Limiter absolument la vitesse, c’est retenir la forme la plus décisive
d’aménagement et d’organisation de l’espace. Selon qu’on l’utilise dans une
technique vaine ou profitable, le roulement à billes change de valeur.
Un vélo n’est pas seulement un outil
thermodynamique efficace, il ne coûte pas cher. Malgré son très bas salaire, un
Chinois consacre moins d’heures de travail à l’achat d’une bicyclette qui durera
longtemps qu’un Américain à l’achat d’une voiture bientôt hors d’usage. Les
aménagements publics nécessaires pour les bicyclettes sont comparativement moins
chers que la réalisation d’une infrastructure adaptée à des véhicules rapides.
Pour les vélos, il ne faut de routes goudronnées que dans les zones de
circulation dense, et les gens qui vivent loin d’une telle route ne sont pas
isolés, comme ils le seraient s’ils dépendaient de trains ou de voitures. La
bicyclette élargit le rayon d’action personnel sans interdire de passer où l’on
ne peut rouler : il suffit alors de pousser son vélo.
Le vélo nécessite une moindre place. Là où se gare
une seule voiture, on peut ranger dix-huit vélos, et l’espace qu’il faut pour
faire passer une voiture livre a passage à trente vélos. Pour faire franchir un
pont à 40 000 personnes en une heure, il faut deux voies d’une certaine largeur
si l’on utilise des trains, quatre si l’on utilise des autobus, douze pour des
voitures, et une seule si tous traversent à bicyclette. Le vélo est le seul
véhicule qui conduise l’homme de porte à porte, à n’importe quelle heure, et par
l’itinéraire de son choix. Le cycliste peut atteindre de nouveaux endroits sans
que son vélo désorganise un espace qui pourrait mieux servir à la vie.
La bicyclette permet de se déplacer plus vite, sans
pour autant consommer des quantités élevées d’un espace, d’un temps ou d’une
énergie devenus également rares. Chaque kilomètre de trajet est parcouru plus
rapidement, et la distance totale franchie annuellement est aussi plus élevée.
Avec un vélo, l’homme peut partager les bienfaits d’une conquête technique, sans
prétendre régenter les horaires, l’espace, ou l’énergie d’autrui. Un cycliste
est maître de sa propre mobilité sans empiéter sur celle des autres. Ce nouvel
outil ne crée que des besoins qu’il peut satisfaire, au lieu que chaque
accroissement de l’accélération produit par des véhicules à moteur crée de
nouvelles exigences de temps et d’espace.
Le roulement à billes et les pneus permettent à
l’homme d’instaurer un nouveau rapport entre son temps de vie et son espace de
vie, entre son propre territoire et le rythme de son être, sans usurper
l’espace-temps et le rythme biologique d’autrui. Ces avantages d’un mode
de déplacement moderne, fondé sur la force individuelle, sont évidents, pourtant
en général on les ignore. On ne se sert du roulement à billes que pour produire
des machines plus puissantes ; on avance toujours l’idée qu’un moyen de
transport est d’autant meilleur qu’il roule plus vite, mais on se dispense de la
prouver. La raison en est que si l’on cherchait à démontrer la chose, on
découvrirait qu’il n’en est rien aujourd’hui. La proposition contraire est, en
vérité, facile à établir : à présent, on accepte son contenu avec réticence,
demain elle deviendra évidente.
Un combat acharné entre vélos et moteurs vient à
peine de s’achever. Au Vietnam, une armée sur-industrialisée n’a pu défaire un
petit peuple qui se déplaçait à la vitesse de ses bicyclettes. La leçon est
claire. Des armées dotées d’un gros potentiel d’énergie peuvent supprimer des
hommes — à la fois ceux qu’elles défendent et ceux qu’elles combattent —, mais
elles ne peuvent pas grand-chose contre un peuple qui se défend lui-même. Il
reste à savoir si les Vietnamiens utiliseront dans une économie de paix ce que
leur a appris la guerre et s’ils sont prêts à garder les valeurs mêmes qui leur
ont permis de vaincre. Il est à craindre qu’au nom du développement industriel
et de la consommation croissante d’énergie, les Vietnamiens ne s’infligent à
eux-mêmes une défaite en brisant de leurs mains ce système équitable, rationnel
et autonome, imposé par les bombardiers américains à mesure qu’ils les privaient
d’essence, de moteurs et de routes.
Chapitre IX : Moteurs dominants et moteurs auxiliaires
Les hommes naissent dotés d’une mobilité presque
égale. Cette capacité innée plaide en faveur d’une égale liberté d’aller où bon
leur semble. Les citoyens d’une société fondée sur des principes de liberté,
d’égalité et de fraternité défendront de toute diminution ce droit fondamental.
Peu importe la nature de la menace, que ce soit la prison, l’assignement à
résidence, le retrait du passeport ou l’enfermement dans un milieu qui nuit à la
mobilité naturelle à seule fin de transformer la personne en usager du
transport. Ce droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à la joie de se
déplacer ne tombe pas en désuétude du simple fait que la plupart de nos
contemporains sont attachés à leur siège par leur ceinture de sécurité
idéologique. La capacité naturelle de transit est le seul critère utile pour
évaluer la contribution réelle du transport à la circulation globale. Il n’y a
pas plus de transport que la circulation ne peut en supporter. Il reste à
souligner comment se distinguent les formes de transport qui mutilent le droit
de mobilité et celles qui l’élargissent.
Le transport peut imposer une triple entrave à la
circulation : en brisant son flot, en isolant des catégories hiérarchisées de
destinations, en augmentant le temps perdu à circuler. On a déjà vu que la clé
de la relation entre le transport et la circulation se trouve dans la vitesse
maximale du véhicule. On a vu aussi que, passé un certain seuil de vitesse, le
transport gêne la circulation. Il bloque la mobilité en saturant l’espace de
routes et de voitures, il transforme le territoire en un lacis de circuits
fermés définis par les degrés d’accélération correspondants, il vole à chacun
son temps de vie pour le donner en pâture à la vitesse.
L’inverse vaut aussi. En deçà d’un certain seuil de
vitesse, les véhicules à moteur sont un facteur d’appoint ou d’amélioration en
rendant possibles ou plus faciles certaines tâches. Des véhicules à moteur
peuvent transporter les vieillards, les infirmes, les malades et les simples
paresseux. Ascenseurs et tapis roulants peuvent hisser sur une colline cyclistes
et engins. Des trains peuvent servir aux rotations quotidiennes, mais à la seule
condition de ne pas engendrer au terme des besoins qu’ils ne sauraient
satisfaire. Et le danger demeure que ces moyens de transport distancent les
vélos pour les trajets de chaque jour.
Bien sûr l’avantage d’une voiture est évident pour
celui que ne va pas à son lieu de travail, mais part en voyage. Jusqu’à l’époque
de la machine à vapeur, le voyageur était ravi de pouvoir franchir 50 kilomètres
par jour, que ce fût en bateau, à cheval ou en calèche, soit 3 kilomètres par
heure d’un pénible voyage. Le mot anglais travel rappelle encore combien
il était dur de voyager : il vient du latin tripalium, ce pal formé de
trois épieux, instrument de supplice ayant remplacé la croix dans le haut Moyen
Age chrétien. On oublie trop facilement que franchir 25 kilomètres à 1’heure
dans une voiture bien suspendue représente un « progrès » longtemps
inconcevable.
Un système moderne de transport qui se fixerait
cette vitesse d’acheminement permettrait à l’inspecteur Fix de rattraper Phileas
Fogg dans sa course autour du monde en moins de la moitié des 80 jours
fatidiques. Il faut voyager à une vitesse qui laisse le temps du voyage rester
celui du voyageur. Si l’on demeure en deçà de ces limites, on allège les couts
temporels du voyage, pour la production comme pour le voyageur.
Limiter l’énergie consommée et, donc, la vitesse
des moteurs ne suffit pas à protéger les plus faibles contre l’exploitation des
riches et des puissants : eux trouveront encore le moyen de vivre et de
travailler dans les bons quartiers, de voyager régulièrement dans des wagons
capitonnés et de réserver une voie spéciale pour leurs médecins ou les membres
de leur comité central. Avec une vitesse maximale limitée, on pourra réduire ces
inégalités à l’aide d’un ensemble d’impôts et de moyens techniques. Avec des
vitesses de pointe illimitées, ni l’appropriation publique des moyens de
transport ni l’amélioration technique du contrôle n’aboliront l’exploitation et
l’inégalité croissantes. L’industrie du transport est la clé de la production
optimale de la circulation tant qu’elle n’exerce pas de monopole radical sur la
productivité de chacun.
Chapitre X : Sous-équipement, surdéveloppement et maturité technique
La combinaison du transport et du transit qui
compose la circulation nous offre un exemple de consommation d’énergie
socialement optimale, avec la nécessité d’imposer à cette consommation des
limites politiquement définies. La circulation fournit aussi un modèle de la
convergence des intentions de développement dans le monde entier et un critère
de distinction entre pays sous-équipés et pays surindustrialisés.
Un pays est sous-équipé s’il ne peut fournir
à chaque acheteur la bicyclette qui lui conviendrait. Il en est de même s’il ne
dispose pas d’un réseau de bonnes pistes cyclables et de nombreux moteurs
auxiliaires à faible consommation, utilisables sans frais. En 1975, il n’y a
aucune raison technique, économique ou écologique de tolérer où que ce soit un
tel retard. Ce serait une honte si la mobilité naturelle de l’homme devait,
contre son gré, stagner plus bas que le degré optimal.
Un pays est surindustrialisé lorsque sa vie
sociale est dominée par l’industrie du transport qui détermine les privilèges de
classe, accentue la pénurie de temps, enchaîne les gens à des réseaux et à des
horaires. Sous-équipement et surindustrialisation semblent être aujourd’hui les
deux pôles du développement potentiel. Mais hors de ce champ de tension, se
trouve le monde de la maturité technique, de l’efficacité postindustrielle où
un faible apport technique triomphe du contingentement des marchandises rares
qui résulte de l’hybris technique. La maturité technique consiste à maintenir
l’usage du moteur dans ces limites au-delà desquelles il se transforme en
maître. La maturité économique consiste à maintenir la production industrielle
dans ces limites en deçà desquelles elle fortifie et complète les formes
autonomes de production. C’est le royaume du vélo et des grands voyages, de
l’efficacité souple et moderne, un monde ouvert de rencontres libres.
Pour les hommes d’aujourd’hui, le sous-équipement
est ressenti comme une impuissance face à la nature et à la société. La
surindustrialisation leur enlève la force de choisir réellement d’autres modes
de production et de politique, elle dicte aux rapports sociaux leurs
caractéristiques techniques. Au contraire, le monde de la maturité technique
respecte la multiplicité des choix politiques et des cultures. Évidemment, cette
diversité décroît dès que la société industrielle choisit la croissance aux
dépens de la production autonome.
La théorie ne peut fournir aucune mesure précise du
degré d’efficacité postindustrielle ou de maturité technique dans une société
donnée. Elle se borne à indiquer l’ordre de grandeur où doivent se situer ces
caractéristiques techniques. Chaque communauté dotée d’une histoire doit, selon
ses procédures politiques propres, décider à quel degré lui deviennent
intolérables la programmation, la destruction de l’espace, le manque de temps et
l’injustice. La théorie peut souligner que la vitesse est le facteur critique en
matière de circulation, elle peut prouver la nécessité d’une technique à faible
consommation d’énergie, mais elle ne peut fixer les limites politiquement
réalisables. Le roulement à billes peut provoquer une nouvelle prise de
conscience politique qui conserve aux masses le pouvoir sur les outils de la
société, ou bien il peut susciter une dictature techno-fasciste.
Il est deux moyens d’atteindre la maturité
technique : par la libération de l’abondance ou par la libération du manque. Les
deux conduisent au même terme : la reconstruction sociale de l’espace, chacun
faisant alors l’expérience toujours neuve de vivre et de se mouvoir là où se
trouve le centre du monde.
La libération de l’abondance doit commencer dans
les îlots de surcirculation dans les grandes villes, là où les surdéveloppés
trébuchent les uns sur les autres, se laissant catapulter à grande vitesse d’un
rendez-vous à l’autre, vivant à côté d’inconnus qui se hâtent chacun autre part.
Dans ces pays, les pauvres sont sans cesse expédiés d’un bout à l’autre de la
ville, perdant ainsi leurs loisirs et leur propre vie sociale. Chaque groupe
social (le Noir, le PDG, l’ouvrier, le commissaire) est isolé par la spécificité
de sa consommation de transport. Cette solitude au cœur de l’abondance, dont
tous ont à souffrir, éclatera si les îlots de surcirculation dans les grandes
villes s’étalent et s’il s’ouvre des zones libres de tout transport où les
hommes redécouvrent leur mobilité naturelle. Ainsi, dans cet espace dégradé des
villes industrielles, pourraient se développer les commencements d’une
reconstruction sociale ; les gens qui se disent aujourd’hui riches rompront
leurs liens avec le transport surefficace dès qu’ils sauront apprécier l’horizon
de leurs îlots de circulation et redouter d’avoir à s’éloigner de chez eux.
La libération du manque naît à l’opposé. Elle brise
le resserrement du village dans la vallée et débarrasse de l’ennui d’un horizon
étroit, de l’oppression d’un monde isolé sur lui-même. Élargir la vie au-delà du
cercle des traditions est un but atteignable en quelques années pour les pays
pauvres, mais seulement pour qui saura écarter la soumission au développement
industriel incontrôlé, soumission qu’impose l’idéologie de la consommation
énergétique sans limite.
La libération du monopole radical de l’industrie,
le choix joyeux d’une technique « pauvre » sont possibles là où les gens
participent à des procédures politiques fondées sur la garantie d’une
circulation optimale. Cela exige qu’on reconnaisse l’existence de quanta
d’énergie socialement critiques, dont l’ignorance a permis la constitution de la
société industrielle. Ces quanta d’énergie conduiront ceux qui consomment
autant, mais pas plus, à l’âge postindustriel de la maturité technique.
Cette libération ne coûtera guère aux pauvres, mais
les riches payeront cher. Il faudra bien qu’ils en payent le prix si
l’accélération du système de transport paralyse la circulation. Ainsi une
analyse concrète de la circulation révèle la vérité cachée de la crise de
l’énergie : les quanta d’énergie conditionnés par l’industrie ont pour
effets l’usure et la dégradation du milieu, l’asservissement des hommes. Ces
effets entrent en jeu avant même que se réalisent les menaces d’épuisement des
ressources naturelles, de pollution du milieu physique et d’extinction de la
race. Si l’accélération était démystifiée, alors on pourrait choisir à l’est
comme à l’ouest, au nord comme au sud, en ville comme à la campagne, d’imposer
des limites à l’outil moderne, ces limites en deçà desquelles il est un
instrument de libération. |