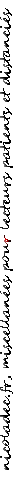Pour tenter d’ébaucher avec suffisamment de prudence pédagogique la délicate
approche de ce problème difficile, je me permettrai, à titre propédeutique, de
vous soumettre le cas, encore relativement simple, quoique déjà non dénué d’une
certaine ambiguïté, d’un certain peigne, dont vous trouverez l’analyse plus
détaillée, dans le compte-rendu de la communication qu’il m’a été donné d’avoir
l’honneur de tenir le mois dernier auprès de la docte assemblée restreinte de
mes collègues associés, sous le titre "Le cas du peigne " dK ", une approche
distanciée de notre rapport acritique au monde des objets" , que vous
trouverez dans la troisième livraison de notre revue pour l’année scolaire
écoulée. Rappelons d’abord les données factuelles de ce cas. Lors d’une
vente aux enchères, on dispersa naguère, au grand dam de ses descendants
légitimes, des objets divers ayant appartenu à feu John Fitzerald Kennedy,
président en son temps des états unis d’Amérique, et grande figure mythique du
milieu du vingtième siècle. Le brouillon froissé sur lequel il avait tracé les
premiers mots de son fameux discours inaugural, sur le thème aide l’état avant
d’attendre qu’il ne t’aide, sa serviette en croco, un des ses yachts
présidentiels, et bien d’autres choses encore. N’ayant pu obtenir, suite aux
polémiques qui s’ensuivirent, communication du catalogue de cette vente
contestée, nous n’avons pu savoir de manière certaine s’il y avait également
quelques uns de ses mouchoirs en papier du jour où il eût par procuration
quelques déboires dans la baie des cochons, ou encore d’autres accessoires
divers dont il avait pu être amené à faire usage, au vu des ses pratiques
connues. Il ne nous appartient pas ici de nous pencher sur les motifs qui
peuvent pousser à organiser ce que d’aucuns qualifièrent de mascarade. Il nous
suffit de considérer que mettre en vente de telles collections d’objets, dont le
caractère hétéroclite dégage d’ailleurs une certaine poésie d’un goût un peu
suranné et néanmoins légèrement teinté de surréalisme, vendre des morceaux de
tour Eiffel ou des parts de lune, trouvent néanmoins une certaine justification
qu’un commentateur populaire avait résumé à l’époque de cette formule
approximative, mais non dénuée d’une certaine pertinence, et qui connut alors un
certain succès, je cite : Tant qu’il y aura des gogos, il y aura des
bénéfices à prendre, et la sottise consentante des acquéreurs vaudra
disculpation des vendeurs. Mais là n’est pas aujourd’hui notre problème.
Dans la collection des saintes reliques, il y avait un peigne. " Le " peigne,
car pour être mieux vendu, les vendeurs avaient, avec justesse, estimé qu’il
était psychologiquement plus astucieux d’en faire " Le " peigne de Kennedy, que
de se contenter de le présenter comme l’un des multiples, et conséquemment
banals, peignes dont il a probablement du faire usage, au cours de sa carrière
incomplète, mais féconde, de président et de séducteur.
La valeur marchande usuelle de la chose, d’un genre assez banal tel
qu’on en trouve encore couramment de nos jours, ne devait probablement
pas dépasser une modeste fraction de dollars. Le montant de l’enchère
atteignit cependant plus d’un millier de dollars. C’est beaucoup pour un
objet assez standard, en soi sans prestige propre, et dont on trouvera
sans doute assez facilement à peu près le même modèle, mais en neuf,
dans des bazars de quartier ou des supermarchés de périphérie. Certes,
direz-vous, mais la comparaison manque de pertinence, car celui-là était
celui du défunt président, ce que ne pourrait prétendre être celui du
susdit bazar, sous peine de délit de publicité mensongère. Dont acte,
mes chers collègues. Si nous situons bien la différence, l’effet
multiplicateur de plusieurs milliers réside donc dans la différence
qu’il y a, sans tergiverser plus avant sur le sens du "le ", entre " un
peigne " et " un peigne de Kennedy ". Le coefficient multiplicateur
réside donc dans le "de Kennedy ". Il faut alors s’interroger sur le
sens et la nature de cet attribut. Et notamment, sur ce que peut bien
être la réalité effective de ce "de Kennedy ". Non que nous suggérions
qu’il puisse en être des peignes des présidents, comme il en est des
ossements de certains saints chrétiens, dont on pourrait plusieurs fois
reconstituer le squelette à partir des reliques éparses dans le monde.
Admettons que le peigne en question ait bien été authentifié comme l’un
des objets que le président a effectivement glissé dans ses cheveux à différentes occasions.
Mais qu’en est-il alors de cette qualité là, et de sa capacité à générer un bon
millier de dollars ? C’est une question sociologique, économique, et également
physique et métaphysique à la fois. Notre questionnement portera d’abord sur le
fait de savoir si, pour exporter des concepts éthologiques traditionnels, il
fallait la considérer comme une propriété intrinsèque de l’objet, innée ou
acquise ? Innée, évidemment non, un peigne standard ne sort pas de l’usine en
tant que peigne du président. Quant à l’acquis, à quelle propriété effective de
l’objet, empiriquement vérifiable, renverrait-il ? Sur le simple rapport de
propriété que semble à première vue signifier le "de ", il faut d’abord se
remémorer ce constat de base : Que le peigne en question ait été celui d’un
président, d’un modeste lampiste basique, ou encore même, funeste destin, le
peigne de strictement personne, cela ne change aucunement qu’il n’était que ce
qu’il était en lui-même, que donc sa réalité objective s’arrête en deçà du
" de ". Autrement dit, que celui qui se rend acquéreur du peigne du vénéré grand
homme, n’acquiert strictement rien de plus que celui qui achète le même modèle
au super bazar ou ailleurs. Si maintenant vous vous accrochez au prétendu fait
que celui-ci avait néanmoins été propriété du président, ce que celui-là n’avait
pas été, gardez alors attentivement en l’esprit que cette distinction là ne
réside pas dans l’objet même, qui ne possède aucune caractéristique intrinsèque
qui soit "de Kennedy ", mais totalement et uniquement dans l’esprit et la
mémoire des hommes, seulement de certains hommes d’ailleurs. La propriété
générant l’importante plus-value n’est donc pas sise en l’objet même, mais dans
divers esprits l’appréhendant. Et l’acquéreur ne repart pas chez lui avec les
esprits en question, mais seulement avec son peigne, vide de toute appartenance.
Avouons toutefois qu’on ne peut s’empêcher de ressentir une certaine admiration,
ne serait-ce qu’esthétique, pour ces hommes qui parviennent, de sang-froid, à
vendre très cher à quelqu’un un peigne, en lui faisant croire uniquement que
c’est un peigne. Certains voudront à toutes fins se raccrocher à l’espoir vain
qu’il resterait bien tout de même un petit quelque chose dans l’objet qui
porterait la marque de son illustre possesseur. Mais qu’espèrent-ils alors ?
Qu’un tic gestuel précis de son maître ait fait, par une usure systématique, que
les dents du peigne s’en soient trouvées marquées d’une manière spécifiquement
kénédienne ? Qu’une analyse chimique, ou biologique, puisse trouver trace au fin
fond de l’entre-deux dents de l’objet d’un reste somatique de feu le grand
homme ? Bien que la chose ne soit après tout pas totalement exclue, on peut
supposer d’une part que ce cher John était suffisamment propre pour nettoyer ou
faire nettoyer ses peignes, et qu’on y trouverait plutôt à la rigueur, quelque
reste détersif de l’époque, d’autre part que les acquéreurs de la chose ne
visaient pas par cet achat là à posséder quelque cellule présidentielle
résiduelle, ce qui relèverait d’une forme atténuée de violation de sépulture.
Alors que peut-il bien rester de réalité dans ce "de Kennedy " ? Qu’il ait
effectivement appartenu à cet homme ? Mais cette propriété là, nous l’avons vu,
n’est aucunement située dans l’objet même, elle est à la rigueur dans la mémoire
des hommes qui le considèrent. Il faudrait d’ailleurs savoir desquels, car si
c’est dans celle des vendeurs, la prudence, pour ne pas dire la méfiance, la
plus minimale porterait à supposer qu’ils doivent probablement avoir le souvenir
large et accueillant en la matière. Mais de toutes façons, qu’ils aient été un
peu avides comme il est probable, ou scrupuleux, que la dite propriété soit ou
non sérieusement attestée, il reste que l’attribut porteur de la plus value ne
renvoie pas à une partie de l’objet ou à une de ses propriétés, mais à la parole
d’hommes formulant des souvenirs éventuels, probablement dans le détail assez
divers et légèrement incompatibles entre eux, qu’ils synthétisent sous la forme
de ce qu’on appelle grammaticalement un complément de nom. Si l’on résume, le
bon millier de dollars en plus de la valeur vénale trouve son fondement dans un
complément de nom, regroupant elliptiquement des souvenirs variés ou supposés
tels. Ce qui, vous en conviendrez, fait cher pour une catégorie grammaticale
certes diversifiée dans ses significations précises, mais néanmoins assez
banale. Il n’y a donc rien dans ce peigne qui soit désignée par la
précision " dK ". Qu’on nous comprenne bien : ce complément de nom désigne
effectivement ce qu’on pourrait appeler d’une manière ambiguë " quelque chose ",
cependant ce quelque chose n’est pas à proprement parler une chose, ni même une
des parties d’une chose ou une de ses propriétés, mais une simple idée,
uniquement existante dans la pensée des hommes pour qui seuls ce peigne peut
être " dK ". A quoi bon, m’objecterez-vous, se donner tant de mal, pour tenter
de distinguer dans ce que nous appelons un peigne, ce qui fait effectivement
partie de l’objet, et ce qui fait seulement partie de l’appréhension que nous en
avons, dans ses débordements par rapport au strict donné ?
Nous n’ignorons pas, Mesdames, Messieurs, que les représentants accrédités des
tendances sociologistes qui prédominent de nos jours, objecteront qu’il est
maintenant reconnu de tous que tout objet par nous appréhendé, déborde de toutes
parts de connotations humaines, qui ne renvoient pas à la stricte réalité
matérielle, pour ne pas dire physico-chimique, de l’objet, mais au sens plein,
multiple et ouvert, qu’il possède dans l’expérience que nous en avons. Certes,
chers collègues, et vous, mademoiselle aux yeux d’airain, certes. Mais voyons
donc s’il ne serait pas néanmoins nécessaire de différencier en l’objet ce qui
lui confère sa réalité même, oserais-je dire objective, et ce que nous y mettons
d’humain, et qui apparaîtra et disparaîtra avec nous, et non avec l’objet ? Car
de toutes façons, à quiconque qu’il ait pu appartenir, un peigne n’est peigne
que pour des consciences humaines, néanmoins munies de têtes chevelues, et n’est
en lui-même hors des consciences qu’un morceau de corne ou de plastique, ou
autre matière, régulièrement dentelé. L’objet même, stricto sensu, n’est
qu’un morceau de matière, approximativement et provisoirement légèrement détaché
du reste du monde. Aussi bien, nous objectera-t-on, la chose qu’est
effectivement pour nous un peigne n’existe dans l’objet matériel, que muni de sa
fonctionnalité, qui n’est elle cependant que dans l’esprit des hommes, et donc
que, de Kennedy ou non, les objets ont une surface conceptuelle qui déborde
largement leur simple présence muette. Il est alors deux questions que nous
voudrions pouvoir poser. Premièrement, sont-ce les objets mêmes qui débordent en
quoi que ce soit de leur présence factuelle, ou n’est-ce pas plutôt la
représentation que nous nous en faisons ? Deuxièmement, n’y a-t-il pas des
niveaux en plus ou en moins dans la consistance de l’appréhension humaine,
faisant par exemple qu’il serait judicieux de distinguer entre une propriété
n’appartenant pas à l’objet, mais néanmoins repérable de manière quasi immédiate
par un grand nombre de membres d’une certaine communauté culturelle plus ou
moins vaste, comme le fait de reconnaître qu’il s’agit d’un peigne, et une
propriété plus sujette à interrogation et moins présente, en ce qu’elle ne
renvoie pas à la simple fonctionnalité communément admise, comme son hypothétique
appartenance passée à tel homme ? Le peigne sera identifié comme peigne sur la
base d’une expérience culturelle commune immédiate, alors qu’il ne pourra être
dit dK que sur la foi de certaines paroles humaines limitées : il existe donc
des degrés divers dans la manière qu’a l’esprit de mettre dans les choses plus
de choses qu’il n’y en a objectivement.
Devant ces nuances nécessaires à entretenir devant la variété des degrés de remplissage
psychologique des choses, d’aucuns demanderont à quoi bon distinguer alors ce
qui est réel de la visée que nous en avons. D’autant que, par de fort beaux
tours d’illusionnistes, des esprits parmi les plus émérites, dans les domaines
de la philosophie, de la religion, et autres domaines annexes, nous contesteront
la possibilité même de pouvoir entreprendre une telle distinction, voire
prétendront en réfuter le fondement même. Emettons alors, en première
approximation, le souhait que nous puissions, pour reprendre les termes
classiques de la célèbre distinction stoïcienne, reconnaître ce qui dépend de
nous de ce qui n’en dépend pas. Oserions nous insinuer que ceux qui
prétendent nous empêcher de clarifier cette distinction, ont souvent comme
ultime motivation, dans leur tentative de maintien de la confusion, de préserver
leur prétention, plus ou moins réelle, plus ou moins fantasmée, que tout cela ne
continue à dépendre que d’eux ? Le refus de vouloir tenter de reconnaître ce
qu’il peut y avoir de réel et ce qu’il peut y avoir d’imaginaire dans une chose,
risque fort, en dernière analyse, de renvoyer à un enjeu de pouvoir, ce qui
éclaire de manière plus limpide la hargne véhémente que ne manquent pas de
soulever les tentatives analogues à la notre présente.
Abandonnons donc pour ce jour, mes nobles condisciples, ainsi toujours que vous,
mon estimable et cependant troublante demoiselle, si vous le voulez bien, la
coiffure et le commerce de l’imaginaire hypostasié. Penchons-nous sur cet autre
cas de figure riche d’enseignements, que nous dénommerons l’objet mixte,
partiellement réel, partiellement imaginaire, sous la forme par exemple de
l’objet sur lequel se concrétisent les phobies. La phobie, dans sa grande
diversité de formes, peut être un comportement névrotique extrêmement
préjudiciable. Nous nous limiterons ici à cette forme atténuée, se caractérisant
par de petits comportements, plus ou moins spectaculaires, mais malgré tout
bénins, qu’on peut néanmoins ranger sous la catégorie des phobies animales, ou
zoophobies. La personne qui s’agite frénétiquement, perchée sur sa chaise, à la
vue d’une souris, a ce que nous pourrions qualifier de réaction fortement
disproportionnée à l’agression supposée dont elle se croit victime. La souris en
question est d’abord souvent une jeune enfant, les souris ayant cette déplorable
et un tantinet abominable manie, qu’au grand jamais des hommes n’oseraient
pratiquer, d’envoyer les plus jeunes au front. Ensuite, quelque soit leur âge,
et sans tomber dans les excès contemporains du goût esthétique, on peut estimer
que ce sont généralement de très mignons petits animaux, avec une jolie
frimousse à faire craquer une âme un tant soit peu sensible aux beautés
corporelles. Enfin, elles semblent manifester une certaine forme de ce qu’on
oserait appeler intelligence, qui, combinée avec un certain caractère
affectueux, en font des partenaires de ce bas monde autrement agréables que
certains humains du type standard. Et bien, peut-être en avez-vous eu
l’expérience, mais ces divers arguments, assez incontestables, ne sont à peu
près d’aucun poids, même clairement et pédagogiquement énoncés à la personne en
chaire. Il est alors manifeste qu'il n'y a pas de rapport que nous qualifierons
de directement objectif entre les gesticulations hystériques et l’objet qui est
censé en être la cause. La phobie est bien réelle, et souvent profondément
ancrée, la souris aussi est bien réelle. Mais la liaison qui peut exister entre
l’une et l’autre n’existe nulle part ailleurs que dans l’esprit de la personne
phobique, si ce n’est évidemment en l’esprit de l’observateur qui en perce le
secret. Ce qu’elle appréhende donc en tant que souris, ce qu’elle nomme de ce
nom, est et n’est pas réellement une souris. Ca l’est réellement pour elle, ça
ne l’est que partiellement du côté souris effective. Pour ne pas avoir à heurter
la sensibilité de certains de nos jeunes auditeurs, mes collègues, mademoiselle
aux lèvres purpurines, je me contenterai de vous indiquer sommairement que ce
qui semble inquiéter dans cette sorte de petite bête furtive, c’est sa capacité,
d’ailleurs bien réelle, de s’introduire dans d’étroits orifices. Pour plus ample
informé, je vous convierai à vous reporter par exemple au supplice du rat,
dont vous trouverez l’exposé dans le cas de " l’homme aux rats ", exposé par
Freud dans ses cinq psychanalyses. Ainsi donc, la souris du phobique, si
elle existe bien réellement, y compris dans ses capacités redoutées, n’en a pas
moins un mode d’existence largement imaginaire telle qu’elle existe dans ses
fantasmes. Je pourrais bien sûr vous multiplier les exemples, et vous inviter à
vous interroger sur la consistance matérielle de la chose crainte, quand, vous
réveillant au milieu de la nuit et découvrant une jolie araignée velue au coin
de votre bouche entrouverte, vous laissez libre cours à une jolie pointe
d’angoisse arachnophobe ? A travers ces exemples, volontairement choisis dans
leur caractère frappant, pour mieux illustrer la nature du problème, je voudrais
attirer votre attention sur ce procédé fondamental, et néanmoins
systématiquement occulté, de confusion quasi naturelle, qui nous rend si
difficile la reconnaissance de ce qui dans notre appréhension de la chose
n’appartient qu’à nous, et n’a aucun répondant réel dans l’objet, et ce à quoi
on peut trouver en l’objet une forme ou une autre de référent. Nos choses ont
toujours au moins un petit quelque chose d’imaginaire, et souvent un grand
quelque chose, et il ne nous est pas facile de le discerner.
Si maintenant nous tentons de pousser plus loin notre investigation sur la part
subjective, mais ne correspondant néanmoins à rien d’existant dans l’objet tel
qu’en lui-même, de notre visée, nous reconnaîtrons qu’elle peut atteindre des
proportions autrement inquiétantes que dans les cas banals de zoophobies, ou
autres débordements légèrement névropathes, mais néanmoins plutôt inoffensifs,
de la surface idéelle de l’objet sur son volume propre effectif. L’amateur de
fantômes, par exemple, contrairement à ce que s’imaginent parfois dans leur
belle intransigeance sceptique certains de nos libres mais néanmoins
insuffisamment empiriques penseurs, a souvent effectivement vu quelque chose,
peut être certes parfois relevant surtout de l’ordre des phosphènes, mais
peut-être aussi quelque chose qui soit indubitablement d’origine externe, comme
une ombre, un courant d’air, un reflet, voire même une silhouette. De la même
manière que dans le rêve, un matériau sensoriel éventuellement anodin, mais qui
est quand même, peut-être pour cette raison, parvenu de l’extérieur à franchir
les barrières psychologiques et physiologiques mises en place par le sommeil
protecteur, est remis en forme, et ne devient signifiant, qu’à travers les
préoccupations purement internes du rêveur, de la même manière, la vie diurne
laisse place à des constitutions d’objets dont la plus grande part est certes
fantasmée, mais qui n’en ont pas moins pour substrat des éléments du réel. Ainsi
existent des degrés divers de consistance ou d’inconsistance objective des
choses que nous croyons identifier. Cependant ce qui confère la consistance est
rarement, comme il pourrait l’être dans une démarche spécifiquement
scientifique, une convergence d’indices matériels éventuellement vérifiables et
coordonnés à travers une démarche rationnelle, mais, de manière à la fois plus
forte et plus douteuse, par la prégnance des schémas internes. On croit à la
réalité de la chose, parce qu’on croit à la réalité de la croyance qui permet de
la constituer telle. Ce qu’on pourrait résumer plus sobrement par : on croit
parce qu’on croit. Et dans ces conditions, l’existence de l’objet devient
indiscutable. Il est donc toujours un peu vain de prétendre contester
l’existence des fantômes, car pour ce que leurs adeptes appellent exister, ils
existent bel et bien. Quant à l’espèce en voie de raréfaction des puristes de
l’existant et du non existant, pour laquelle nous revendiquons, vous et moi,
chers confrères, si ce n’est notre appartenance, du moins un étroit lien de
parenté, ils ont fort à faire pour ne pas passer pour des illuminés dans
l’exercice de leur juste prétention.
Toutefois, les amateurs de fantômes, pour exaspérant qu’ils puissent parfois
nous paraître, ne sont, pas plus que les acquéreurs de peignes mythiquement
surinvestis, de dangereux ennemis qui mériteraient que l’on menât contre eux une
croisade libératrice. D’autant que certains peuvent avoir en la matière
l’hypostasie amphibologique, délirant par exemple joyeusement et sincèrement
dans leur constitution d’objet largement fantomatique, tout en ayant une très
réaliste appréciation du bénéfice matériel, ou du gain en célébrité qu’ils
peuvent en espérer tirer. Mais dans ce que nous nous permettrons d’appeler la
camelote du bazar des choses frelatées, c’est-à-dire dont l’existence comporte
une forte composante imaginaire, il en est qui sont parvenues à se tailler des
prestiges bien au dessus de leur consistance manifeste. Un visionnaire de
fantômes, dans nos milieux culturels, par exemple, ne fait pas très sérieux dans
l’échelle des valeurs ainsi constituées, tandis qu’un exorciste officiel, homme
d’église dûment accrédité par les autorités compétentes en la matière, fait plus
chic, plus intellectuel, plus profond, et en plus, se situe de manière reconnue
du bon côté dans l’éternelle lutte du bien contre les forces du mal, et vous et
moi, chers amis et confrères, n’hésiterions pas à l’asseoir autour de notre
table. Pour vous dire que l’estime d’une part, la dangerosité d’autre part, de
ces genres de constitutions d’objets, n’est pas nécessairement en rapport direct
avec l’intensité de leur degré hallucinatoire.
Prenons donc un exemple qui connaît, après quelques vicissitudes, un regain
d’actualité, celui de cette chose assez mystérieuse pour des gens qui ont
l’habitude d’accommoder leur vision à l’exacte distance de la chose à voir, et
qu’on appelle humanité. Il n’est pas aisé de parler d’une telle chose, car, dans
un régime républicain, reposant notamment sur le respect de la liberté
d’expression de chacun, la loi interdit paradoxalement que puissent être remises
en cause certaines notions, dont celle notamment de crime contre l’humanité.
Passons sur cette idée légèrement plus complexe qu’il y paraît, qui fait que
seule un être humain est susceptible de commettre ce qu’on appelle juridiquement
un crime, et que tout être humain relevant par principe de la dite humanité, la
prétention de l’existence d’exceptions en la matière relevant précisément dudit
crime, seule donc l’humanité est susceptible de commettre un crime. Les dits
crimes contre l’humanité sont donc partie, pour le moins regrettable certes,
mais néanmoins intégrante de la dite humanité, ce qui pose un problème logique
que nous nous garderons de développer ici. Il va de soi qu’il ne s’agît pas de
notre part, mes chers confrères, et vous, mademoiselle au regard
culpabilisateur, d’une tentative d’innocenter des hommes coupables de tels
crimes, mais tout au contraire, de prétendre qu’ils sont le cas échéant
coupables d’autre chose autrement plus grave que d’avoir porté atteinte à une
hypothétique notion visant une collection abstraite et indéterminée, qu’ils sont
responsables de crimes sur des hommes réels particuliers, en chair et en os. Ce
qui nous inquiète ici au sujet de cette notion est simplement : quelle sorte de
chose peut donc bien être ce qu’on désigne d’un tel nom ? N’allez pas croire,
mes chers confrères, que la question soit nouvelle. Elle avait notamment déjà
été posée avec précision et vigueur au quatorzième siècle, quand un franciscain
excommunié, connu sous le nom de Guillaume d’Ockham, notait que l’humanité, ou
la chevalité, ou tout autre mot renvoyant à une notion dite universelle, n’était
qu’un signe renvoyant à l’idée d’une collection d’objets particuliers, la
réalité étant du côté des objets particuliers, le mot désignant la collection ne
désignant que quelque chose existant uniquement dans l’esprit de celui qui par
son appréhension constitue les objets réels en cette collection pensée. Il y a
des hommes réels, il n’y a d’humanité que dans la tête des hommes qui prétendent
en totaliser le nombre indéterminé en un ensemble conceptuel, avec généralement
en prime la prétention propre à ces formes d’hypostasie à leur conférer un
statut de transcendance divine sous couvert d’universalité. Il n’y a pas
d’humanité réelle, encore moins d’essence d’une telle chose, puisque la dite
collection regroupe aussi bien les victimes que leurs bourreaux, et ce sont des
hommes particuliers qu’on torture et qu’on assassine, non un concept universel.
Il y a dans cette transformation d’une idée abstraite en réalité concrète un
dispositif à au moins deux étages assez facilement repérables. Le premier, qui
ne résiste guère à une analyse logique, souvent assez bien menée par ces
tendances diverses qu’on a parfois regroupées, non sans une certaine perversion,
sous le nom de nominalisme, consiste donc à attribuer une existence
indépendante à ce qui est signifié par un signe qui n’a comme sens initial que
de réunir par la pensée une juxtaposition d’objets particuliers en lesquels on
croit reconnaître une certaine similitude, c’est ce que nous avons appelé
hypostasie, sur quoi nous reviendrons tout à l’heure. Mais cette opération,
serait tout de même assez réfutable en elle-même, si l’on restait entre penseurs
de sang-froid, n’ayant pas d’autres motivations sous-jacentes, par exemple
moralisatrices ou de pouvoir, ce qui est souvent équivalent. Quel est donc le
but ultime de ceux qui voudraient, contre toute logique, que l’on croie à
l’existence effective de quelque chose de réel qu’on désignerait sous le nom
d’humanité ? Il semblerait bien que l’objectif, avoué ou non, soit de garder
main basse sur l’ensemble de la collection. Jadis, mais la chose reste encore
usitée de nos jours, on faisait ça par la mise en dépendance absolue de tous par
rapport à l’idée d’un être dit transcendant, dont nous étions ou du moins
devions tous être les fidèles serviteurs, et qu’on appelait un dieu. Cette
technique de prise en charge était manifestement conçue sur le modèle de la
relation du maître et de l’esclave. Comme de nos jours de narcissisme ambiant,
et de surévaluation coutumière de ses propres forces, et où de plus on prend
l’habitude naïve de croire ce qu’on voit, c’est à dire en fait de croire ce
qu’on croit voir, la servitude explicite a mauvaise presse, il a fallu
transposer sous des formes plus intériorisées, on pourrait dire aussi plus
nombrilistes, et nous voilà embarqués dans le culte néopositiviste de
l’humanité. Mais il se trouve encore ici et là, éventuellement à leurs risques
et périls, des hommes qui non seulement, ont le goût des objets plus
consistants, mais qui répugnent un peu aux grandes manœuvres moralisatrices,
généralement très sentencieuses, et au fond très malsaines, des prêcheurs de
choses imaginaires, dont le slogan de ralliement secret tient en cette formule
occulte : Hypostasions, mes frères, il en restera toujours quelque chose.
Il y a nettement pléthore dans ce registre de la chose plus ou moins frelatée.
Les objets de la mode, une bonne part de ceux conçus à destination de la
jeunesse, une part non négligeable de ceux conçus pour l’également hypothétique
ménagère de moins de cinquante ans, le large éventail des pseudoréalités
politico-sociales aussi incontestées qu’évanescentes. Une lessive qui lave plus
blanc, plus hygiénique, ou avec plus de justice sociale, une serviette dite
périodique qui permettra enfin aux femmes, comme on l’a vu récemment, de
respirer plus librement, associant ainsi dans la féminité triomphante, la double
victoire de l’émancipation libératrice et celles des voies respiratoires à tous
les étages, forment de beaux objets de collection, dont on peut supposer qu’ils
figureront dans tout musée digne de ce nom, dans les salles retraçant
l’évolution triomphante de l’humanité dans la deuxième moitié du vingtième
siècle. Je pourrais ainsi vous citer en vrac, sans esprit de suite, et en
n’accompagnant chaque exemple que d’une très brève esquisse explicative,
quelques cas typiques du bestiaire contemporain. Un cd, ou mieux encore un clip,
des 2 be 3, pour utiliser les formes linguistiques accréditées en ce domaine,
sont des choses curieuses, avec cette consternante médiocrité musicale et
gestuelle, néanmoins susceptibles de susciter un enthousiasme incontrôlé,
notamment au près des toutes jeunes filles, sur les bases d’un subtile mélange
de provocation sexuelle inavouée professionnellement dosée et de simplisme des
formes proposées à tous niveaux. La droite et la gauche forment également des
choses tout à fait dignes d’intérêt quant aux processus parfois déroutants selon
lesquels se forge parfois la conviction de l’existence d’objets. Déroutant,
parce que celui est à droite vu de face est à gauche vu de dos, et que la
remarque reste souvent valable en politique. Mais aussi parce qu’on remarque
aisément, dès que l’on est muni d’un minimum d’esprit d’observation et de sens
critique, que les vrais différenciations fondamentales qui s’avéreraient
pertinentes, ne correspondent pas à cette distinction là, et la traversent de
part en part : être républicain ou ne pas l’être, être tolérant ou fanatique,
croire sérieusement au droit des hommes à disposer d’eux-mêmes, financièrement,
matériellement, moralement, intellectuellement, sont des propriétés nullement
déterminables à partir de la mythique appartenance à la droite ou à la gauche.
La solidarité est également intéressante, concept sacré contre lequel il est
périlleux de s’élever, et qui tente de synthétiser un fatras assez hétéroclite,
comprenant notamment diverses taxes plus ou moins destinées à pallier aux
incompétences de gestion passées, présentes et à venir, la possibilité
néocoloniale d’intervenir de force et de manière souvent simpliste dans des
affaires étrangères dont la complexité nous échappe, la volonté de culpabiliser
à tout prix les égarés asociaux qui considéreraient que le meilleur service
qu’ils puissent rendre aux autres serait de commencer par s’occuper d’eux-mêmes,
pour ne s’en tenir qu’à quelques traits bien connus.
Il serait instructif, et du plus grand bienfait public, à tel point que cette
entreprise mériterait d’être subventionnée bien plus que telle ou telle
association dont les objectifs à la mode sont néanmoins nuisibles à la vie tant
individuelle que collective, de jeter les bases d’une topologie générale de la
chose. Rappelons que la topologie constitue cette branche des mathématiques qui
étudie les propriétés invariantes à travers la déformation géométrique des
objets, et d’une manière générale à travers les transformations continues qu’ils
peuvent subir. Le point commun général qui unit ces diverses choses que nous
avons abordées, dans leur grande variabilité, du peigne présidentiel à la
solidarité du peuple de droite gauche, en passant par les fantômes et les
accessoires hygiéniques féminins, c’est qu’elles sont toutes dans l’esprit des
gens qui les utilisent sans recul critique, bien autre chose que ce qu’elles
sont réellement, dans leur réalité dépouillée. Et que ce surplus, plus ou moins
incontrôlé, présente deux dangers majeurs. Le premier est qu’il est tellement
regrettable de traverser une vie et le monde dans lequel elle s’inscrit, en
s’entourant de fantômes, et en ne soupçonnant pas l’extrême richesse, infiniment
supérieure, de la diversité de ce qui existe réellement en dehors de nous. Le
second est que cette renonciation au réel s’inscrit toujours dans l’impossible
mise en place d’un meilleur des mondes, entreprise parfois sympathique et même
jolie dans ses épures, toujours monstrueuse par le pouvoir qu’elle vise à instaurer.
S’il nous est permis de reprendre les quelques principes
basiques que permettent de dégager les modestes prolégomènes à cette topologie
souhaitable, que nous avons aujourd'hui tenté de vous présenter, nous énoncerons
alors les cinq définitions suivantes.
1° Le principe de limitation. Aucune chose n’est réelle absolument parlant, car la
seule réalité pleine est la réalité du tout, aucune chose ne pouvant être
parvenue à l’existence et continuer à exister indépendamment du reste du monde.
Ainsi, toute chose procède d’un découpage plus ou moins subjectif, même quand il
semble avoir une prégnance propre. La limitation qui constitue la chose en tant
que telle comporte donc toujours une part d’irréalité.
2° Le principe d’ancrage minimal. Il n’existe pas de chose qui soit totalement
irréelle, car d’une part le travail de constitution est bien réel en tant
qu’activité psychique de celui pour qui il y a chose, d’autre part ce dernier
n’est pas capable d’une création ex nihilo, et utilise toujours, même de
manière minimale, un matériau qui lui a été fourni.
3° Le principe d’hypostasie. Pour penser les choses dans leurs ressemblances et
dans leurs dissemblances, il est souvent nécessaire de les regrouper par la
pensée dans des collections, et d’attribuer à ces collections des noms pour y
faire référence. Une fois ces noms institués, par une sorte de loi de la
pesanteur linguistique, on finit, à force d’usage, par ressentir à leur
énonciation la présence d’une chose qui pourtant n’existe pas. C’est dans cet
état d’esprit que Pascal demandait qu’on prie pour finir par croire en dieu, et
que la politique consiste pour partie à créer des concepts. La croyance sans
recul critique à la consistance de cette présence s’appelle hypostasie.
4° Le principe de surdétermination. Une fois fait le travail de limitation initial
la définissant dans son appréhension première, la chose est constamment
réélaborée et réinvestie par couches successives, la faisant de plus en plus
déborder d’elle-même sticto sensu, jusqu’à ce qu’on parvienne parfois à
une nébuleuse dont il est difficile de dresser la carte détaillée.
5° Le principe de déréalisation. Plus la chose est socialement usitée, plus forte
devient sa prégnance dans les esprits humains, plus s’épaissit le travail de
surdétermination. On glisse ainsi vers un mode de plus en plus imaginaire, dans
lequel, paradoxalement, plus la chose devient irréelle, plus elle paraît
incontestable dans l’esprit des hommes. Il devient ainsi plus facile de réfuter
quelque chose de réellement existant mais qui ne soit pas à la mode idéologique,
que quelque chose de globalement monstrueusement fictif, mais bien assis sur sa réputation sociale.
Aussi, Maître vénérable, ainsi que vous, mes chers confrères, et bien sûr sans
vous oublier, Mademoiselle au regard cendré, et qui êtes chose d'entre toutes
les choses, aussi prégnante que douteuse, je me permettrai, en guise de
conclusion en ce domaine difficile, de vous proposer quelques travaux pratiques
circonstanciés, qui vous permettront, espérons-le, de moins vous laisser berner
entre toutes ces choses qui n'en sont pas toujours tout-à-fait. Simplement ceci
: prenez la chose à laquelle vous croyez le plus, à l'exception de vous-mêmes le
cas échéant, et une de celles qui vous paraissent les plus frelatées. A l'aide
de la grille des cinq principes que je viens d'avoir l'honneur de vous énoncer,
tentez pour l'une et l'autre d'en reconstruire le processus de formation. Ainsi
pourrez-vous éprouver à quel point il est malaisé mais salvateur de séparer le
réel de l'imaginaire, à quel point il est urgent, selon la formule répétée de
notre maître Sénèque, de reconnaître ce qui dépend de nous, de ce qui n'en dépend pas. |